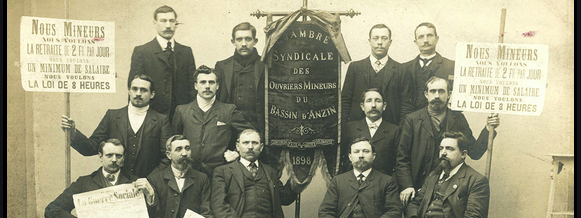
La réforme du système de retraite fait débat depuis plusieurs décennies1. La dernière réforme de 2023 est contestée. En même temps, le déficit de ce système va croissant. Dans son rapport de janvier 2025 le Conseil d’orientation des retraites l’estimait au total à 22 milliards d’euros. Dans un contexte marqué de différentes tensions (énergétique, militaire, etc.) émerge une « petite musique » qui suggère d’augmenter la contribution des retraités au redressement financier du système dans la mesure où ils seraient des nantis. Ces discours reposent sur un mythe : la supposée richesse d’une grande partie des retraités.
En réalité, les revenus des retraités sont inférieurs à ceux des salariés. Leur richesse n’est supérieure que si on prend en compte leur patrimoine immobilier et financier. Par rapport aux salariés, ils sont en effet plus nombreux à être propriétaires de leur logement acquis pendant leurs années d’activité grâce à leur épargne.
Le sujet est un peu rébarbatif à première vue, mais les citoyens, en particulier les vielles et vieux, sont mal informés sur cet enjeu pour pouvoir s’y investir. À défaut de mobilisation, ils risquent de subir de sérieuses pertes de revenu. La vigilance s’impose.
Quatre causes identifiées
Un rapport de février 2025 de la Cour des comptes a souligné, une fois de plus, le manque de financement du système des retraites. Leur coût annuel est de 375 milliards, soit 39,5% du budget social2. Dans son état actuel, le système par répartition est de plus en plus déséquilibré. Il y a eu 6,6 milliards de déficit en 2024. La Cour de comptes anticipe 15 milliards en 2035, et 30 en 2045. Ces données rejoignent celles du dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR, juin 2024) qui exclut tout retour à l’équilibre dans les prochaines décennies, et dont le scénario de référence prévoit un déficit constant qui s’établirait vers 0,8 du PIB en 2070.
De ce point de vue, la réforme de 2023 (reculant l’âge de départ à la retraite à 64 ans) est considérée comme insuffisante. Elle ne ferait gagner que 10 milliards en 2030.
Parmi les multiples causes de déficit identifiées par les rapports, il y en a quatre principales :
– Au premier rang, se trouve la diminution des ressources en raison du faible niveau d’emploi. Cette situation est particulièrement nette chez les plus de cinquante ans. Seuls 57% des 55-64 ans travaillent, alors que la moyenne en Europe est de 62,5%. Cela se traduit par un manque significatif de cotisation.
– Vient ensuite l’importance des exonérations de charges accordées depuis des décennies. Elles ont doublé en dix ans et représentent aujourd’hui environ 80 milliards annuels. Ces pertes, justifiées par le soutien à l’économie et la diminution du coût du travail, ne sont que partiellement compensées par l’État.
– À cela s’ajoute une série de mesures de solidarité : compensation des périodes non travaillées par l’octroi de trimestres, départs anticipés hors carrières longues, minima de pension, majoration pour enfants, etc. Soit au total près de 43 milliards par an. Comme les précédentes, elles ne sont que partiellement compensées par l’État.
– Tout cela, dans un contexte de vieillissement de la population. L’espérance de vie est de 85,6 ans pour les femmes, de 80 ans pour les hommes, et cette évolution démographique entraîne des retraites plus longues à assurer. En 2022, il y avait trois fois plus de retraités qu’il y a quarante ans, soit 17 millions de personnes pour 30,1 millions de cotisants.
Ces contraintes se cumulent. Elles n’ont cessé d’augmenter depuis plus de quarante ans, et les différentes réformes ne les ont modifiées qu’à la marge. Parfois, elles les ont même renforcées.
Un « conclave » qui s’annonce très tendu
Le 27 février dernier, les partenaires sociaux ont commencé un « conclave » (un jour par semaine) de trois mois pour réviser la réforme de 2023. Les discussions porteront principalement sur la possibilité de replacer l’âge de départ à la retraite à 62 ans au lieu des 64 ans. D’autres sujets sont au programme : les longues carrières, les inégalités de carrière homme/femme, l’introduction d’un complément de retraite par capitalisation, etc. Mais ce vaste programme a été cadré par le Premier ministre qui a demandé que les propositions à venir aboutissent à un équilibre des comptes pour 2030, ce qui passe par une augmentation des ressources et/ou une diminution des coûts. Dès l’ouverture de la réunion, le représentant de FO a quitté la réunion, estimant qu’il s’agissait d’une « mascarade ». Chacun ayant ses « lignes rouges », les négociations s’annoncent très tendues.
Même fixé à 64 ans, la France est avec l’Allemagne et la Suède le pays qui a l’âge de départ à la retraite le plus favorable en Europe. Il est de 67 ans en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie, de 68 en Grande-Bretagne.
La « double peine » financière
Le 23 février, le ministre de l’Économie Éric Lombard a proposé une contribution accrue des retraités à l’effort financier du système de retraite : « Il est assez illogique que le niveau de vie des retraités soit en moyenne supérieur à celui des salariés. » Quelques jours plus tard, la ministre du travail, Mme Astrid Panosyan-Bouvet déclarait dans le même sens : « En France, les retraités sont mieux lotis que dans d’autres pays (…) ils ont un niveau de vie équivalent à celui des actifs. »
Des raisonnements effectués globalement, ce qui n’a pas beaucoup de sens. En effet, il existe des retraités pauvres et d’autres plus ou moins aisés, les nantis sont une minorité. La situation de ces différentes catégories doit être différenciée. Selon le ministère du Travail (Drees, octobre 2024) :
– Les salaires du privé (en net, temps plein) sont en moyenne de 2 730 € mensuels ; ceux du public de 2 530 €.
– Les retraités touchent en moyenne 1 682 € avec des disparités importantes : ils sont 65% à être pensionnés au-dessous de la médiane de 1 512 €. 45% d’entre eux gagnent moins de 1 200 €. Un quart des pensionnés touchent mois de 811€ mensuels (seuil de pauvreté), et ils ne sont que 8% à bénéficier d’une retraite supérieure à 3 000 € et 1% à recevoir plus de 5 000 €3.
La situation des femmes retraitées est plus défavorable sur deux plans au moins. D’une part, elles sont 32% à vivre d’une pension de réversion. D’autre part, les pensions perçues par les femmes sont globalement inférieures de 38% à celles des hommes en raison des aléas de leur carrière (niveau de rémunération, emploi à temps partiel, interruption de carrière, etc.).
Ces chiffres démentent l’affirmation d’une richesse supérieure des pensionnés. En effet, cette idée ne repose pas sur les revenus disponibles et donc le niveau de vie réel (ceux des salariés sont supérieurs). Il prend en compte le patrimoine. En particulier la propriété du logement et les avoirs financiers (épargne, assurance vie). En effet les retraités sont beaucoup plus nombreux que les actifs à être propriétaires de leur logement (7 sur 10) et détiendraient à peu près 60% des avoirs financiers. Mais il faut prendre en compte le fait que l’importance de ces ressources est pour l’essentiel le fruit de leur travail pour lequel ils ont déjà cotisé. Porter atteinte à ces réserves légitimes serait équivalent à un double prélèvement : tout d’abord, celui qu’ils ont honoré en tant qu’actif ; ensuite, celui qui leur serait imposé en tant que pensionné. Ce serait en quelques sorte une « double peine » financière.
Quelle contribution demander ?
Afin de combler, au moins en partie, le déficit du système de retraite, diverses propositions sont avancées, plus ou moins discrètement. Mais elles circulent dans les couloirs de Bercy, du ministère des Affaires sociales et entre experts. La « contribution accrue » qui serait demandée aux retraités, au nom de la solidarité nationale, pourrait prendre diverses formes :
– Il est souvent question d’une désindexation du montant des pensions sur l’inflation (une revalorisation de 2,2% a eu lieu au 1er janvier 2025). On considère qu’une sous-indexation d’un point par rapport à l’inflation des prix permettrait une économie de 2,9 milliards d’euros.
– Il est aussi question de la suppression (ou réduction) de l’abattement de 10% dans le calcul de l’impôt sur les revenus (équivalents à l’abattement pour frais professionnels des actifs). Celui-ci a été introduit par R. Barre en 1978 pour soutenir le niveau de vie des retraités à une période où les pensions étaient de faible niveau. Cela est envisagé en le limitant possiblement aux pensions supérieures à un certain seuil. Le 8 mars dernier la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a évoqué un seuil de 2 000 ou 2 500 € mensuels.
– Autre proposition possible : l’alignement du taux de la CSG des retraités (6,6%) sur celui des actifs (9,2%) ou leur rapprochement partiel. Ou l’alignement du mode de calcul des retraites pour tous sur celui du secteur privé.
– Enfin, la solution la plus drastique consisterait à terme en une diminution des pensions (comme cela est arrivé en Grèce). Du moins la menace de cette mesure pourrait être brandie comme une ultime solution afin de rendre acceptable les trois mesures précédentes.
Si elles intervenaient, de telles mesures devraient, par souci de justice, prendre en compte les inégalités présentées ci-dessus concernant les niveaux réels des ressources des retraités.
Dans le contexte actuel de crise énergétique et de renforcement de l’équipement militaire, le redressement des comptes des systèmes de retraite semble inéluctable. Le retour à 62 ans de l’âge de départ à la retraite (et à plus forte raison la promesse électorale trompeuse d’un retour à 60 ans) exigerait des mesures d’économie drastiques et/ou des ressources nouvelles que les partenaires sociaux, les partis politiques, voire la population en cas de référendum, ne semblent pas prêts à accepter4. La complexité de ce dossier et l’importance cruciale de cet enjeu exigent de tous une vigilance particulière.
Le temps des décisions courageuses est venu et l’on attend avec impatience les prises de position des principaux acteurs concernés. Ainsi, le président du COR vient d’expliciter son analyse de la situation et les mesures qu’il recommande : « L’entrée progressive, plus ou moins explicite, dans une économie de guerre, rendra secondaires sinon dérisoires les débats actuels sur l’AOD à 64 ans. La question deviendra plutôt, en ce domaine et parmi bien d’autres décisions à prendre, comment augmenter rapidement cet AOD au-delà des 64 ans décidés dans la loi de 2023… »5. On attend aussi que s’expriment les associations de retraités et tous les groupements qui se proposent de défendre les intérêts des « vieilles et des vieux ». Il faut rappeler qu’en Amérique du Nord6 comme au Danemark7, c’est précisément sur la question du niveau des retraites et plus largement du niveau de vie des « anciens » que les mobilisations ont été construites. Vieilles et vieux qui vouliez être actifs et engagés, le moment est venu de prendre la parole et de formuler des revendications pragmatiques autant que courageuses.
Pierre Lascoumes
1) Entre 1981 et 2003, la politique de retraite a connu 17 lois et 15 rapports : 1981-1991, 4 lois et 3 rapports ; 1992-2003, 7 lois et 7 rapports ; 2004-2019, 6 lois et 5 rapports ; 2020-2023, 2 lois et 2 rapports.
2) Le déficit global de la France en 2024 était de 3 228,4 milliards, soit 112% du PIB.
3) Dans l’ensemble, les retraites du secteur public sont supérieures à celles du privé car le salaire de référence est différent : les six derniers mois pour le public, les vingt-cinq meilleures années pour le privé.
4) En Allemagne, la situation démographique est très tendue. D’ici 2030, 7 millions de babyboomers seront retraités. Il y aura alors un cotisant pour un pensionné. En 2001, un projet d’épargne retraite par capitalisation a échoué. Aujourd’hui, il faut 43 ans de cotisation pour toucher 48% du dernier salaire, ce seuil devrait passer bientôt à 45 ans. L’âge de départ en retraite réel est en moyenne de 65,8 ans (avec un plafond à 67 ans). Il est aussi question de porter la cotisation salariale de 18,6 % à 22,3%.
5) Gilbert Cette, « Le débat sur les retraites doit être fructueux », Telos.
6) L’American Association of Retired Persons (AARP) est depuis cinquante ans une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis.
7) Association OR-GRIS fondée en 1986.