C’est une des particularités du moment. Alors que l’on parle sans fin de démocratie sanitaire, du patient expert, de la place et du rôle prépondérant des usagers, ces deniers paraissent parfois sans voix, en tout cas sans lieu où parler, ni débattre, ni même simplement raconter leurs expériences.
Nous sommes allés voir les premiers journaux de malades. Nous avons opéré un choix éclectique. Bien sûr, il y en a eu d’autres, avec d’autres formes d’expressions, mais en voilà quelques-uns, comme une chronique, tous nés à partir d’un mouvement social, que ce soit Mai 68 ou la reconstruction de l’après-guerre pour la psychiatrie. Des journaux où ce sont encore bien souvent les médecins qui parlent en lieu et place des malades.
Revue de presse en quatre épisodes avec, pour commencer, Tankonala Santé qui, dès les années 1970, dénonçait les inégalités sanitaires. Suivront, Mathusalem, cet objet non identifié proche de l’aventure de Charlie Hebdo qui voulait donner la parole aux vieux, puis, autour de la folie, Trait-d’union, l’historique journal de l’hôpital de Saint-Alban, suivi en 1953 par la tentative très originale du Dr Frantz Fanon en Algérie.
Tankonala Santé, premier pourfendeur des inégalités de santé
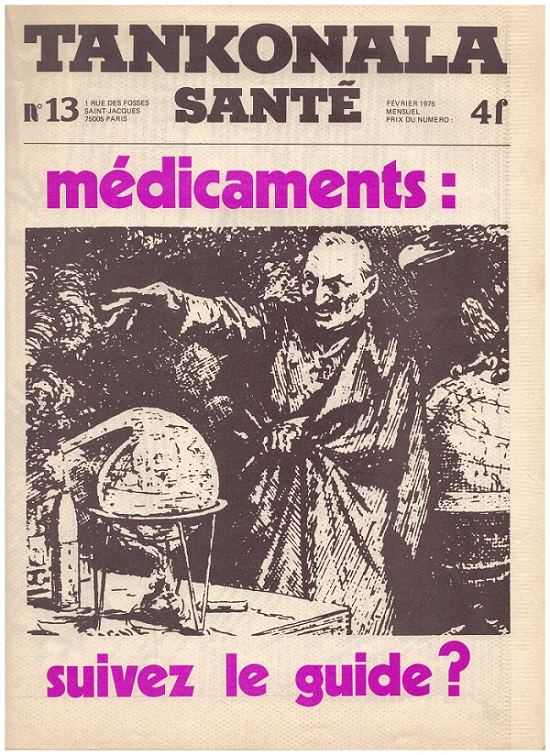
Ce mensuel, « le seul à paraître n’importe quand », eut une courte existence, vingt-deux numéros entre 1973 et 1977. Créé à l’initiative du Dr Jean Carpentier et d’une poignée de personnes, dont beaucoup étaient membres du Groupe information asiles (GIA), ce périodique constitua l’un des premiers lieux de mise en cause des inégalités de santé, agrégeant nombre des luttes dans de nombreuses institutions. Objectif : produire un discours collectif propre, celui de celles et ceux qu’on nommera vingt ans plus tard les « usagers ».
Contemporain de La Gueule ouverte (le premier périodique écologiste) et s’inspirant graphiquement de Tout et des publications féministes, Tankonala Santé est un lieu de croisement où la question est très politisée : multipliant les examens médicaux pour mettre en évidence la silicose, les maoïstes ont fait de la santé des mineurs des houillères du Nord un objet de lutte, tandis que le Groupe d’information sur les prisons (GIP) fait savoir la prison, enquête sur l’invisibilité du suicide en détention, dénonce l’« intolérable », notamment grâce au témoignage de certains médecins (telle la psychiatre Édith Rose dans la prison de Toul, dont nous republierons bientôt le témoignage). Tankonala Santé est aussi très proche des collectifs féministes qui questionnent l’éducation sexuelle au lycée. Mettant en avant le droit des hospitalisés, ce journal reprend tous ces fronts, certains y prônant même la démédicalisation totale de la société.
Extraits du n°13 (février 1975)
Nous nous battons (p.5)
« Certains (dont nous sommes) avancent que la maladie est une sorte de langage du refus, de rébellion contre la société, et que la médecine, pour une bonne part, en essayant de l’étouffer, masque le caractère pathogène de ladite société et de ses valeurs.
Oui la médecine rend malade (iatrogénèse) mais l’affirmation essentielle est celle de l’impuissance de la médecine devant une société pathogène. Ce qui ouvre une perspective d’action :
– contre les divers aspects pathogènes du monde que nous vivons, qu’il s’agisse de l’école, de l’usine, des transports, du logement, etc. ;
– pour des conditions de vie vivables.
Ainsi, nous nous battons, rédacteurs et lecteurs de Tankonala Santé entre autres, essayant de numéro en numéro de mettre en lumière les moments et les lieux où naît la maladie, et aussi en faisant connaître les actions pratiquées ici ou là par des groupes ou des individus, dans tous les domaines : revendications concernant les cadences et l’hygiène dans les entreprises, garderies d’enfants, batailles pour la libération de la sexualité, comités de locataires, lutte contre les pollutions industrielles et militaires, etc., et ceci, sans attendre l’intervention des experts et des spécialistes. Cela fait pas mal de temps que nous nous situons sur cette ligne. Les femmes du M.L.A.C., les jeunes communautaires, les travailleurs de Pennaroya, les lignards des P. et T., les signataires de l’appel des 100, les paysans du Larzac, les habitants d’Annecy, n’ont pas attendu les experts (ni Tankonala Santé d’ailleurs) pour prendre leurs affaires en main. Il reste à continuer. Jean Carpentier. »
Scène de la vie quotidienne dans un hôpital (p.11)
« Un dimanche plutôt calme : une semaine passée peu chargée en opérations et dans l’ensemble relativement peu de problèmes avec les malades. Par acquit de conscience, on décide de repasser dans le service après une très longue et très douce grasse matinée dominicale. Sur le chemin, un rayon de soleil égaie un peu la banlieue. À l’entrée, le concierge de l’hôpital lance un mot gentil : c’est dimanche.
Deux étages, et brusquement il n’est plus question de détente, de soleil, de dimanche. Ce n’est pas non plus la grande agitation d’un service dit de réanimation motivée par quelque nouvelle urgence. L’heure de la technique et de l’efficacité scientifique est passée. Claudine, l’infirmière, et Marie, la diététicienne, sont dans la salle de pansement : un peu figées de chaque côté de la paillasse, parlant d’une voix triste et monocorde. Le service est calme, pas de refuge possible dans l’activisme. Alors, nous parlons tous les trois de Christian. Ce que nous disons, peu de choses, et en tout cas nous ne parlons plus de sa tension instable, de ses vomissements incoercibles, de sa maigreur effrayante.
Nous parlons de cet enfant de 8 ans qui va mourir et que nous devons aider à mourir. Mais lequel d’entre nous accepte, lequel se résigne ? Marie la diététicienne a trois enfants qui l’attendent à la maison, et quand elle parle de Christian alité dans la chambre voisine, elle a les larmes aux yeux et la révolte au cœur. Claudine l’infirmière n’a pas d’enfants, moi, je serai père dans quelques semaines, nous ne supportons pas davantage.
Depuis vingt-quatre heures, la perfusion qui doit permettre à Christian de dormir doucement et de ne plus souffrir, et de ne pas sentir la mort le gagner, est là sur la paillasse à côté de nous. Mais il faut du courage ou de la dureté pour mettre en place cette perfusion qui va délibérément couper Christian de tout ce qui l’entoure et d’abord de ses parents. Sans doute, elle ne va pas vraiment le tuer : il va perdre connaissance, il ne sentira plus rien, il n’aura plus peur de perdre ses cheveux. Son cœur battra toujours mais il n’appellera plus sa maman : il ne demandera plus sa sucette et son chocolat. Et puis on va diminuer l’importance de sa réanimation […] car il n’y a vraiment plus rien à faire.
Son père aussi me parle de lui : il retient ses larmes. Et puis il demande lui-même qu’on fasse passer cette perfusion pour que son enfant ne se rende pas compte. Sa mère reste auprès de Christian pour les dernières minutes qui lui restent de contact avec lui. Elle lui parle avec douceur et lui donne ce qu’il demande. Pas de cris, pas d’affolement, un désespoir profond.
En repartant du service, sur les trottoirs de la banlieue, je me disais que parler de la mort de Christian et l’aider à mourir c’est aussi le problème de ceux qui travaillent à l’hôpital. J-Y Petit. »
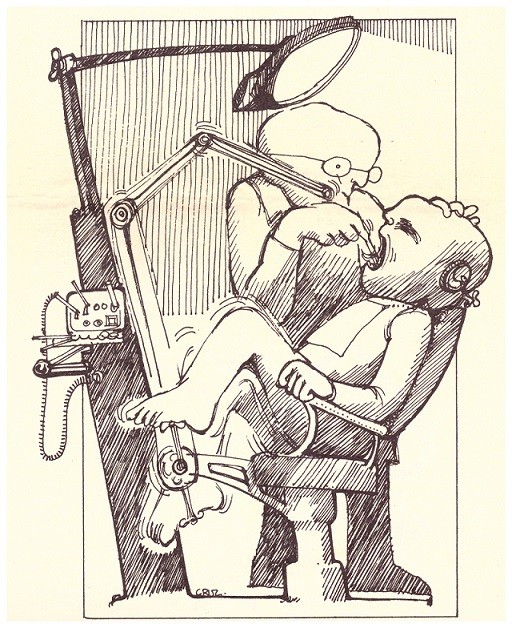
Le droit des hospitalisés (p.12)
« Objet : Remise de mon dossier médical
Monsieur le directeur,
Comme j’ai déjà pu le faire lors de l’entretien que j’ai eu avec vous, le 12 octobre 1974, j’ai l’honneur de réitérer ma demande en ce qui concerne mon dossier médical.
Mais je tiens à rappeler les faits tels qu’ils se sont déroulés : j’étais encore alité lorsque, à deux reprises, j’ai demandé au directeur de pouvoir examiner mon dossier médical. La première fois, le jeudi 19 septembre 1974, la réponse a été : “Cela fait partie de nos top secrets, ne comptez pas dessus”. La deuxième fois, le lundi 23 septembre 1974, le docteur s’est mis à crier que cela ne s’était jamais fait et que je ne l’obtiendrais pas. Sur ce, il a quitté la chambre dans une grande colère.
Voyant cela, j’ai attendu d’être sur pieds pour lui demander une troisième fois, mais par écrit cette fois. Lettre du 17 octobre 1974. Le docteur n’a même pas pris la peine de répondre…
Mais lors de ma quatrième demande, l’attitude du docteur m’a paru particulièrement déplacée. C’était le 29 octobre, au cours de la visite d’étage. À ma demande, il répond :
– Je vous ai répondu là-dessus et je n’ai rien à ajouter.
– Mais, docteur, il s’agit d’un droit pour le malade… je peux vous montrer le texte en question. Je demande mon dossier médical.
– Vous n’êtes pas propriétaire du lit. Le centre n’est pas une pension : vous pouvez nous quitter quand vous le voulez… Si vous n’êtes pas content, on peut s’arranger pour raccourcir votre séjour ici…
– Docteur, je trouve que vous dépassez les limites et que le chantage que vous êtes en train de faire est très grave.
– Si vous n’êtes pas content, vous pouvez aller vous plaindre auprès du directeur…
Je passe sur le ton employé. Cet entretien a eu lieu devant témoins.
Lors de la visite des étages du 12 octobre, jugeant toute nouvelle discussion sur ce sujet inutile, je vous faisais part de ces événements. Comme je vous l’ai indiqué ce jour-là, je vous précise que la possibilité pour un malade de demander son dossier médical n’est pas une demande excessive mais un droit. La circulaire du 20 avril 1973 du ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale le rappelle sans aucune ambiguïté : « Il est en effet constant que le secret n’est pas opposable au malade dans l’intérêt duquel il est institué ; ce dernier peut donc soit se faire remettre tout ou partie de son dossier médical, soit le faire remettre ou le communiquer directement au médecin de son choix ainsi qu’à des tiers ; il peut notamment décider de produire ce dossier en justice s’il le désire ; la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État concordent sur ce point : Cour de cassation, 28 janvier 1966 (dame Leroy), Conseil d’État, 24 octobre 1969 (sieur Gougeot), Conseil d’État, 20 juillet 1971 (sieur Pasquier). »
La Charte du malade – applicable depuis le 1er novembre 1974 – ne le rappelle-t-elle pas de la même manière ? En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander, Monsieur le Directeur, de bien vouloir me faire remettre mon dossier médical. À l’avenir, quelles mesures entendez-vous prendre afin qu’il soit possible désormais à tout malade qui le demande d’obtenir ce document ? Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes respectueuses salutations. Marc Pillet. »
Annecy M.J.C. Meythet, 9 heures sur la santé, samedi 14 décembre de 14h à 23h (p.4)
« Le 13 avril 1972, la clinique d’Argonay est inaugurée près d’Annecy ; elle appartient aux frères Tourvieille de Labrouhe. Cet “Hilton de la santé” comme le qualifient les gens du voisinage a coûté plus d’un milliard de francs anciens. Il faut se reporter au discours, prononcé lors de cette inauguration par le président du conseil général de Haute-Savoie, pour saisir les mobiles qui ont animé ces deux financiers : « C’est au cours de cette visite que nous avons bien pris conscience du but que vous vous étiez assigné. Vous avez compris que les exigences de la protection de la santé, à notre époque, demandaient la promotion, dans l’intérêt général, d’un équipement offrant aux médecins des instruments de travail modernes et aux malades la garantie médicale souhaitable. »
En fait, dans le département, tout le monde ne semble pas de cet avis. Et c’est pour avoir constitué un dossier précis sur la clinique, son financement, sa construction et son fonctionnement, pour avoir dénoncé « les passe-droits, les appuis politiques, les astuces financières utilisées par les deux frères Tourvieille » que 15 membres du Comité Vérité Justice (C.V.J.) se sont retrouvés le 13 novembre devant le tribunal de grande instance d’Annecy, pour diffamation envers la famille Tourvieille de Labrouhe.
Contre toute attente, le tribunal a décidé de relaxer l’ensemble des prévenus lors de l’audience du 13 décembre. En effet, pour les juges, ce n’est pas diffamer que de dire « que les cliniques privées à but lucratif (comme celle d’Argonay) sont des sociétés commerciales, dont le but est finalement d’obtenir un profit » (sic) sous couvert d’altruisme.
Ce n’est pas non plus diffamer que d’expliquer que la politique principale de l’administration d’une clinique est d’assurer un remplissage maximum des lits. Cette politique, comme le fait remarquer le tribunal « est malheureusement courante et est utilisée non seulement dans bon nombre d’établissements privés, mais encore dans les hôpitaux publics ». Non content d’ouvrir les yeux, les juges vont jusqu’à décrire les moyens utilisés pour obtenir un rendement maximum : il faut multiplier les hospitalisations dans les cas où la consultation externe suffirait, prolonger abusivement le séjour de certains malades, garder dans des services à prix de journée élevé des malades à prix de revient faible.
Dans cette affaire, il est vrai, le C.V.J. a eu le soutien des médecins de la clinique. Ceux-ci sont venus devant le tribunal pour expliquer que la sécurité des malades n’était pas le souci n°1 de l’administration, et qu’ils ne touchaient pas régulièrement leur honoraires. Voilà peut-être ce qui explique leur empressement à témoigner. À ce que l’on sache, bien d’autres cliniques se sont constituées et fonctionnent comme celle d’Argonay, sans pour autant entraîner de réaction au niveau du corps médical. Il n’empêche que leurs interventions ont permis de renverser les rôles, les accusés devenant accusateurs. Le C.V.J. aura-t-il le soutien de ces notables lorsque la plainte de Marcelin au sujet des clochards d’Annecy passera en justice ? Le tribunal saura-t-il condamner aussi bien les exactions de la police que l’exploitation de la santé ?
Toujours est-il que les juges reconnaissent la bonne foi des membres du C.V.J. Ce sont de « bons diffamateurs » par opposition aux « mauvais » qui ne tendent qu’à satisfaire la curiosité du public. Pour le tribunal, le C.V.J. poursuit « une cause apparemment utile à la vie de la nation et plus particulièrement à la santé des malades » puisqu’il dénonce « le système basé sur le profit ». Mieux encore, le tribunal légitime les moyens employés (tracts) pour dénoncer scandale puisque les membres du C.V.J. « ne disposent pas de journaux pour faire connaître leurs idées et leurs contestations ».
C’est à partir de faits précis : à propos des nomades, puis des clochards violemment expulsés de la commune ainsi que pour dénoncer les conditions de travail et de logement faites à des travailleurs marocains, saisonniers, forestiers, que s’est constitué, il y a deux ans, le C.V.J. à Annecy. D’horizons professionnels, religieux, politiques divers, le groupe se soude dans l’action « pour briser la mer du silence, de peur, d’indifférence et d’habitude ».
À travers le cas précis de la clinique d’Argonay, c’est tout le système de l’hospitalisation privée qui est en cause. La maladie est un marché, il s’agit de faire de l’argent sur le dos des malades. Afin de restituer le scandale d’Argonay dans le scandale de la médecine, le C.V.J. a organisé le 14 décembre : « 9 heures pour la santé ».
Des forums sur la médecine du travail, sur la médecine vétérinaire, sur le médecin tout court, ont permis à plusieurs centaines de personnes de rapporter leur expérience. Au-delà de l’utilisation qui est faite de la médecine, c’est sa signification politique qui a été remise en question. Masquant les responsabilités, les relations qui déterminent les troubles, le médecin participe à l’intoxication générale et apparaît comme l’un des remparts de l’ordre établi.
C’est sur le lieu de travail, dans sa vie de tous les jours que doivent être trouvées les solutions aux problèmes de santé et non dans une relation individuelle avec son médecin, qu’il soit médecin du travail ou médecin de famille. C’est du moins ce qu’ont affirmé les participants à cette journée, décidés à multiplier les initiatives comme celle du C.V.J. afin de soustraire la santé des mains de médecins, des hommes politiques… et des financiers. B. Cassou. »
Avis (p.2)
« Tous les jeudis de 18 h à 20 h, jusqu’en juin : au service d’Éducation permanente de Paris VII, 2 place Jussieu, Tour 46, couloir 46.45, 2e étage, salle 09, tél. au secrétariat 336.25.25, poste 51.23.
Un groupe fonctionne avec des travailleurs de la santé, de la santé mentale et de l’action sociale sur les MÉDICAMENTS :
– Leur fabrication
– Leur distribution
– Leur consommation
– Leurs effets
– Leur utilisation dans les institutions (hôpitaux, IMP…).
Sont très demandés des infirmiers psy, des infirmiers DE, des médecins, de sages-femmes, des éducateurs d’enfants, etc. »
Philippe Artières

Retrouvez tous les numéros de Tankonala Santé sur : https://archivesautonomies.org/spip.php?rubrique380