Le Pavillon des cancéreux
En 1954, peu après sa libération après huit ans d’internement dans les camps soviétiques, Soljenitsyne doit se faire soigner d’une tumeur cancéreuse. De cette expérience de la maladie, de l’hôpital et de la proximité de la mort, naîtra le roman Le Pavillon des cancéreux.
Nous sommes en 1955, la Russie commence tout juste sa phase de « déstalinisation ». Le roman se passe dans un centre hospitalier, au pavillon des cancéreux, où se mêlent différentes destinées des malades, des filles de salle ou des médecins.
Il y a Paul Roussanov, petit fonctionnaire, maniant la dénonciation comme il respire. À côté de lui, dans le lit adjacent, Kostoglotov, magnifique révolté qui fut relégué et vécut les purges staliniennes dans les camps du goulag. Il y a aussi le tendre Sigbatov, condamné à se faire emporter par sa maladie, le cynique Poddouïev, l’étrange Chouloubine, mais aussi les médecins, la charmante Lioudmila Dontsova qui, elle aussi, sera atteinte de la maladie, Vera Kornilievna Gangart, dont toute la vie est son travail, Leonidovitch, chirurgien respecté, et enfin Zoé, l’infirmière sans pudeur.
Dans ce pavillon des cancéreux, on attend, on porte le temps qui passe, on parle, on discute, on espère des traitements. Mais pour quoi faire ? Qu’est-ce qui fait vivre quand la maladie occupe toute la place ? Où s’arrête le droit de soigner ? Cela veut dire quoi guérir ? Quel est ce temps de la maladie ?
Des questions sans fin, alors que les techniques et les soins médicaux ont profondément changé. Le Pavillon des cancéreux est paru en français en 1968. Extraits.
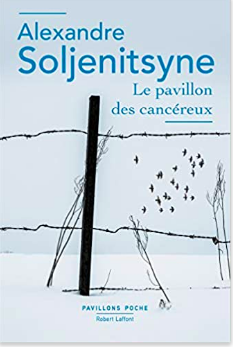
Six petits mois
Kostoglotov : « Il me suffit à moi que vous ayez fait reculer ma tumeur, que vous lui avez barré la route. Elle est en position de repli ; moi aussi, c’est parfait. Un soldat n’est jamais mieux qu’en position de défense. De toute façon, vous n’arriverez pas à me guérir « jusqu’au bout », car il n’y jamais de fin au traitement de cancer… Au début ma tumeur régressait rapidement ; maintenant ce sera lent ; alors laissez-moi partir avec ce qu’il me reste de sang. » […]
« À franchement parler, je n’y tiens pas tant que cela à la vie. Non seulement je n’en ai plus devant moi, mais même je n’en ai jamais eu derrière moi ; eh bien si j’ai la chance vivre six petits mois, eh bien il faut que je les vive. Mais planifier dix, vingt ans d’avance, ça je ne le veux pas. À trop guérir, on fait trop souffrir. Les nausées vont commencer, les vomissements, à quoi bon ? »
Guéri tout à fait
« Akhmadjan, radieux, souriait de toutes ses dents blanches.
– Où habites-tu ?
– À Karabaïr.
– Eh bien voilà, tu vas y retourner.
– Je suis guéri ?, demandait Akhmadjan épanoui.
– Tu es guéri.
– Tout à fait ?
– Pour le moment, tout à fait.
– Je ne reviendrai donc plus ?
– Tu reviendras dans six mois.
– Pour quoi faire, si c’est tout à fait ?
– Pour te montrer. »
Douleur et gratitude
Sigmatov : « Et tout cela pour gagner quelques mois de sursis et quels mois ! Des mois de cette existence pitoyable dans un coin du vestibule, mal éclairé, mal aéré. Déjà son sacrum le lâchait et seules deux mains solides appliquées derrière, sur son dos, le maintenaient en position verticale. Toute sa promenade consistait à passer dans la salle voisine pour s’asseoir un moment et écouter discuter les autres ; tout l’air, c’était ce qui venait jusqu’à lui de la lointaine lucarne ; tout son ciel, c’était le plafond.
Mais même pour cette vie indigente où il n’y avait rien d’autre que la routine des soins, les querelles des filles de salles, la nourriture de l’hôpital, les dominos, même pour cette vie-là, avec ce dos béant, à chaque passage du docteur, son regard endolori s’illuminait de gratitude. »
Éric Favereau