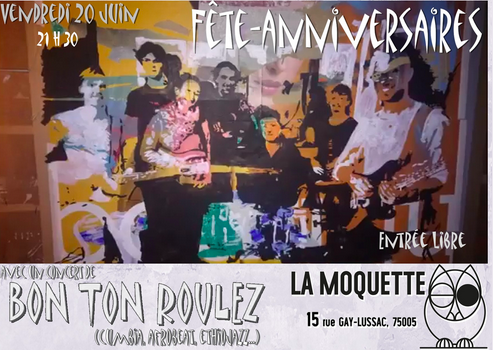
L’association La Moquette fait un travail unique. Situé rue Gay Lussac, aux pieds du jardin du Luxembourg, son local est ouvert la nuit, 5 jours sur 7, et ne propose aucun service, juste du lien, de la culture, une présence. Vieille de près de cinquante ans, cette association pose le postulat que « pour que la rencontre s’opère, il s’agit d’accueillir la personne sans la contingenter à ses seuls manques, problèmes, et de se prémunir d’une réponse aux seuls besoins matériels qui masquerait la complexité de l’autre. En choisissant, comme dans le travail de rue, de ne pas délivrer de prestation sociale, notre rôle d’intervenant social concerne la rencontre avec le sujet et non pas la recherche des réponses immédiates aux problèmes, tout en essayant de les amorcer cependant. Pour cela, il faut se rencontrer avant de se raconter, prendre la mesure de l’autre ». Voilà ce que disait, en 2004, son fondateur, Pedro Meca. Et il ajoutait : « En mettant la relation au centre de notre travail éducatif, on ne choisit pas de se positionner « contre » les intentions et missions d’accès aux droits et prestations indispensables assurées par les dispositifs d’aide et d’intervention sociales et médico-sociales. Bien au contraire, notre action n’est possible que parce qu’ils existent et que nous y avons bel et bien notre place (dans un « entre » : sur le temps du soir, entre le jour et la nuit ; entre la rue et les dispositifs) en lien avec les structures de jour et d’urgence, parce que nous sommes complémentaires… Notre manière d’envisager le travail auprès des personnes en grande difficulté de tout ordre est un enjeu culturel : nous voulons décentrer la manière de faire pour arriver à l’objectif commun des action sociales – aider au bien-être des citoyens. La différence vient dans la manière de faire. »
Il y a peu se tenait comme chaque année l’assemblée générale de La Moquette. Plusieurs d’entre nous à VIF – dont Éric Favereau, Jean-François Lae et Paul Machto – sont membres du conseil d’administration. La directrice, Narguisse Thomas, a présenté le rapport d’activité. En voilà des extraits, en particulier des pastilles de ces personnes qui fréquent La Moquette, ces invisibles qui le temps d’une soirée et le temps de quelques mots reprennent leur visage.

« Il y a Charlie, ce monsieur à la voix qui porte et à l’accent parigot qui semble venir du siècle dernier, qui ne descend quasiment jamais voir nos évènements mais reste au rez-de-chaussée sur son ordinateur ou discuter avec ses copains, pour refaire le monde, raconter des blagues ou s’épauler les uns les autres. Il vit lui aussi à la rue et refuse toute forme d’accompagnement social, il vient ici parce qu’il aime être tranquille, sans avoir à se justifier, dans un cadre convivial et sécurisant.
Il y a ce couple, Robert et Madeleine qui vivent dans un logement insalubre et traversent la ville plusieurs fois par jour, entre lieux d’accueil du réseau de l’aide sociale et lieux culturels, salles de cinéma, musées. Ils viennent à La Moquette ensemble les soirs de fête ou quand il y a un film, et lui ne rate pas un seul de nos ateliers d’écriture. Elle ne vient jamais les mains vides, nous offrant à chacune de ses visites un gâteau ou un bouquin… ou parfois des offrandes plus surprenantes, comme des couches.
Il y a Paquito, qui vit à la rue et souffre d’un désordre psychique aux manifestations exubérantes, pour qui aucun dispositif d’hébergement ou de soins ne semble adapté. Il arpente la ville et la région sans fin mais aime venir se poser quelques heures à La Moquette. Parfois pour perturber nos soirées en hurlant des insanités avec le plaisir d’un enfant qui vient de découvrir l’humour grivois, parfois pour nous raconter ses journées, nous demander de garder le contact avec sa psychiatre.
Il y a Charles-Gustave, octogénaire au look singulier de gentleman décadent venu d’une époque qui n’a pas vraiment existé. Érudit et sale gosse, capable des pires goujateries comme de vrais moments de délicatesse, il est particulièrement présent pour nos conférences, parfois pour nourrir les échanges de sa culture et de sa verve, parfois pour tenter de saborder la soirée. S’il aime nous répéter tout le mal qu’il pense de la psychiatrie, il finit chaque soirée en nous rendant témoin de la méticulosité avec laquelle il prend son traitement antipsychotique qu’il accompagne d’herbes aromatiques et légumes crus.
Il y a Sab : Sabine ou Sabrina selon les jours. Vivant à la rue, poursuivie, dit-elle, par plusieurs services de renseignement à travers le monde, Sabine aime La Moquette mais en conteste constamment le cadre, elle aime s’adonner aux jeux de société avec les membres de l’équipe de façon compulsive et y danser passionnément lors des concerts, comme s’il lui fallait profiter de chaque moment chez nous, trouvant insupportable chaque soir que le moment s’achève. Sabrina, en revanche, transforme son désespoir en une haine de tout et tout le monde, lui rendant insupportable que qui que ce soit puisse passer une bonne soirée.
Il y a Joao. Il vient depuis très longtemps à La Moquette, quasiment tous les soirs, mais descend très rarement assister aux évènements. Taciturne mais toujours attentif aux autres, il passe parfois des soirées entières à fumer à l’entrée, l’air pensif. Lui, il trouve une stabilité dans des dispositifs d’hébergement et travaille régulièrement en intérim. Mais cette année, sa vue s’est terriblement dégradée et il a mis un certain temps à sortir du déni à ce propos pour en discuter avec des membres de l’équipe, qu’il positionne comme tiers dans sa démarche de soins.
Il y a Hannah, dame britannique à l’accent à couper au couteau, qui surprend lors des ateliers d’écriture à produire des textes polyglottes ponctués d’onomatopées, ou invente des nouveaux pas de danse lors de chaque concert. Certains soirs la voient être douce et attentive avec tout un chacun, d’autres vont lui offrir des occasions de colères enfantines. Elle nous raconte autant ses voyages ou ses projets de créations artistiques, qui nous laissent rêveurs, que les nombreux complots télépathiques organisés contre elle, qui nous désemparent.
Il y a Octave qui passe de temps en temps, dans les périodes où il se sent prêt à socialiser, entre deux épisodes dépressifs où il ne sort pas de son appartement encombré. Quand il vient, il parle fort et, d’un ton provocateur, va chercher à fragiliser ses interlocuteurs, quitte à se mettre en danger. Mais il a prouvé nous faire confiance pour le contenir dans ses excès et médiatiser son envie de rencontrer l’autre.
Il y a Felix, Hubert et Damien (dont un vit à la rue, un autre dans une chambre de bonne dans le quartier et le troisième vient de banlieue assez lointaine), qui arrivent à La Moquette en fin de soirée pour continuer autour du café une conversation qui a commencé des heures avant et y inclure d’autres participant·e·s. Qu’ils parlent cinéma, politique, musique ou ornithologie, ils en arrivent toujours à la conclusion que c’était mieux avant, même s’ils sont ravis de rencontrer de la contradiction.
Il y a Jalil, jeune homme d’une vingtaine d’années qui traverse tout Paris pour arriver une heure avant l’ouverture de La Moquette, qui attend patiemment, prend soin de saluer tout le monde… et qui repart en général à peine la soirée commencée. Si la plupart du temps il observe en silence, il lui arrive de nous raconter ses galères, sa vie en foyer de jeunes travailleurs, ses conflits avec le statut d’usager de la psychiatrie, ses inquiétudes face au racisme omniprésent. Et quelquefois, quand la proposition l’inspire, il est très fier d’offrir un slam à l’atelier d’écriture.
Il y a Steven, qui a bientôt cinquante ans mais en fait quinze de moins, qui vient tous les soirs à La Moquette quand il vit dehors (entre deux périodes d’hospitalisation, en général sous contrainte). Logorrhéique, montant et descendant les escaliers en permanence, parfois plein de tendresse, parfois très agressif : la confiance qu’il a en nous l’amène paradoxalement à s’autoriser à faire de nous les responsables de tous les malheurs qui l’accablent mais aussi ses visiteurs réguliers lors de ses séjours à l’hôpital.
Il y a Anton, qui approche les 70 ans. Vit-il dehors ? A-t-il un appartement qu’il n’arrive pas à investir ? Il vit avec sa « folie », complètement assumée et à propos de laquelle il refuse toute idée de soins. S’il lui arrive souvent de parler tout seul, il est en relation avec beaucoup de gens, pour des conversations toujours décalées mais où il revient sur les maltraitances qu’il a subies enfant ou sa carrière de photographe qui l’a amené à voyager à travers le monde. Dans les ateliers d’écriture, il invente de nouvelles formes littéraires, il pose les questions les plus déconcertantes aux universitaires lors des conférences et fête chaque année son anniversaire avec nous.
Il y a Ambroise, sexagénaire à l’œil rieur, au visage poupin et à la voix grave, qui se déplace fréquemment avec un scotch sur la bouche, capable de passer de la plaisanterie potache au sermon liturgique. Il est en effet très pieu et il partage ses doutes sur les contradictions entre sa foi et sa libido. Il est en paix avec son statut d’usager de la psychiatrie et aime profiter des ateliers d’écriture pour donner vie à ses souvenirs d’enfance.
Il y a Loulou, qui approche la soixantaine mais garde le look rasta de son adolescence. Longtemps hébergé chez un ami, il est désormais à l’hôtel en attente d’un logement plus viable. Il vient souvent avec sa guitare et ne refuse jamais l’occasion de transformer les fins de soirée en bœuf musical généreux. Il est au contraire beaucoup plus sérieux quand il joue aux échecs. S’il est discret sur son suivi médical, il fait confiance à l’équipe pour parler des épisodes de décompensation.
Il y a Pierre-Yves, qui ne vient plus à La Moquette depuis quelques années, depuis qu’il est enfin stabilisé en résidence-senior. Mais il a vécu une tumultueuse relation sur le long terme avec l’association, quand il vivait à la rue ou quand il était incarcéré, et nous l’avons accompagné dans le long et complexe moment où il s’est agi de ré-habiter à l’intérieur. Il continue à nous inviter à prendre le café chez lui ou nous passer des coups de fil, inscrits dans une histoire où nous restons un repère d’affiliation sociale.
Il y a Max et Gildas qui ne se quittent pas. Un couple, un binôme, un duo ? La nature de leur relation reste une énigme. Ils sont inséparables certes, depuis de très longues années, nous le savons. Il fut un temps où ils ont ensemble parcouru le monde. Ils restent l’un comme l’autre mystérieux, pudiques sur la relation qui les unit, sur ce qu’est leur vie partagée, commune, sur le lieu où ils dorment… Max est dans la cinquantaine, Gildas semble plus âgé. Ils traînent chacun derrière eux un caddie rempli, chargé, lourd de ce qu’ils possèdent et leur permet peut-être de pourvoir à leur quotidien, quelque part, dans un espace que nous pensons, espérons, un peu protégé en dehors de Paris, mais qui n’est ni un logement, ni un hébergement. Ils fréquentent assidûment La Moquette, depuis longtemps ; une fois entrés, chacun part de son côté, vaque à ses conversations et à l’intérêt suscité par l’actualité de la presse mise à disposition ou des conférences et spectacles proposés. Ils sont tous deux curieux, avides de culture et de connaissances. Leurs journées, avant que n’ouvre La Moquette, sont le plus souvent jalonnées d’escales, d’étapes, dans les musées, bibliothèques, espaces culturels et lieux de distribution alimentaire parisiens. Accompagnés de leurs caddies.
Il y a Mathias qui est revenu cette année. Il dort dans la rue depuis sa majorité, il a aujourd’hui une trentaine d’années. Ses troubles psychiatriques rendent ses relations aux autres difficiles, les ressentant comme une source d’humiliations, de rejets ou de menaces permanentes, rendant par là-même impossible à envisager pour lui l’accès aux dispositifs sociaux et médicaux. Mais, à La Moquette, dont il attend impatiemment l’ouverture, il dit se sentir libéré de ces persécutions. Il débarque quotidiennement, sacs sur le dos et dans chaque main, et passe le reste de la soirée à lire et, depuis qu’il a investi grâce aux deniers de la manche dans un téléphone portable, à écouter des podcasts et à discuter avec une intelligence artificielle.
Il y a Chantal, une femme élégante, récemment devenue grand-mère, qui aime fustiger les notables en prenant des airs de grande bourgeoise. Une femme de goût qui aime voir la beauté en chaque chose et en chaque personne. Elle se fait une règle de prendre systématiquement la défense des plus esquintés, des plus fragiles, toute fragile qu’elle est aussi… Suivie en psychiatrie, dans la difficulté à habiter paisiblement son logement social surencombré, elle dit de La Moquette que c’est là où elle se sent bien en tant qu’amoureuse de l’art et de la culture. Elle donne aussi du fil à retordre, de la voix, quand ça ne lui va pas.
Et il y a Hafid, prof de yoga dépressif ; Gisèle qui est désormais quinquagénaire et en pension de famille mais veut rejouer à La Moquette le rôle de gamine dure-à-cuire qu’elle y avait à 20 ans ; Sergueï qui passe moins depuis qu’il a un appartement mais maintient des rituels sociaux avec les membres de l’équipe qui participent à son sentiment d’affiliation ; Fredo qui passe en coup de vent entre deux périodes d’incarcération ; Magda qui passe en fin de soirée lire le journal et discuter littérature…
Et bien d’autres, parmi les 356 passagers dont les deux tiers viennent avec une régularité certaine et entretiennent avec l’équipe et le lieu des relations diverses mais solides. »