
Le lundi 28 avril était jour de grève des médecins libéraux en colère contre d’éventuelles mesures limitant leur lieu d’installation. Un plan pour quoi faire ?
Depuis plus de vingt ans, les mesures des pouvoirs publics se succèdent pour tenter de trouver des réponses aux déserts médicaux. Ainsi, le 25 avril, François Bayrou n’a pas dérogé à la règle. Se démarquant de la loi de Guillaume Garot, député socialiste, cherchant à interdire les installations de nouveaux médecins dans les zones dites « bien dotées », le Premier ministre a dit vouloir installer un principe de « solidarité territoriale », principe qui contraindra tous les médecins à assurer quelques jours de consultations par an dans les déserts médicaux. Le gouvernement prévoyant des contreparties financières pour les praticiens qui joueront le jeu et, a contrario, des pénalités pour ceux qui s’y refuseront. Quarante-huit heures plus tard, le ministre de la Santé a semblé faire un pas en arrière en remettant en cause le principe des pénalités pour les récalcitrants.
Nous avons interrogé le professeur André Grimaldi sur cette incapacité chronique des pouvoirs publics à trouver des solutions.
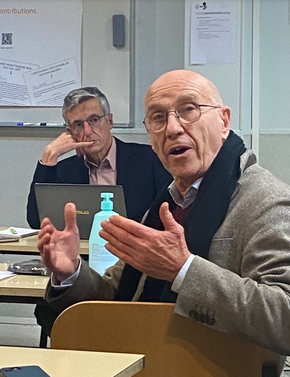
Comment réagissez-vous aux dernières annonces du gouvernement sur la régulation de l’installation ?
C’est une usine à gaz, une de ces fausses bonnes idées. Très concrètement, on voit mal comment ces mesures pourraient être appliquées. D’autant que la médecine de premier recours est une médecine d’équipe, avec d’autres personnels de santé dont les infirmières, des sages-femmes, des psychologues. Comment cela va-t-il se passer ? Ils viennent une ou deux fois par mois, ils sont là en visiteur, en touriste, puis repartent. Cela paraît irréalisable, il faut des locaux, de la biologie, de l’imagerie. Et comment vous faites selon les disciplines médicales ? Quid de la question du transport ? Et si besoin, du logement ?
Tout cela me paraît bien peu réalisable. Il est clair que cela a un autre but, celui-là bien précis et urgent : éviter la loi Garot et son article visant à réguler l’installation des médecins libéraux ou salariés ; leur installation serait octroyée de droit dans une zone qui connaît un déficit de soignants, mais dans les territoires mieux pourvus, le médecin ne pourrait s’installer que lorsqu’un autre s’en va. Pour le gouvernement, il faut à tout prix bloquer cette loi. D’où ces propositions du Premier ministre qui sont, à mes yeux, au mieux bien intentionnées et dans les faits totalement irréalistes
La médecine libérale n’est pas un monde unifié
Vous êtes contre la loi Garot ?
Non, sur le principe, j’en suis partisan. La loi est en effet limitée, elle précise que l’on ne peut pas s’installer dans les lieux où il y a suffisamment de médecins (13% du territoire), et que l’on ne pourra s’y installer que lorsqu’un collègue de la même spécialité partira. Ce dispositif n’a rien d’extraordinaire. Il existe par exemple en Allemagne, et cela depuis très longtemps. Ce dispositif y est géré par les médecins et, faut-il le noter, il est pleinement conforme avec l’éthique médicale dont l’égalité de tous devant la maladie et la mort est une valeur, en plus d’être conforme à nos principes républicains.
Je suis donc absolument pour cette loi, mais elle me semble vouée à l’échec, en tout cas aujourd’hui. Et ce, pour des raisons essentiellement stratégiques. Peut-être aussi qu’avec l’âge que j’ai, je me lasse des plans, séduisants sur le papier, mais qui sont des échecs dans la pratique. Pourquoi je dis cela ? La médecine libérale est un monde qui n’est pas un monde unifié, ni cohérent. Quand je critique la médecine libérale, je ne critique évidemment pas les généralistes qui travaillent quasi tous en secteur 1, qui exercent au mieux de leur territoire, en centre de santé ou en maison de santé, ou en cabinet. Je ne les critique pas, je les admire même. Le problème, c’est que le monde de la médecine libérale est varié, hétérogène, et d’abord au niveau des revenus. En moyenne, les médecins gagnent correctement leur vie, les généralistes gagnent certes moins de 20% que leurs collègues allemands, mais cela ne va pas trop mal, même s’ils travaillent beaucoup. En revanche, certains spécialistes libéraux, en ville ou à l’hôpital, vont gagner plus 200 000 euros par an, certains se font des fortunes, touchant même des dépassements en liquide.
Dans ce contexte disparate, comment fait-on pour que cela bouge ? Il faut casser cette fausse unité de la médecine libérale qui fige tout. Or, pour qu’une réforme à la fois de progrès pour les patients et d’efficience pour la Sécu puisse passer, il faut faire en sorte de ne pas avoir tout le monde médical contre soi. Les exemples sont légion, on l’a vu sous Marisol Touraine avec la généralisation du tiers-payant : au lieu de faire cette généralisation uniquement sur le volet Sécu, elle a voulu le faire en totalité, avec les complémentaires, rendant finalement le dispositif très compliqué, voire impossible à mettre en œuvre. Et surtout elle a dressé tous les libéraux contre elle.
Que faire donc ?
En l’occurrence, il y a des médecins libéraux qui veulent le beurre et l’argent du beurre, être conventionnés, avoir droit aux dépassements d’honoraires « avec tact et mesure » et en plus, s’installer là où ils veulent, c’est-à-dire s’installer là où les gens peuvent payer, dans des territoires déjà bien dotés. Il faut en finir avec ce front libéral si on veut pouvoir régler un jour ce problème des déserts médicaux, un front du refus qui, rappelons-le, n’a jamais rien proposé en dehors des médecins promoteurs du travail en équipe dans les maisons médicales pluriprofessionnelles. C’est pour cela que je suggère de commencer petit, en mettant le pied dans la porte. Si l’on veut avancer, il faut séparer secteur 1 et secteur 2, en commençant par appliquer la régulation territoriale seulement aux professionnels du secteur 2. Et bien sûr, en laissant les généralistes et les spécialistes en secteur 1 s’installer où ils veulent. Quant aux ultra-ultralibéraux « séparatistes » qui haïssent l’Etat et détestent la Sécu, ils n’ont qu’à s’installer en secteur 3 non conventionné, sans aucun remboursement de leurs clients.
C’est possible ?
C’est nécessaire en tout cas. Dans le front faussement uni de la médecine libérale, l’idéologie apparemment commune des syndicats de médecins libéraux accrochés au paiement à l’acte et à la liberté absolue d’installation bloque tout en effet, avec un discours ambiant qui veut faire croire que les pouvoirs publics veulent s’attaquer à leur liberté, qu’ils vont être fonctionnarisés, qu’ils vont devoir aller dans des endroits où ils n’auront rien, ni travail, ni loisirs pour leurs enfants et pour leurs conjoints. On dramatise à l’excès pour que rien ne bouge. Bref, je le redis, on ne pourra rien faire sans rompre ce front du refus. Ce sont les mêmes libéraux purs et durs qui étaient en 1945 contre la création de la Sécu, qui furent en 1958 contre la création du plein temps hospitalier dans les CHU, puis contre la convention nationale des médecins libéraux avec la Sécu qu’avait signée la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) en 1971, les mêmes qui ont imposé la création d’un secteur privé à l’hôpital public en 1958, réclamé le numérus clausus pour éviter « la pléthore médicale » en 1971, et obtenu de Raymond Barre en 1980 la création du secteur 2 donnant droit aux dépassements d’honoraires (contre l‘avis à l’époque de la CSMF mais avec l’appui de la Fédération des
médecins de France, FMF). Mais voilà, les syndicats de médecins libéraux ne veulent pas assumer leur histoire. Dommage. Il faut avancer sans eux et avec les libéraux, notamment parmi les jeunes, prêts à réviser les principes dépassés de la charte libérale de 1927. Il faut donner la priorité aux professionnels du premier recours travaillant en équipe avec les paramédicaux et les spécialistes installés en secteur 1.
Une régulation forte de l’installation serait à vos yeux vouée à l’échec ?
Je me rappelle la phrase de Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, disant : « Faire rentrer les internes dans les hôpitaux quand ils sont dans la rue, c’est aussi facile que de faire rentrer le dentifrice dans le tube dont il est sorti. » Cette mesure les mettrait tous dans la rue. Et vous voyez ce qui se passe : les spécialistes se retranchent derrière les généralistes qui se retranchent derrière les internes et les externes en médecine pour dire non à toute régulation.
C’est la chaîne qu’il faut revoir
Que va-t-il se passer ?
Rien. François Bayrou va négocier… En plus, son dispositif ne répond pas à un vrai argument qui est celui autour des conditions de travail. La médecine de ville est en retard. Aujourd’hui, la médecine s’exerce en équipe avec des assistants et des paramédicaux, et avec des liens avec les travailleurs sociaux. Les soins primaires devraient inclure les sages-femmes et les psychologues cliniciens, et doivent définir leurs relations (variable selon les compétences des MG dans les différentes spécialités) avec le second recours spécialisé. Or, les instances ont freiné depuis des années. Jusqu’en 2000, l’Ordre des médecins était très réticent au travail en équipe en invoquant le risque de « compérage ». De même l’« aller vers » était suspect de racolage. Créons des conditions de travail qui permettent aux médecins d’avoir le sentiment de faire une bonne médecine et d’avoir les possibilités d’une mobilité. Aujourd’hui, la médecine praticienne est à la fois décrite comme sans grand intérêt, accablée de tâches bureaucratiques et finalement épuisante. C’est la chaîne qu’il faut revoir. Les hôpitaux pourraient créer des centres de santé dans les territoires sous dotés, comme à Marseille dans les quartiers Nord. Vous commencez votre carrière dans un centre de santé comme praticien territorial, puis si vous le souhaitez, vous allez à l’hôpital et devenez praticien hospitalier, mais dans tous les cas, vous ne travaillez pas seul. Et au long de votre carrière, vous pouvez changer d’affectation ou de territoire.
Mais comment expliquez-vous que les syndicats, y compris ceux de gauche, soient selon vous coresponsables de cet immobilisme ?
MG France s’est créé en se séparant des spécialistes et en devenant un syndicat autonome de généralistes revendiquant de pratiquer la médecine intégrée, de soin, de prévention et d’éducation, centrée sur la personne. Il a été très vite confronté à la question de la représentativité aux élections professionnelles, et là, si vous voulez exister et faire un bon score, vous adoptez une position forcément corporatiste. On assiste à une surenchère « plus libéral que moi, tu meurs ». MG France a été et reste pris dans cette spirale. En 2015, son président, Claude Leicher, par ailleurs quelqu’un de remarquable, s’est félicité que grâce à la mobilisation de MG France, les pharmaciens n’aient pas obtenu le droit de vacciner. Un comble… De même sur le paiement à l’acte, de même sur leurs rapports de hiérarchie avec les infirmières, c’est un repli sur soi. Regardons ailleurs : en Allemagne, les médecins libéraux travaillent en équipe avec en moyenne 7 autres professions médicales, comme des sages-femmes, des psychologues cliniciennes. En France, non.
La faute aux syndicats ?
Non. À la décharge de MG France, celui-ci n’a pas vraiment d’interlocuteur. La première déclaration de Marisol Touraine quand elle a été nommée ministre a été de dire que la colonne vertébrale de notre système de santé est l’hôpital et son dossier prioritaire n’a pas été le développement des soins primaires mais les dépassements d’honoraires, dossier qui ne concerne que les spécialistes (et elle a été contrainte d’ouvrir le secteur 2 à 3 000 médecins supplémentaires !). Les généralistes ont reçu ces deux messages comme une agression, voire une indifférence à leur égard.