Dans le dossier de presse de présentation du film de François Ozon, Tout s’est bien passé, un bref résumé : « Emmanuèle est une romancière épanouie et accomplie, aussi bien dans sa vie privée que professionnelle. Un jour, elle est appelée en urgence : son père André, âgé de 85 ans, vient d’être hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout et aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir. Malgré leurs différents passés, le père s’adresse à elle plutôt qu’à son autre fille, Pascale, qui le vit plutôt mal. » Le film, comme le livre dont il est une adaptation, va montrer les difficultés comme les douleurs, pour arriver à conduire André Bernheim en Suisse où il bénéficiera d’un suicide assisté, comme le permet la loi helvétique.

Daniel Defert était un ami de longue date d’André Bernheim. Après la fondation de l’association Aides en 1984, André Bernheim, grand collectionneur d’art, s’investit dans le mécénat de Aides et les deux hommes nouent une longue amitié qui conduit Daniel à devenir l’un des témoins de la fin de vie de son ami. Nous avons été voir le film avec lui, puis recueilli son regard.
Vous avez aimé ?
J’ai d’abord relu le livre d’Emmanuèle, tout avait été élégamment dit. Dans le film, tout est plus appuyé, et j’ai été mal à l’aise, un peu gêné. Pour autant, l‘essentiel est là, c’est-à-dire la difficulté d’avoir une fin de vie digne avec la législation française.
C’est-à-dire ?
Le problème dans le suicide assisté est que l’on vous met dans une contrainte, celle d’assumer soi-même le geste. On vous fournit un produit mais il est amer, (punitif ?), dans un cadre juridique, mais il faut avoir toute sa lucidité. Or si on est pleinement maître de sa lucidité, on peut avoir encore envie de vivre. Prendre cette décision est d’une très grande violence : il s’agit de terminer une vie que l’on est encore capable de supporter. Il y a d’autre part un obstacle financier qui est souligné dans le film.
La législation française est différente ; la possibilité très récente d’avoir une sédation profonde et continue jusqu’au décès exige d’être atteint d’une maladie incurable, de connaître une douleur insupportable, d’être en toute fin de vie, un gain à somme nulle.
Michel Foucault disait qu’à l’heure de la médecine omniprésente où on vit très vieux et médicalisé jusqu’au bout, on était selon lui entré dans un nouveau régime, celui d’une mort-effacement. Les soins palliatifs sont dans cette logique. Avec le suicide assisté, ce n’est pas la mort-effacement, c’est une mort assumée, une vie que l’on arrête à un moment que l’on aurait pu prolonger. C’est très violent.
Et pour votre ami ?
Pour André, la souffrance psychique est un enjeu principal. Il est devenu dépendant, et sa femme est très malade. Cette souffrance est dominante et on le voit bien dans le film : il fait des progrès au fur et à mesure qu’il est rassuré sur sa fin de vie. Il ne faut pas oublier que c’est un cadet de la France libre qui avait rejoint Charles de Gaulle à Londres, et pendant la guerre, il est fort probable qu’il avait toujours sur lui ce qu’il fallait pour s’empoisonner. Pourquoi ne l’a-t-il pas pris, là ? Il y a dans le film, la figure du revolver, caché dans un tiroir. Je ne l’ai jamais entendu parler d’arme – sa fille n’en parle pas non plus dans le livre. Il parlait de la mort, nous en parlions. Il se trouve que je lui avais proposé de l’accompagner, car je savais que pour ses deux filles, ce serait très dur ; en plus, elles étaient ses héritières, cela pouvait compliquer. Je lui avais donc proposé de l’accompagner en Suisse, mais il se trouve que j’ai été opéré du cœur.
Donc, je n’ai pas été confronté à la réalité de la situation de l’accompagnement en Suisse. Cela s’est posé quelques années après, de la même façon, avec une de mes amies, à qui j’avais fait la même proposition. J’ai eu le malheur de dire à une amie commune que je me sentais capable de l’accompagner, mais que je ne savais pas dans quel était j’en reviendrais. Elle l’a su, je me sentais très mal, et elle n’a dès lors pas voulu que je l’accompagne pour m’en protéger.
C’est d’ailleurs à cette occasion que j’ai découvert que les médecins français étaient bien hypocrites, car les médecins de cette amie avaient tous tenu un discours apparemment compréhensif, mais tous s’étaient défilés pour l’aider concrètement. Son médecin traitant cherchant même, chez elle, si elle ne cachait pas de la morphine. On ne peut pas trop se fier à leur parole, avec la législation française qui les contraint.
Y a-t-il un lien avec ce que vous avez vécu comme président de Aides ?
André a été un acteur de Aides. Mais je ne pense absolument pas que ses années sida ont pu jouer dans sa décision. Il n’était pas concerné. Et puis pendant ces années terribles, les gens qui mouraient du sida étaient jeunes, ils avaient un désir de vivre, ils militaient pour les traitements, et non pour l’accès aux soins palliatifs. C’est vrai qu’historiquement, c’était concomitant, les soins palliatifs apparaissant en 1983 en France, en même temps que le sida. On avait des contacts, alors, avec le monde des soins palliatifs, mais je le redis, il n’y avait pas de demandes, les malades avaient 30 ans, ils voulaient vivre.
Pourquoi vous êtes-vous proposé pour accompagner votre ami André ?
Je l’ai proposé car je pensais avoir recours au suicide assisté pour moi-même, mais je me suis rendu compte que ce ne n’était pas très facile. Dire « à telle date, j’arrête » dans un cérémonial socialisé, pas dans un raptus, c’est très dur. C’est pour cela que je me suis résigné à la sédation – dont je ne sais rien –, cela paraît plus léger pour le patient, ce n’est pas lui qui fait le geste, il est assisté.
Mais aujourd’hui, la sédation a du mal à se pratiquer, je l’ai ressenti quand j’en ai parlé lorsque j’étais récemment hospitalisé pour une opération à haut risque, où les jeunes médecins ont fui la discussion. Tout de suite, on médicalise, même on psychiatrise le comportement – le médecin prescrit des antidépresseurs, c’est dire combien culturellement le suicide en Occident est encore un geste qui suscite et respect et condamnation. Il reste moralement inacceptable. Et je dois dire que l’interprétation d’Hanna Schygulla en responsable associative suisse dans le film est, de ce point de vue, remarquable.
Vous dites que c’est peut-être trop dur pour les autres d’accompagner ainsi en Suisse…
André était juif, après la Shoah, comment vouloir provoquer ou donner la mort ? Il ne faut pas que ce soit un trop proche qui accompagne car c’est vraiment difficile. Désigner une personne de confiance comme le permet la loi en France ? Je crains que cela soit un cadeau empoisonné pour la personne.
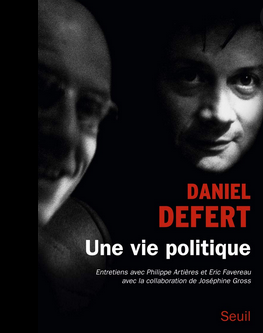
Mais là, « tout s’est bien passé » ?
Cela a failli jusqu’au dernier moment mal se passer. On voit toutes les oppositions, celles du corps médical, celle de la loi, de la police, et l’opposition religieuse – à travers les personnages des cousines new-yorkaises et des ambulanciers musulmans. D’ailleurs, j’ai été un peu déçu que dans le film, la policière n’ait pas été restituée dans toute son humanité, car dans la réalité, lors de la convocation d’Emmanuèle et Pascale au commissariat avant le départ en Suisse, la policière a évoqué le souvenir de son frère, mort dans d’horribles souffrances, et a exprimé sa compréhension aux deux sœurs. `
Recueilli par Éric Favereau et Philippe Artières