C’est quoi l’accompagnement des patients à l’autonomie en santé ? Quel est le rôle des associations, aujourd’hui faiblement reconnues alors que les besoins explosent ? Que veulent-elles ? Être des partenaires « réguliers », car comme dans la chanson, elles sont dotées « d’une bonne dose de savoir-faire » ? Tentons d’en faire le point.
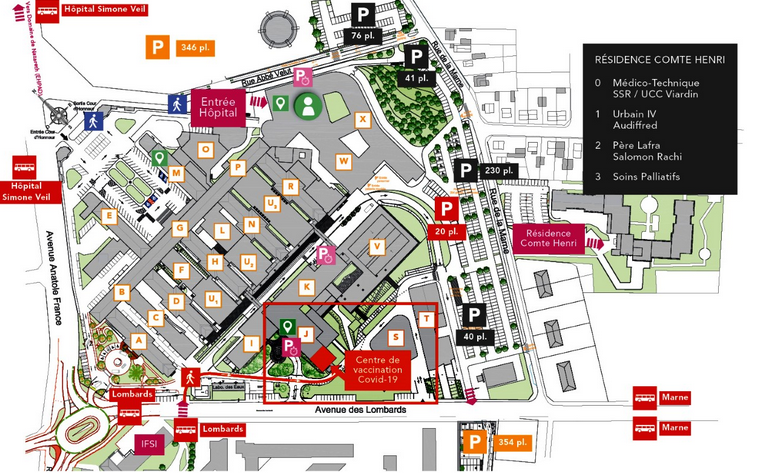
De nombreux défis
D’abord un constat : notre système de santé reste structuré par une manière ancienne d’appréhender la santé : celle des cas « aigus », susceptibles de trouver des solutions à l’hôpital plutôt qu’en ville. Aujourd’hui, les besoins sont totalement différents. Nous vivons une explosion des maladies chroniques : un peu plus de 12 millions de personnes relèvent du régime des Affections de longue durée, et 44% des Français prennent quotidiennement un traitement. Soit près d’un Français sur deux. C’est dire l’étendue et la portée des besoins.
Au moment où nous avons donc besoin du « virage ambulatoire », il y a de moins en moins de ressources médicales disponibles en proximité des patients et ces derniers sont parfois victimes de longs délais d’attente dans de nombreuses spécialités médicales (ORL, dentaire, ophtalmo, explorations par imagerie médicale, etc.) Autrement dit, les malades sont en ville et les soins sont à l’hôpital et/ou de plus en plus difficilement accessibles.
La deuxième donnée importante est l’accompagnement des patients. Pour vivre avec la maladie, il faut non seulement des soins, mais il faut aussi, parfois, des accompagnements. Leur temporalité n’est pas la même. Hermès, le dieu de la vitesse, gouverne les soins. Chronos, le dieu du temps long, gouverne les accompagnements. Les patients le savent bien : avec la maladie chronique, il faut s’attendre à vivre dix, vingt, trente ans avec des traitements et à fréquenter assidument le système de soins. C’est un bouleversement considérable qui provoque bifurcations et ruptures dans le cours d’une vie : perte d’emploi ; réorientation professionnelle ; rééquilibrage des priorités personnelles, familiales et amicales ; vie amoureuse et affective parfois chamboulée ; retentissement des traitements et des dispositifs médicaux dans la vie courante…
La troisième donnée, c’est la contrainte financière qui pèse sur le système de santé, et sur l’ensemble de la Nation d’ailleurs, qui doit faire face à plusieurs priorités. Contrainte financière sur le système de santé qui mobilise un peu plus de 310 milliards d’euros par an, soit 4 600 euros par habitant, selon des chiffres récents de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES). Et ceci, sans compter la valorisation des tâches accomplies par les aidants familiaux ou les proches aidants, ni les actions conduites par les très nombreuses associations de patients qui déploient des programmes de prévention et d’accompagnement face aux maladies, souvent sans autres moyens que ceux de la générosité du public et de la valeureuse mobilisation de leurs bénévoles. En clair, notre pays va être amené à faire des choix de plus en plus drastiques pour sauvegarder l’équilibre de ses comptes.
Comment y faire face ?
Laisser faire ou investir ? Laisser faire, c’est continuer à privatiser le système de santé car nul doute que le marché s’emparera des besoins. Ce scénario se dessine déjà. Les assurances complémentaires développent des accès privilégiés à la téléconsultation pour leurs adhérents. Les pharmacies s’équipent de télécabines, en ordre dispersé et sans grandes garanties de qualité : inaccessibles aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap ; souvent dépourvues de professionnels pour guider ou aider le patient ; implantées sans schéma répondant à un quelconque diagnostic territorial. Des plates-formes téléphoniques de conseil en santé apparaissent aussi, parfois en lien avec des laboratoires pharmaceutiques. Enfin, dans les grandes villes, des « coachs santé » ouvrent des cabinets privés prétendant offrir aux patients une sorte de soutien-accompagnement, sans contraintes déontologiques ni réglementaires sur la base de diplômes d’université aux contours incertains.
L’autre scénario est celui de l’investissement public dans l’accompagnement des personnes à l’autonomie en santé. À la vérité, il faudrait parler d’investissements au pluriel.
Investir conceptuellement, d’abord. En actant que le virage ambulatoire nécessite d’être adossé à des services d’accompagnement à l’autonomie en santé. Laquelle, pour souhaitable qu’elle soit, ne résulte pas d’un choix binaire : autonome ou pas. Une vie avec la maladie, surtout dans la durée qu’embrasse une maladie chronique, ce sont aussi des allers et retours entre capacité à être autonome, volonté de l’être, fatigue à ne pas l’être et souhaits d’être pris en charge. Pour que chacun soit au mieux de ce qu’il peut (ou veut) en tant que responsable de sa propre santé, encore faut-il mettre en place des lieux, distincts des établissements de soin, au sens du cure, et où l’on peut offrir des soins, au sens du care. Notre pays a commencé à le faire. Dans les domaines de la réduction des risques pour les usagers de produits psychoactifs, du rétablissement des troubles psychiques, ou encore de la santé sexuelle. Il faut maintenant un changement d’échelle, vers une offre bien plus diversifiée et qui dépasse la mise en place de simples dispositifs d’appui à la coordination des soins.
Investir méthodologiquement, tout autant. C’est aussi ce que notre pays vient de faire avec les expérimentations des programmes d’accompagnement à l’autonomie en santé. Le rapport final de ces expérimentations a été remis au Parlement. Il montre que l’efficacité de tels accompagnements repose sur la conduite de trois démarches conjointement : la participation active des personnes concernées, l’action sur les services de santé dans une visée adaptatrice ou réformatrice, et la réduction des inégalités de santé. Il est particulièrement remarquable, dans le contexte de contraintes évoquées plus haut, que la France aboutisse ainsi à repérer un cadre méthodologique universel pour l’accompagnement en santé. Sans gommer l’originalité ou la spécificité de missions, de métiers, de compétences ou d’approches, comme la santé communautaire, pour ne prendre que ce seul exemple.
Il faut aussi investir règlementairement. Surtout si l’on veut éviter les dérives marchandes relatées dans le premier scénario. Ici encore, notre pays a commencé à le faire en 2009, à l’occasion de la consécration légale des programmes d’éducation thérapeutique dans la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Au sein de cette loi, un article s’est intéressé aux actions d’accompagnement… sans rien en faire. Aucun décret ou arrêté, ni référentiel n’est venu donner corps à cette perspective. L’État a choisi de passer plutôt par les expérimentations en 2016. Maintenant que le rapport de ces expérimentations a été remis au Parlement, on peut difficilement soutenir que nous n’avons pas la matière pour en déduire un cadre règlementaire protecteur pour de tels programmes d’accompagnements à l’autonomie en santé.
Enfin, il faut investir financièrement. Des choix sont proposés dans une étude conduite par le ministère de la Santé et de la Prévention et jointe au rapport remis au Parlement. Une objection pourrait surgir : qu’allons-nous gagner collectivement en regard d’un tel investissement ? L’objet des expérimentations n’était pas de démontrer leur efficience. Mais nous pouvons largement la postuler dès lors que l’on augmente les savoirs des personnes, que l’on pousse à adapter et réformer l’offre en santé et que l’on diminue les inégalités de santé. Ces critères du mieux disant médico-économique sont bien apparents dans les expérimentations. Et si l’on choisit de confier la généralisation de tels programmes au secteur associatif, comme notre pays l’a déjà fait pour les établissements et les services dédiés aux personnes en situation de handicap, la mobilisation de bénévoles, moyennant des formations adaptées, peut aussi conduire à réduire les coûts.
Nous avons déjà engagé tout ou partie de ces quatre investissements. Il serait fâcheux, stratégiquement et économiquement, de s’arrêter au milieu du gué. Au surplus, renoncer maintenant serait apporter un démenti à la promesse démocratique de l’expérimentation légale comme une voie d’accès à l’innovation réformatrice.
Christian Saout