L’asile des vieillards de Saint-Pierre vu par un visiteur en 1890
En 1895, après trois années comme vice-recteur de La Martinique, Louis Garaud rentré en France, publie un volume rassemblant diverses études et observations de la vie sur cette île française de la Caraïbe. L’auteur décrit les paysages, les habitudes et coutumes locales, le carnaval, mais aussi les différentes institutions. Dans le chapitre 32 de son ouvrage, il fait le récit de l’asile des vieillards. L’intérêt de ce document est multiple : d’une part, moins de dix ans après la visite de Garaud, la ville de Saint-Pierre est ensevelie sous la lave suite à l’éruption de la Montagne Pelée qui débuta le 23 avril 1902. On dispose de peu de description aussi précise de cette institution qui disparut dans la catastrophe. D’autre part, il constitue à la fois une représentation par un fonctionnaire de la vieillesse et de sa prise en charge mais aussi une représentation par un Français des vieilles et vieux Antillais. Il faut donc lire ce texte comme l’archive d’un regard et on ne manquera pas de noter combien en Martinique en 1892, ou parfois aujourd’hui, malades, vieux et inégaux sont considérés comme des enfants.
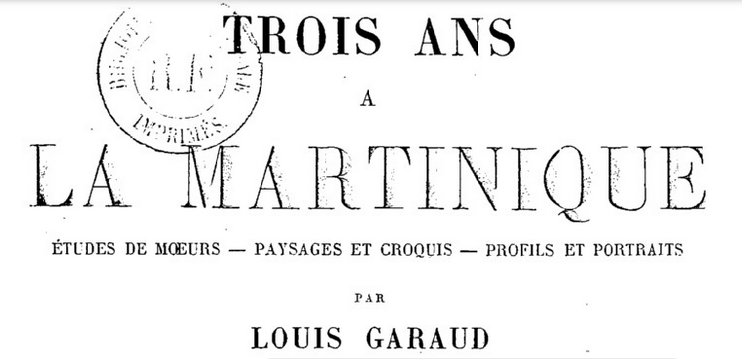
Extrait
… Aux pieds du morne d’Orange, au centre du populeux quartier du Mouillage, l’Asile des Vieillards occupe une vaste étendue que longent la rue de la Raffinerie et la rue de l’Équerre. Le Mouillage est peuplé surtout de pauvres gens, ouvriers et tâcherons, qui habitent ces quartiers bas, dans des maisons exiguës et rapprochées, au fond de rues étroites où grouillent des nichées d’enfants à peine vêtus, et où, sur le seuil des portes, sont accroupis des vieux qui se réchauffent au soleil. C’est à tous les souffreteux que l’asile est ouvert quand la vieillesse et la maladie les y conduisent. Ne croyez pas que cet asile offre le triste aspect d’un hôpital. Ce n’est pas une maison lugubre dont le portail ne s’ouvre que pour laisser entrer des malades et pour faire sortir des morts. On y entre quand on veut ; on en sort à son caprice. Personne ne s’inquiète de savoir ni qui vous êtes, ni d’où vous venez. Il suffit que vous souffriez. Au lieu de cours sévères, de couloirs silencieux, de dortoirs immenses et nus, il y a des galeries ouvertes et des chambres aérées où le soleil vient rire dans l’ombre chaude ; il y a un vaste jardin central avec des parterres, des bassins, des jets d’eau, de la fraîcheur, de l’éclat, toute la poussée d’un printemps. Rien n’y inspire aux vieillards des sentiments d’appréhension ou des idées de tristesse. Ils vont au terme de la vie doucement, sans y penser, en regardant le jardin, penchés au-dessus des plates-bandes fleuries, des allées en zigzag, des touffes de jasmin, du parfum des roses, du bruit de l’eau jaillissante, des longs alignements d’œillets, droits sur leurs tuteurs, en dépit de ce soleil effronté de La Martinique. Voilà l’asile. On y accueille les vieillards épuisés. On leur donne un lit, un médecin et des soins. Et, pour endormir leurs souffrances, une femme vient s’asseoir à leur chevet. Cette femme qui a consacré sa fortune à soulager les misères, qui s’est faite spontanément sœur des pauvres et infirmière des malades, est fort simplement vêtue. Sa simplicité, qui est voulue, n’a pourtant rien d’étudié. Sa figure est pâle, un peu allongée, sans rien d’ascétique. Ses cheveux d’argent, avec des reflets fauves, sont aplatis sur son front et roulés par derrière en torsades lourdes. Son regard est droit. Son front, que ne plisse aucune amertume, reste toujours uni. Elle est active et laborieuse, sans éclat et sans bruit. Dans cette vaste maison, elle voit tout et elle voit bien. Le surnom familier qu’on lui avait donné, quand elle était encore enfant, lui est resté. On l’appelle Madone, à cause de la douceur de ses yeux, de la gravité de sa démarche et surtout à cause de l’ovale pur de son visage. Elle appartient à une des plus vieilles familles de La Martinique dont l’hospitalité est une vertu héréditaire. La maison de son père, autrefois si remplie, a été dépeuplée par le temps, par le malheur et par les accidents de la vie. Dès lors, Madone s’étant trouvée trop seule, appela à elle toutes les misères et toutes les souffrances. Dans son asile, on reçoit les vieux, les paralytiques, les aveugles, les gangrenés. On les loge, on les nourrit, on les soigne, on les fait vivre. Et s’ils meurent, ils entendent au moins une parole consolante et ils savent qu’une main amie leur fermera les yeux. On leur donne, au cimetière, un coin tranquille, mais non pas oublié. À cet appel de la charité privée, ils sont venus en foule, à la file, tous ces vieux loqueteux, entraînant à leur suite la lassitude, les amertumes, les révoltes, les plaies du corps, et aussi parfois les vices et leur triste cortège de maux. Madone a pour chaque vieillard un lit prêt et une chambrette propre. Elle lave et bande leurs plaies sans fatigue, sans dégoût, toujours sereine. Elle a voulu me montrer elle-même la maison de ses pauvres. L’asile, vu du jardin intérieur, a la forme d’un rectangle dont un des grands côtés sert de mur de clôture. Il n’a qu’un étage, élevé sur la façade et sur les deux ailes. Des galeries superposées entourent intérieurement l’étage et le rez-de-chaussée, servent de dégagement aux chambres, et de long promenoir aux aveugles qui viennent y baigner, dans la clarté du jour, leurs yeux morts. Sur le parcours des galeries, je rencontrais des vieillards qui allaient et venaient le long des balustrades, comme des écoliers qu’on laisse libres. Madone leur adressait, en passant, un mot ou un sourire.
– Le mal, me disait-elle, c’est que mes visiteurs leur donnent parfois de l’argent ; alors ils sortent, ils boivent et ils rentrent malades, ces grands enfants !
– Sont-ils reconnaissants ? ai-je demandé. Elle m’a regardé avec un sourire de sainte : « Écoutez », dit-elle ; et se tournant vers un malade dont le visage bouffi et les membres gonflés trahissaient des habitudes invétérées d’ivrognerie, elle lui dit :
– Eh bien ! Ambroise, êtes-vous aujourd’hui plus content qu’hier ?
– Non, répondit-il sèchement.
– J’ai pourtant recommandé qu’on vous servît ce matin un petit verre de vin de Madère après déjeuner.
– Je veux du tafia et non du madère. Et il nous tourna le dos en bougonnant.
Elle se hâta d’ajouter : « II y en a de bons et de reconnaissants. Il y en a d’autres qui me quittent avec colère, mais ils ne tardent pas à reprendre le chemin de notre asile toujours ouvert. Voyez leurs couchettes. Les fenêtres donnent sur la rue ; les portes ouvrent sur la galerie. Chaque chambre contient deux lits. Je n’ai pas voulu installer de grands dortoirs : ils sont attristants, désespérants même. Je n’ai pas voulu non plus condamner mes pauvres à l’isolement. Je les place deux par deux lorsqu’ils se conviennent ; je les sépare quand ils le demandent ; je les laisse seuls s’ils le souhaitent. Enfin, j’évite toujours de leur donner le spectacle de l’agonie et de la mort des autres malades. »
Madone insista pour me faire visiter la chapelle de l’asile. […] Je visitai dans ses détails la pharmacie et la chambre à bains avec ses douches admirablement installées.
– Qu’est-ce cela ? demandai-je en entrant dans une salle garnie de bancs adossés aux murs.
– Ah ! j’oubliais, me répondit Madone : j’ai des malades externes, comme j’ai des pensionnaires. Les externes aimant mieux vivre au dehors, ne viennent qu’aux heures des consultations. Je leur donne gratuitement les remèdes prescrits par notre médecin.
– Quelle sublime charité ! m’écriai-je.
– Ne dites pas cela, dit-elle, Dieu a dit : « Laissez venir à moi les petits enfants. » J’imite son exemple et je fais venir à moi les vieillards qui sont aussi des enfants. Je l’interrompis : Attirer les petits enfants, c’est avoir près de soi les cheveux d’or, les joues rieuses et les yeux innocents. Mais en appelant à vous la vieillesse courbée, flétrie, désespérée, avec des plaies, avec des vices, gangrenée parfois dans l’âme comme dans le corps, vous avez choisi la plus triste part, celle qui exige le plus complet renoncement de soi-même. Prenez garde ! Vous êtes meilleure que Dieu.
– Oh ! ne blasphémez pas ! reprit-elle aussitôt. Vous me causeriez un chagrin profond. Elle cueillit quelques œillets et me les offrit en disant : « En souvenir de l’asile ! Quant à moi, je ne suis rien, oubliez-moi ; mais souvenez-vous du bon Dieu des pauvres gens. »
Philippe Artières
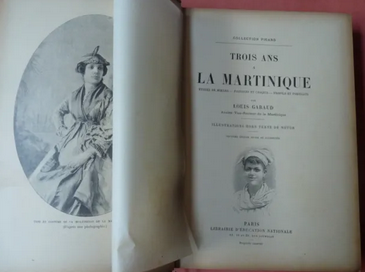
Louis Garaud, Trois ans à La Martinique, études de mœurs, paysages et croquis, profils et portraits, 2e édition, revue et augmentée (1er janvier 1895)