
Bruno Falissard est mathématicien, psychiatre et responsable d’une importante unité de recherche en santé publique. VIF échange souvent avec lui. Récemment, il est venu débattre de la notion de neurodiversité.
La neurodiversité est un concept souvent utilisé par les mouvements sociaux combattant le capacitisme pour faire connaître des différences au sein de l’espèce humaine et les faire accepter en tant que variabilités neurologiques. Elle est souvent comparée à la biodiversité, la concomitance de plusieurs types de fonctionnements neurologiques chez l’être humain étant vue comme indispensable dans les sociétés. Issue des neurosciences, également portée par des psychiatres, cette notion est aujourd’hui souvent présente en France. Mais pour dire quoi ? Un mouvement identitaire ? Un mouvement de destigmatisation ? Une simple mode ? Et quelles en sont les conséquences ?
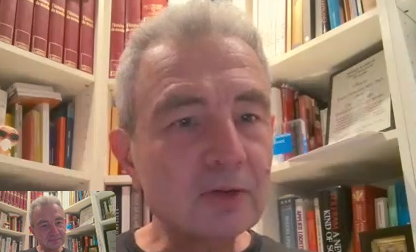
Deux mots collés, neuro et diversité
« La neurodiversité est un sujet passionnant. C’est d’abord un mélange de deux notions. Commençons par la fin : la diversité. Dans nos sociétés, on assiste à une certaine esthétisation de la diversité. La diversité est valorisée, ce serait bien d’être différent, d’être divers. Il y a foule d’explications pour rendre compte de cet air du temps, mais en tout cas cela n’est pas sans effet dans l’univers de la médecine, et bien sûr dans celui de la psychiatrie en particulier.
D’abord, rappelons que quelqu’un de malade est quelqu’un de différent. Cela ne l’a pas toujours été. Nous avons longtemps vécu avec le paradigme de la maladie aigüe ; la personne est malade, voire très malade, on la traite, elle est guérie. Et elle redevient normale. Donc elle n’est plus différente. En tout cas, la différence était noyée dans le constat de la douleur.
Arrivent les maladies chroniques. Le paradigme devient plus compliqué, on va certes continuer à dire qu’elles sont malades, qu’elles ont une maladie que l’on va dire chronique, en même temps notons qu’il n’y a pas de définition consensuelle de ce qu’est une maladie chronique. C’est de fait compliqué ; il y a des maladies chroniques que l’on se met à guérir, comme l’hépatite C, et d’autres pas encore, mais peut-être le seront-elles demain, comme pour le VIH. Et quid du cancer du sein ? Est-ce une maladie chronique ? Ou bien en guérit-on ? Ce n’est pas simple.
On change de mots pour atténuer d’éventuels effets
Un désordre supplémentaire surgit avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et sa définition de la santé et du handicap. Une maladie chronique est-elle un handicap ? Que répondre, si ce n’est que c’est une inadéquation entre l’homme et la société. Un flou conceptuel s’installe. Au final, on est face à une espèce de mélange compliqué, avec un manque de définition des termes. Certains appellent cela le tapis roulant des euphémismes, c’est-à-dire que l’on change de mots régulièrement pour atténuer d’éventuels effets. Et cela se termine par le constat que l’on ne sait plus trop de quoi on parle.
Vous me direz que tout ce débat – pour les somaticiens en tout cas – n’a pas trop d’importance. Les cancérologues ? Ils s’en moquent, cela ne change pas leur pratique car ils ont leurs traitements. Mais pour autant, même pour eux, il y a la question de l’après cancer ; est-on dans la chronicité ?
En psychiatrie, c’est plus compliqué. Il y a des situations cliniques aigües, comme les attaques de panique, certains états dépressifs, et même dans la schizophrénie, il peut survenir des moments aigus, mais en tout état de cause il y a, tout du long, de la chronicité. Et comme on touche au fonctionnement psychique, il est encore plus difficile de dire si c’est un handicap. D’ailleurs, dans le classement international des pathologies psychiatriques – le DSM –, on ne parle pas de maladies mais de troubles, manière de reconnaître que l’on ne voit pas trop ce que c’est.
Quand tout cela a-t-il commencé ?
Dans les quinze dernières années, ce qui a le plus amélioré le soin en pédopsychiatrie, c’est la… présence publique de Greta Thunberg, avec sa militance, son tempérament, sa différence… Avant elle, l’annonce d’un diagnostic d’autisme était perçue comme un désastre, maintenant on peut se dire que notre enfant est comme Greta. Et c’est vrai, l’enfant autiste est un enfant différent, ils sont même devenus des héros dans les séries télé. Cela peut certes poser des problèmes aux parents, mais pour nous, psychiatres, qu’est-ce que cela change ? Le patient nous dit, « Je suis différent », on lui dit « oui », et on ajoute : « Si tu ne vas pas bien à cause de ta différence, alors on va en parler et je suis là pour cela, je suis là pour gérer et t’aider sur tes problèmes liés à ta différence. » De fait, pour moi c’est exactement ce que je faisais avant.
Il y a un seuil où les autistes ne sont pas comme Greta
L’autisme
Est-ce que, pour autant, l’autisme est une maladie ? Un handicap psychique ? Une simple différence ? Dans les faits, ce n‘est pas trop le problème… Sauf qu’il y a un seuil où les autistes ne sont pas comme Greta. Il y a des formes d’autismes terribles, automutilateurs, d’enfants barbouillant les murs de leurs excréments. Et là on est loin des séries télé, ce n’est plus comparable avec Greta. Et c’est là que j’introduis la notion de rupture phénoménologique. Oui, l’autisme est une différence, mais à un moment donné, cette différence n’est plus supportable, car il y a une rupture dans l’existence. Ce sont des situations où ce n’est plus possible de ne rien faire, car c’est invivable pour la personne comme pour les proches. Du coup, oui, passé ce seuil, je l’appelle une maladie.
En somme, on pourrait dire qu’Il y a un autisme qui est une différence qui est comme celle d’être gaucher ou homosexuel, c’est une façon différente d’être au monde. Mais dans l’autisme, contrairement à d’autres différences, il y a un seuil de différences où la vie n’est plus possible. Et l’on a besoin, là, d’un médecin qui s’appelle un psychiatre. Sur cette analyse, j’ai le sentiment que l’on commence, entre nous, à avoir un consensus, une esquisse de convergence.
Et neuro, alors ?
Oui, c’est là qu’arrive le deuxième mot, neuro. Dans neurodiversité, le problème que l’on rencontre n’est pas tant autour du mot de diversité mais celui de neuro. On retrouve ça de façon particulièrement sensible en pédopsychiatrie avec la notion de troubles du neurodéveloppement (TND).
Ce mot vient bien sûr de nos amis les neurologues, ce qui est normal. Dans les années 1970-80, le spina bifida, l’épilepsie, la cécité, tout cela était considéré par les neurologues comme des troubles du neurodéveloppement. Aujourd’hui, bizarrement, tout ce qui est typiquement neurologique chez l’enfant n’est pas un « trouble du neurodéveloppement ».
C’est Michael Reuter – un grand pédopsychiatre britannique en conflit chronique avec la psychanalyse, mort l’été dernier – qui est à l’origine du concept. Il introduit tout d’abord les troubles du psychodéveloppement dans la CIM 10, et en 2005, dans la 5e version de son fameux manuel, il inclut les troubles du neurodéveloppement, reprenant la même définition qu’il donnait quinze ans avant pour les troubles du psycho-développement. On est vraiment dans la rhétorique. Pour lui, les TND sont un « anomalie du développement du système nerveux central […] conduisant à un comportement déviant ». C’est une façon de penser qui n’est pas si inhabituelle en fait. Pour des neurologues qui s’inscrivent dans le courant Bernardien par exemple, ou pour des philosophes comme Boorse qui développe le concept de « design d’espèce ». Par exemple, les guépards ont un « design » qui leur permet de courir vite, ça leur permet de chasser et c’est comme cela qu’ils survivent. Pour nous humains, notre « design d’espèce » c’est le langage et la socialisation, cela nous permet de survivre et de prospérer. Si on perd cette aptitude cela pose problème, on est par définition en mauvaise santé. Autrement dit, si on perd notre design d’espèce, surgit alors une sorte de déviance. Et le soin viserait à corriger cette déviance. C’est une façon de voir les choses et en psychiatrie, on la retrouve avec par exemple des thérapies très précoces pour traiter certains TND. Est-ce bien ou mal ? C’est une autre histoire et, à vrai dire, je n’en sais trop rien.
Reste qu’une tension apparaît forcément ; en effet si Greta est considérée comme une personnalité avec un fonctionnement cognitif déviant (puisqu’elle a un TND, c’est elle qui le dit), alors on se doit de la remettre dans le droit chemin avec, avec un poil de provocation, une thérapie de conversion. Et elle ne serait plus Greta…
La notion de neurodiversité pose les mêmes problèmes conceptuels que celle de TND. Les deux sont des oxymores : le côté « neuro » est implicitement normatif alors que le côté « diversité » rejette toute normativité. Enfin, je vous livre une anecdote, il m’arrive de m’entretenir avec des auto-représentants d’associations d’autisme. Un jour, je discute avec l’un d’entre eux et je lui demande quels sont les critères pour être membre de leur association. Il est alors embarrassé et me dit que certains proposent de faire des tests, mais c’est terriblement médical, d’autres disent qu’il suffit de se déclarer autiste. Et au final, il le reconnaît, dans l’association, certains membres ne sont pas autistes et profitent de ce statut un peu à la mode. La notion de neurodifférence autistique ? On ne sait pas ce que c’est, personne ne peut vraiment le définir.
Médecin du cerveau ou médecin de l’intériorité ?
Une mode ?
On peut se demander pourquoi ce terme de neurodiversité a eu tant de succès. Une des explications vient d’un contexte plus général : dans nos sociétés, en médecine en particulier et également en psychiatrie il y a un malaise avec l’intériorité de l’humain. Dire ainsi dans une faculté de médecine que tous les êtres humains sur terre ressentent qu’ils ont quelque chose que l’on appelle une vie intérieure, une âme, un esprit, peu importe, si vous dites ça tout le monde va vous regarder avec les yeux ronds, on ne parle pas de ça… Alors que lorsque quelqu’un est malade, cela va bien sûr avoir des conséquences dans son intériorité. Il y a même des maladies où c’est principalement l’intériorité qui est atteinte, et c’est alors la psychiatrie qui sera appelée pour la gérer.
Mais voilà, dire cela, pour certains de mes collègues psychiatres, n’est pas possible. Dans la psychiatrie dominante, la maladie mentale est avant tout une affaire de neurones, de dopamine ; un patient psychiatrique est réduit à un cerveau en souffrance.
Là encore, pourquoi pas ? Mais que voit-on ? Depuis vingt ans, c’est ce courant qui domine et on ne peut pas dire que l’on soigne mieux les patients du fait des découvertes faites dans ce domaine. Il est légitime de se poser des questions. Jusqu’à quel point continuer dans cette naturalisation du fonctionnement psychique si cela n’apporte rien aux patients ? Ça commence d’ailleurs à se dire. Thomas Insel, ancien directeur du NIMH a écrit un livre sur le sujet, livre repris dans la très prestigieuse revue Science. Rien n’a bougé en psychiatrie alors que l’on a dépensé des milliards dans la recherche en neurosciences. Les seuls progrès qu’il y a eu viennent de prises en charge non pharmacologiques directement issues du terrain (remédiation cognitive, méditation de pleine conscience, etc.).
Certains vont dire que, néanmoins, il y a un bénéfice secondaire, car ce modèle neurologique déstigmatise. Est-ce si sûr ? Les Japonais ont préféré changer le nom de schizophrénie (en 2002, les Japonais ont abandonné le terme de schizophrénie parce que le mot était trop péjoratif pour être d’une utilité thérapeutique, ndlr). L’effet est discuté : la neurologisation des troubles psychiatriques fixe, fige ; ce n’est pas franchement destigmatisant, en plus cela modifie la relation avec le malade. Nous, praticiens de la psychiatrie, nous ne sommes pas face à un organe, un cerveau. De plus, ce n’a pas le même effet d’être un médecin du cerveau, ou un médecin de l’intériorité. Cela induit des impacts politiques, et une politique de santé différente. C’est pour cela que cela m’a fortement inquiété, lorsque notre président a présenté récemment la politique nationale de prise en charge des troubles du neurodéveloppement : un document où le mot psychiatrie n’apparaît nulle part.«
Questions / Réponses
François Meyer : Est-ce que le terme de neurodiversité est revendiqué ? Et par qui ?
Bruno Falissard : Il y a un vrai clivage dans la communauté, certains le revendiquent, d’autres pas. Avec ce sentiment qu’il est moins lourd d’être qualifié de neurodivers que de malade mental.
Philippe Artières : Mais c’est plutôt le mot de folie qui est stigmatisé. Pour ma part, j’ai commencé à être confronté à ce qualificatif de neurodivers par le biais du milieu professionnel, mais aussi celui du milieu culturel, notamment avec le monde des musées avec cette idée d’inclusion de publics divers : migrants, queers, et des personnes qui se présentent comme neurodivers. En tant que chercheur, je me suis retrouvé devant des dossiers où les candidats se disaient neuro divers. Ce n’était d’ailleurs pas présenté comme un diagnostic, mais de l’ordre de l’identité. Que faire ? Je n’avais rien à dire. De ce fait, cela sort du champ de la médecine. N’est-ce pas une conséquence de l’affrontement autour de l’autisme ?
B. F. : Les HPI (haut potentiel intellectuel) ont fortement porté aussi la notion de neurodiversité. Notons que par certains aspects, c’était un peu bizarre, comme si c’était une maladie d’être trop intelligent.
Paul Machto : Tout s’est emballé avec la situation des enfants autistes, mal traités bien souvent par la psychiatrie, enfermés dans des pavillons. Et des parents qui, légitimement, vont se révolter. Cela a fomenté un mouvement qui a mis en cause LA psychanalyse, alors que certains psychanalystes ont bien travaillé avec les autistes…
Jean-François Lae : Qu’est-ce que l’on peut dire, en observant la classification des conduites ? Il y a des personnes qui n’arrivent pas se défendre, ni à se protéger, elles n’arrivent à épouser ces rôles-là. Certaines sont mal dans les relations, fuient les relations. Alors, peu importe les classements, les qualificatifs, le nœud des mal être en relation ne change pas. On invente juste des mots de rangement.
Philippe Artières : Ce qui change, c’est que ce sont les personnes qui se désignent ainsi, et non les soignants. Elles disent : je ne suis pas mal dans la relation, je suis neurodifférent. Et cela provoque quelque chose de complexe socialement, avec un décalage entre l’affirmation des uns et le regard des autres.
B. F. : On peut dire, de loin, que rien ne change, que c’est toujours pareil, mais de près, cela me paraît difficile de faire ce constat. On l’a vu avec le Covid, cela bouge, cela change, des personnes ont créé des clusters relationnels, se construisant des mondes, avec des représentations locales de la réalité qui ne sont pas compatibles avec celle des autres communautés. Cela s’appelle un mécanisme de défense paranoïaque. Ce n’est pas pathologique, nous avons tous des mécanismes de défense. Et la société, en fonction de ce qu’elle met en avant, va faire bouger ces mécanismes de défense. Mais ces derniers ont leurs avantages et leurs inconvénients, parmi les inconvénients des défenses paranoïaques, il y a le complotisme…
Le neuro-flop
« Il est troublant de remarquer que l’engouement pour la neurodiversité prend toute son acmé quand le neuro devient un neuro-flop. Les neurosciences ont été et sont fascinantes intellectuellement, mais elles n’ont pas apporté de réponse à la neurodiversité. C’est la complexité qui explique. L’humain est une question de complexité. Or les neurosciences ne sont pas une science de la complexité, contrairement à a ce que l’on pourrait penser car il leur manque les outils pour penser et représenter cette complexité (les mathématiques, pour le dire vite). Aujourd’hui, nous sommes paradoxalement dans un moment flottant. Au niveau international, le balancier revient. Il y a ainsi des tensions, entre les pratiques où l’on promeut le concept de « rétablissement » de « recovery » où la place du sujet dans la société est centrale, et le modèle de neurodéveloppement qui met l’anomalie de fonctionnement du cerveau en avant. De plus, pour rester sur le terrain, en pédopsychiatrie, la réalité du terrain pour les acteurs c’est avant tout des problèmes de violence intrafamiliale, des problèmes de logement, de conditions sociales qui n’ont rien à voir avec le cerveau et son éventuelle diversité. » Bruno Falissard