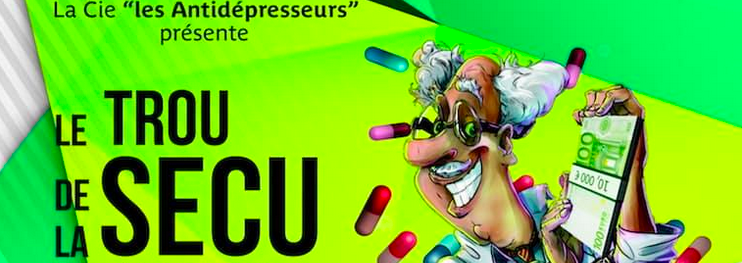
Dans son rapport annuel « Charges et produits », l’Assurance maladie semble partir en guerre contre l’incurie qui prévaut dans le secteur. Assez cocasse car nombre des soixante mesures énoncées se veulent l’exact contrepied de la politique qui semblait être, jusqu’alors, celle des auteurs du rapport, ou du moins, de la politique sanitaire menée en France depuis deux décennies. De fait, la lecture dudit rapport laisse vraiment perplexe. Certains engagements sonnent comme un programme politique lissé par ChatGPT : « Le virage préventif s’impose » ; « Repenser l’organisation des soins en privilégiant les parcours coordonnés, au plus près des réalités du terrain » ; « Instaurer une politique du juste soin au juste coût ».
Réalités ignorées, voire niées
Il serait facile de rappeler le désengagement, les reculs historiques vis-à-vis des possibilités d’action en matière de prévention, de gestion des alertes sanitaires et d’actions de protection de la population. La France est en la matière, hélas de manière active et délibérée, le mauvais élève européen, le pays qui consacre la quasi-totalité de ses ressources sanitaires au soin, à la prise en charge et non à la prévention. Le rapport avance que 40% des maladies chroniques, des cancers entre autres, seraient évitables par des mesures de prévention adaptées. Certes, mais à part quelques initiatives pas très abouties (comme la campagne de vaccination contre le papillomavirus), qui serait capable de citer une seule initiative forte prise ces dernières années qui irait dans le sens d’un « virage préventif » ? Pour mémoire, la dernière loi relative à la politique de santé publique est celle du 9 août 2004 (vingt-et-un ans !). Confirmation par le calendrier avec la loi Duplomb qui va organiser un nouveau bond en arrière alors que des études récentes (épidémiologiques et fondamentales) pointent du doigt l’exposition aux pesticides comme facteur de risque de cancer, du pancréas entre autres.
Tout aussi inutile serait de se gausser du vœu de piloter « au plus près des réalités du terrain » quand, dans bon nombre de cas, ces réalités sont tout simplement ignorées, voire niées. Pourtant, en santé publique, tout devrait partir de là : hiérarchiser les besoins vus de la « réalité du terrain » pour définir une politique. Et non la laisser être guidée par l’offre, ce qui ne peut que générer une faible efficience et creuser un déficit que l’on essaie de contenir par des mesures souvent contre-productives ou inégalitaires.
Du mauvais usage du médicament
Quant à « Instaurer une politique du juste soin, au juste coût », « restaurer une hiérarchie des prix cohérente », au-delà de la phraséologie, n’est-ce pas l’exacte inverse de ce qui se pratique depuis des années ? Une politique inconséquente de prix remboursés accordés à des innovations dont l’apport est en comparaison mineur quand des médicaments essentiels (dédaignés sous le nom de « matures ») se voient imposer des prix chaque année plus bas ; prix devenus ridicules, indignes (un mois de traitement pour le prix d’un café dans une gare), au point de les rendre totalement non fabricables sur le territoire. Grâce à cette politique visionnaire, la France dépend, malgré les annonces et promesses présidentielles, à plus de 80% de livraisons extra-européennes, ce qui, dans un contexte de bruits de bottes généralisé, fait redouter des moyens de pression redoutables. Que dire du mauvais usage du médicament, dans lequel notre pays excelle et qui n’est même pas cité en tant que tel dans le rapport, bien que probablement à l’origine d’une dépense évitable de l’ordre de 10 milliards d’euros par an ? Difficile de ne pas se souvenir que toutes les initiatives fortes en ce domaine ont été systématiquement contrées pour arriver à déléguer, par défaut, l’information et les actions de promotion sur le bon usage du médicament au Leem… le syndicat de l’industrie pharmaceutique.
Comme il est légitime d’attendre a priori bien peu de ces envolées lyriques, il est probable que les recettes pour retrouver l’équilibre (déficit annoncé à 13,8 milliards d’euros) se concrétiseront sur ce qui a été le remède depuis longtemps : la baisse des remboursements et des prestations. On reparlera des cures thermales, de la lutte contre la fraude (pleinement justifiée), d’un coup de frein sur le secteur 2 (mais qui donc a laissé faire cette folie ?) et de la baisse des remboursements dans le cadre des affections de longue durée (ALD). Pour ces dernières, on apprend que 15 millions de Français bénéficient d’une prise en charge à 100% dans ce cadre. Bien trop large pour les financiers de la Sécu. Mais au fait, n’était-ce pas le but premier du projet de 1945, d’assurer une prise en charge totale pour l’ensemble des Français ?
Bernard Bégaud