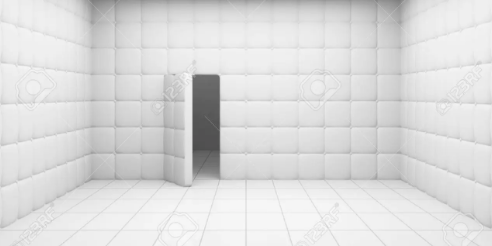
Dans le monde de la santé publique, Alfred Spira occupe une place unique. Non pas parce qu’il est professeur honoraire de santé publique et d’épidémiologie, membre également de l’Académie de médecine. Non pas parce qu’il a coordonné la première grande enquête sur les comportements sexuels en France dans les années 1980. Puis sur la fertilité. Alfred Spira est unique et impressionnant, car ses recherches ont toujours été doublées d’un engagement sans faille vers les plus démunis, que ce soit hier au Secours populaire et aujourd’hui sur les montagnes des Alpes du Sud pour aider les migrants. Il vient de sortir un livre avec Nicolas Leblanc, Santé les inégalités tuent, un livre qui lui ressemble et où, derrière une analyse précise, transparaît une colère devant ces inégalités qui n’en finissent pas de se développer. Il est venu, à VIF, pour en discuter. Propos entendus.
Je ne vais pas vous faire un long discours sur ce que sont les inégalités de santé. Les termes parlent par eux-mêmes et résument bien le problème, à savoir ce que les pouvoirs publics ne veulent pas toujours prendre en compte : les inégalités sociales de santé.
Premier constat, le modèle biomédical classique de santé ne suffit pas à expliquer ces inégalités sociales de santé. Le fait que ce modèle biomédical classique ne soit pas suffisant pour comprendre et pour agir montre bien la difficulté dans laquelle nous sommes. En effet, devant ces inégalités sociales de santé, dans beaucoup de pays dont le nôtre – et on l’a encore vu avec l’épidémie de Covid –, nous tentons de les traiter par des remèdes biomédicaux. Or, il faut bien sûr de la biologie et de la médecine mais pas seulement : il y a des choses qui sont à la limite plus importantes, comme l’organisation sociale, la démocratie le système éducatif, les politiques de protection sociale, la répartition des revenus, l’organisation de l’accès aux services de santé. Tout cela est beaucoup plus important que les médicaments que l’on peut donner ou que les interventions chirurgicales que l’on peut réaliser pour lutter contre ces inégalités. Notre livre, Santé. Les inégalités tuent, se veut une récusation forte du modèle biomédical classique.
La deuxième chose est la question qui revient souvent : « Mais comment se fait-il que cela continue ? Est-ce parce que cela n’intéresse personne ou en tout cas pas les pouvoirs publics, ou est-ce parce que l’on ne veut pas faire ce qu’il faut faire ? »
Il était une fois Villermé, en 1830
Ce qui me frappe est que les inégalités sociales de santé ont été découvertes dès les années 1830-1840 par Louis René Villermé qui a travaillé sur la durée de vie et « l’aisance ». Villermé a relevé un lien, pour chaque arrondissement de Paris, entre d’une part les impôts payés, ce qui reflétait très bien la richesse – l’aisance – et d’autre part, les données de mortalité. Villermé a conclu de ses travaux que ce n’est pas Dieu qui décide de la durée de vie, que ce n’est pas la vitesse des vents ni les miasmes, c’est l’aisance.
On ne s’en rend plus compte aujourd’hui, mais ce constat était révolutionnaire et il y a une vingtaine d’années, Alain-Jacques Valleron a appliqué la modélisation biostatistique actuelle sur les données de Villermé. Il a confirmé ses conclusions. Ces données seraient aujourd’hui considérées comme de l’« evidence based public health ».
À partir de ses observations, Villermé et ses collègues, qui étaient tout sauf des révolutionnaires en 1841, ont présenté au Parlement des lois pour prendre en compte ces inégalités sociales, en particulier en s’attaquant aux conditions de travail, pour limiter ainsi le travail des enfants de moins de 16 ans, puis le travail de nuit, ou celui des femmes enceintes. S’ils ont fait cela, ce n’est pas parce qu’ils étaient des révolutionnaires, c’est qu’ils pensaient simplement qu’il fallait préserver la force de travail pour qu’elle dure le plus longtemps possible et que l’industrie puisse tourner. D’ailleurs, cette conception est celle qui a été reprise ensuite avec Bismarck et le patronat allemand en Allemagne qui ont institué ce qu’on appelle aujourd’hui la sécurité sociale, c’est-à-dire l’indemnisation des journées de travail perdues du fait de maladie. Le patronat allemand, là aussi, était tout sauf marxiste. À la fin du XIXe siècle, il voulait simplement que leurs ouvriers puissent récupérer quand ils étaient malades, pour pouvoir ensuite travailler le plus longtemps possible.
Il faut faire de l’économie, de la sociologie, de l’anthropologie, de la géographie.
De fait, tout cet aspect social est connu depuis longtemps, mais il contient un côté sulfureux pour nos sociétés capitalistes.
Aujourd’hui, nous avons développé un modèle social et économique libéral mondialisé qui a une particularité – et personne ne peut dire le contraire : il creuse les inégalités. Il creuse les inégalités dans le système éducatif, les inégalités dans le logement, dans les transports. Et il n’y a rien de surprenant qu’il creuse aussi les inégalités dans le domaine de la santé. Tout cela est parfaitement homogène, le seul problème est que, pour des raisons compliquées, la prise en charge des inégalités de santé reste dans les mains des médecins, des biologistes.
De la même façon, on peut se demander pourquoi nous parlons sans arrêt de la prévention médicale alors que la prévention en santé est d’abord non médicale : le fait de fumer ou de ne pas fumer ne relève pas de la médecine. L’exposition à des particules fines ? Ce ne sont pas les docteurs qui vont améliorer la situation.
Donc, on est dans une situation un peu compliquée. De plus, ces inégalités ne sont pas que sociales : elles sont en même temps territoriales, ce sont des inégalités de genre, des inégalités environnementales. On le sait, les phénomènes sociaux sont interconnectés les uns avec les autres, mais ces interconnexions représentent la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Il faut aborder cette question comme un phénomène complexe. Et la complexité, par définition, est compliquée. Et pour moi médecin, ce qui est compliqué, c’est que d’une part les conséquences de ces inégalités sociales de santé, en termes de santé, n’intéressent pas qu’une maladie, elles intéressent l’ensemble des maladies. Et aujourd’hui, on a bien conscience que le plus important c’est de s’intéresser aux maladies chroniques, aux affections de longue durée qui sont responsables de la plus grande partie du fardeau global de la maladie : les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires, les troubles métaboliques, la santé mentale. Mais si l’on veut s’intéresser à toutes ces maladies ensemble, il ne faut pas faire que de la biologie, il ne faut pas faire que de la médecine, il faut faire de l’économie, il faut faire de la sociologie, il faut faire de l’anthropologie, il faut faire de la géographie.
Santé publique, partie d’un tout, ou le tout ?

La discipline universitaire « santé publique », lorsqu’elle a été créée en France, a été incluse dans les disciplines médicales au Conseil national des universités (CNU). La santé publique est donc clairement une sous-discipline de la médecine. Ma vision des choses est l’inverse : c’est la médecine qui est une sous-discipline de la santé publique. Il est impensable qu’on puisse faire de la santé publique seulement au sein de la médecine. Les disciplines et les professionnels dont on a besoin viennent de différents domaines, de la médecine, bien sûr, mais aussi des mathématiques, de la statistique, de la biologie, de la génétique, de l’anthropologie, de la sociologie, de la géographie, et c’est quasiment impossible. Par exemple, j’ai été élève de Daniel Schwartz, qui était polytechnicien et non médecin. Schwartz avait travaillé sur les maladies du tabac, il était biostatisticien et sa venue était importante pour la mise en place des premiers essais randomisés, donc de la santé.
Il y a des endroits où c’est différent. Aux États-Unis, ils ont la chance d’avoir un système universitaire très diversifié avec des universités très autonomes. Prenons l’exemple de la Johns Hopkins University, l’une des très grandes universités médicales des États-Unis, située à Baltimore. Pour des raisons historiques, parce que Baltimore est un port et que les infections contre lesquelles on luttait en priorité lors de la création du service national de santé venaient beaucoup par les bateaux, ils ont séparé la médecine et la santé publique en deux entités voisines autonomes. En France, on n’a jamais réussi.
Je prends un autre exemple : dans la préparation des élections présidentielles, j’ai vu un débat avec un représentant des syndicats de médecins qui parlait de la prévention et qui expliquait en quoi la prévention était importante, raison pour laquelle il fallait, selon lui, une consultation médicale de prévention qui soit à 75 € la consultation, contre 25 € pour le tout-venant.
Oui, il faut une consultation de prévention, mais pas une consultation médicale de prévention. Le combat que je mène, c’est d’ouvrir les portes. C’est d’essayer qu’au Conseil national des universités on puisse recruter en santé plus de non-médecins. Les choses évoluent puisque même l’Académie de médecine a doublé le nombre de professionnels de santé. Pour autant, je ne propose pas de supprimer les médecins, les biologistes ou les pharmaciens. Je propose d’enrichir leur mode d’exercice par une confrontation permanente avec les gens qui viennent des sciences humaines et sociales.
Même dans des pays comme la Suède, les inégalités sociales de santé vont persister.

Des pays bons élèves ?
Pourquoi cela ne marche pas ? On a pu noter, d’abord, que la montée en puissance des États-providence n’a pas permis de diminuer les inégalités sociales de santé. La montée en puissance de ces États providence, le plus souvent, s’est même accompagnée d’un creusement des inégalités de santé. Le niveau moyen de vie, certes, augmente mais les écarts entre les plus pauvres et les plus riches augmentent aussi et donc creusent les inégalités.
Comment expliquer que cette montée en puissance des États-providence ne se soit pas accompagnée d’une réduction des inégalités ?
Je ne suis ni politiste ni sociologue, je ne suis qu’épidémiologiste. Si on se tourne vers l’extérieur et que l’on regarde l’évolution des inégalités sociales de santé en Suède par exemple, que voit-on ? Les pays du nord de l’Europe sont les plus égalitaires mais ils vivent dans un système où le profit reste le moteur du développement économique. Par essence, ce mode de développement économique capitalistique est basé sur l’exploitation des hommes par les hommes, c’est-à-dire que pour que certains aient des profits qui augmentent, il faut que la force de travail des autres soit la mieux utilisée possible, donc que les inégalités perdurent. Donc même dans des pays comme la Suède, les inégalités sociales de santé vont persister même si elles sont moins importantes qu’en France.
Cela peut surprendre, mais dans mon expérience d’épidémiologiste, les pays dans lesquels j’ai assisté à une réduction des inégalités sociales de santé, au moins dans certains domaines, sont la Pologne, Cuba, le Vietnam, bref des pays avec des systèmes économiques différents. Le Vietnam a agi pour la santé maternelle et infantile en instituant des systèmes complets de protection et de surveillance des grossesses. Cuba a fait pareil, en essayant de développer un système de santé qui repose sur l’acquisition des compétences de santé. La Pologne a développé un système de médecine du travail et de prévention dans le milieu professionnel qui était un modèle. Donc à mon avis, ce sont des raisons politiques de structuration sociale et sanitaire.
Le syndrome de la vie de merde

Enfin, il y a un pays à part, qui a le plus essayé de lutter contre les inégalités sociales de santé, c’est la Grande-Bretagne. Cela débute par le rapport d’Acheson, publié à la fin des années 19701. Cela aboutit à faire voter par le Parlement un plan de lutte contre les inégalités sociales de santé – une première – mais peu après, les travaillistes ont perdu les élections et les conservateurs sont revenus au pouvoir. Il n’empêche, ledit rapport est reconnu par nos collègues en Grande-Bretagne pour avoir donné des repères. Ensuite, il y a eu Sir Michael Marmot, chargé de faire un rapport sur les inégalités sociales de santé juste avant ou au début de l’arrivée de Tony Blair au gouvernement. S’ensuivent dix années de gouvernement travailliste par Tony Blair puis Gordon Brown, pendant lesquelles a été appliquée une stratégie nationale qui a commencé à produire des résultats.
C’est, de fait, très intéressant de regarder ce qui s’est passé à ce moment-là en en Grande-Bretagne. Ils ont mis l’accent sur la santé maternelle et infantile et sur la consommation de tabac et d’alcool dans les régions les plus défavorisées. La Grande-Bretagne est, au final, un des pays du monde où ont été mises en place des politiques volontaristes qui ne se situent pas exclusivement dans le champ biomédical.
En même temps, tout est ambigu. Prenons un exemple, il existe des zones en Grande-Bretagne, dans le nord-ouest de l’Angleterre en particulier, où les inégalités étaient très importantes. C’est à partir de ce qui a été observé à Manchester et dans cette région qu’a été, d’ailleurs, inventé le terme de « syndrome de la vie de merde » : on a une mauvaise éducation, on n’a pas de boulot, on mange de la merde, on a un travail de merde ou pas de travail du tout, et on a une espérance de vie de merde avec survenue de maladies, développement de consommation de produits et toxicomanies, exposition à une pollution environnementale importante. Ce constat s’est traduit par des choses tout à fait étonnantes. Il y a quelques années en Grande-Bretagne, ils ont par exemple décidé de porter la scolarité obligatoire de 15 ans à 16 ans en se disant qu’en augmentant le niveau d’éducation, on allait permettre de lutter contre les inégalités de santé. En fait, cela a eu l’effet inverse parce que, comme il n’y a pas de boulot, quand ils avaient 15 ans, les gamins avaient une porte de sortie, c’était le chômage. En prolongeant leur scolarité d’un an, cela retardait d’autant l’entrée dans le chômage, ce qui prolongeait d’un an le fait qu’ils soient à la charge de leur famille qui elle-même n’avait souvent pas de travail. Ils restaient ainsi un fardeau pour la famille, ce qui s’est traduit par une augmentation de la délinquance juvénile, la dégradation du comportement de ces gamins et une détérioration de leur santé. Dans une situation telle que celle-ci, des mesures a priori théoriquement bénéfiques se sont révélées contreproductives.
Pourquoi les États-providence n’arrivent-ils pas à combattre ces inégalités ?
On peut estimer d’abord qu’il n’y a pas assez d’État-providence, et je suis plutôt d’accord. Pour le Covid, le quoi qu’il en coûte a en effet permis à une foule de personnes de rester vivantes, de continuer à travailler. Notre coûteux système de protection sociale nous a sauvés.
Pour autant, on doit constater que le recours au système de santé, comme le recours à la vaccination, est socialement très différencié. C’est certes la conséquence de ce qui s’est passé avant : l’hésitation vaccinale, le refus du vaccin sont expliqués en partie par la défiance, voire la méfiance, vis-à-vis des gouvernants et des experts. Dans le monde biomédical, il y a tellement de médecins qui sont à la solde des laboratoires pharmaceutiques et des industriels que beaucoup de gens ne leur font pas confiance, particulièrement ceux qui sont bas-situés dans l’échelle sociale. Pour des tas de raisons, mais c’est un fait.
Pour moi, au-delà de la question de l’État-providence, les deux choses les plus importantes pour lutter contre les inégalités sociales de santé sont, premièrement, l’évolution du système éducatif général, pour que les gens sachent que la santé est quelque chose qui est déterminé par les comportements, par les modes de vie… Et la deuxième chose, tout aussi importante, est le système de redistribution, en particulier fiscal, qui est un moyen d’amoindrir les inégalités de revenus par l’impôt, et par l’impôt progressif en particulier.
Est-ce possible ? Je ne sais pas s’il y a des pays au monde avec des systèmes de redistribution complètement égalitaires. Peut-être au nord de l’Europe. Je vous ai parlé de la charte d’Ottawa, des principes de la santé publique. Un de ces principes, c’est l’équité. Ce pour quoi je me bats, c’est, pour reprendre l’expression de l’OMS, un « universalisme proportionné ». L’universalisme proportionné est une forme de développement inégalitaire : il faut aider tout le monde mais, bien sûr, il faut aider davantage ceux qui en ont le plus besoin, les plus défavorisés.
Comment faire ?

J’espère vous avoir convaincu que le problème est vraiment compliqué, qu’il n’y a pas de stratégie réductionniste au sens anglo-saxon du terme, c’est-à-dire qui se réduit à une seule stratégie qui s’attaquerait à un seul domaine et qui permettrait d’améliorer la situation. Non, il faut arriver à bien fixer des priorités, parce qu’on ne peut pas tout faire en même temps, et se donner les moyens de les suivre.
Au niveau français, nous avons des politiques qui malheureusement ne sont pas pérennes ou quand elles le sont, ces dites politiques tombent un peu en désuétude. Je pense par exemple à la Protection maternelle et infantile (PMI). Nous avions un système formidable, avec la PMI et la médecine scolaire, même si la médecine scolaire aurait pu être meilleure. Sur la PMI, un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) sorti le 31 mars dernier montre l’effritement de la PMI, la baisse du nombre d’enfants suivis, de la fréquentation de la PMI, tout cela parce que ce système n’a pas été soutenu. Il n’a pas été renouvelé, il a une image vieillotte, désuète, il est mal financé. Quant aux Agences régionales de santé (ARS), elles sont déconnectées du monde politique. Il y a des conseils régionaux avec des élus, mais ils n’ont pas la compétence sur la santé, et les ARS sont liées au gouvernement central et aux préfectures. J’ai l’impression que la collaboration, la jonction entre le médical qui est fait aux ARS et le social qui est fait dans les conseils régionaux et départementaux est mauvaise. Et au final, nous n’avons pas de véritable politique de santé publique cohérente.
« Il y a bien trop peu de gens comme lui »
« J’ai rencontré Alfred Spira, puis je l’ai perdu de vue. Nos chemins étaient très différents et la santé publique, longtemps repliée sur elle-même, rejetait tous ceux qui n’étaient pas un élève de tel ou tel maître.
Ce n’est que récemment, au hasard de rencontres que j’ai découvert son travail très précoce d’ouverture de la santé publique vers la sociologie, les sciences politiques, la psychologie, l’histoire et bien d’autres disciplines. C’était bien plus qu’une ouverture : c’était la conviction que la santé collective passait aussi et surtout par là. Tout comme la santé est loin d’être l’affaire des seuls médecins. Caractéristique aussi a été son travail avec les autres acteurs de terrain, en particulier les « non médicaux », et la conviction que l’on avait tout à gagner en allant vers les gens eux-mêmes.

Alfred Spira a aussi été, par choix et par métier, enseignant-militant « tous publics ». Là aussi, l’ouverture. Avec une exigence : sortir des cénacles, aller à la rencontre d’autres publics.Enfin, il y a le militant ; politique, bien sûr, le dernier des fidèles, mais surtout des actes. Il est facile de signer des pétitions, voire de défiler. Il l’est beaucoup moins, dix ans après sa retraite, d’aller sur des terrains parfois éloignés, puis d’aider les migrants et les plus défavorisés, avec d’autres « justes », loin de toute caméra. Non pas comme un général visitant ses troupes mais en première ligne, à assurer les tâches de base. Non, décidément, force est de reconnaître que des personnes comme Alfred Spira,
il y en a bien trop peu. » Bernard Bégaud
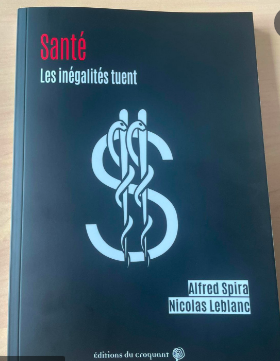
Santé. Les inégalités tuent, Alfred Spira et Nicolas Leblanc, Éditions du Croquant (12 €)