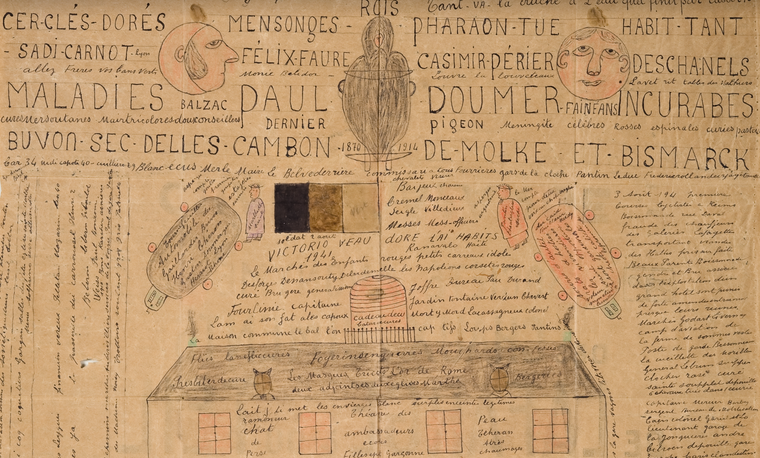
Comme pour le dérèglement climatique, le refus chronique de reconnaître l’ampleur du dérèglement hospitalier conduit aujourd’hui aux crises extrêmes. La pandémie de Covid 19 a démontré l’extraordinaire engagement des soignants, mais aussi porté à son paroxysme le niveau de la détresse de l’hôpital .
Dans ce contexte, Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a déployé, dans une récente tribune, son « programme » pour refonder l’hôpital. Il y développe trois axes principaux d’actions selon lui nécessaires : les statuts des personnels, qu’ils soient médecins ou soignants, leurs rémunérations et la gouvernance de cet ensemble institutionnel. De son côté, François Crémieux directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, dans une interview à Libération, explique la complexité de la situation en choisissant de la banaliser.
Ces points de vue s’inscrivent parmi les foisonnantes expressions publiques qui, au fil des opportunités politiques, médiatiques et sociales, ont installé les experts au centre de la parole publique. On peut voir, entendre ou lire, presque quotidiennement, des prises de position, des tribunes ou des témoignages concernant la crise de l’hôpital que la pandémie a exacerbée et que le « Ségur » n’a pas résolue.
Le mal est ancien
Pour l’essentiel, le fil rouge de ces analyses tourne autour de clivages anciens et récurrents : service au public versus hôpital entreprise ; sous-financement et faillite des recrutements versus maîtrise budgétaire ; file d’attente versus accès aux soins aléatoire, ou encore permanence des soins versus désertion par la médecine de ville… Tout ou presque a été exprimé pour décrire un hôpital schizophrène en même temps administré et concurrentiel, en même temps applaudi et contesté. Mais la récurrence de ces constats n’a pas permis de formuler les clés de sortie de crise.
Le mal est ancien. Chaque année, en haut, s’empilent de nouvelles lois (entre autres, de financement), des textes règlementaires soldant de sempiternelles réunions et concertations, des circulaires qui descendent de moult agences et directions. Au sein même de l’hôpital, on produit au quotidien une foultitude de procédures, de rapports, de réunions ; on demande aux soignants et notamment aux infirmières de formater leur prise en charge pour des malades qui ne devraient presque n’être que des fonds d’écrans. Les équipes travaillent dans une tension que les absences et les changements de plannings rendent insupportables. Les suivis des malades chroniques sont soumis à des prises en charge retardées ou dégradées. Même la porte des urgences, jusqu’à présent toujours éclairée, fonctionne parfois, comme au CHU de Bordeaux mais pas seulement, à temps partiel.
Et l’on arrive à ce constat : des infirmières impliquées ou des médecins souvent talentueux ne veulent plus travailler à l’hôpital. Comment le supporter ?
Pour tous, et notamment les médecins, l’envie, les projets d’exercices et de carrières semblent s’évanouir. L’intérêt de travailler dans ce lieu unique de production de savoir devient insuffisant à attirer les jeunes : enseignement, recherche clinique et fondamentale, innovation, recherche, bases de données cliniques, cette complémentarité des missions qui participait à l’attractivité des jeunes médecins est maintenant en berne. L’exercice est considéré comme contraint. Beaucoup ne veulent plus s’engager, d’autres quittent l’hôpital. La taille des équipes, notamment universitaires, est de moitié celle des pays anglo-saxons. Alors, pour tourner la page, faut-il encore s’attacher à pourfendre ou défendre le « programme du Dr Martin » ? Faut-il suivre François Crémieux quand il dit: « Assouplissons, donnons des marges de manœuvre et renforçons aussi la régulation » ?
Faire souffler tout le monde
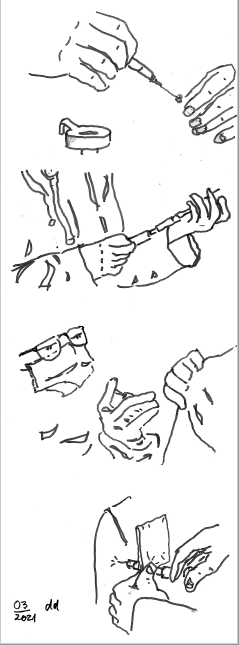
De fait, les solutions expertes tournent en boucle. Il est peu utile d’en rajouter. Le service public hospitalier est indispensable et irremplaçable. Dans l’état actuel de fragilisation, voire de catastrophe, c’est plus sur la méthode que sur les solutions sans issue qu’il me semble utile de travailler. Et en premier lieu, on ne peut sortir de cette situation sans, préalablement, faire baisser la tension du quotidien.
En premier, l’urgence, c’est éteindre l’incendie du manque d’infirmières. C’est faire souffler tout le monde pour retrouver du temps, des forces, des envies. À l’hôpital, le « quoi qu’il en coûte » doit perdurer un temps, notamment pour les rémunérations des soignantes et soignants, mais aussi au quotidien dans les pratiques. L’argent ne doit pas faire obstacle au recrutement. Pour mémoire, le Ségur de la santé a redistribué près de 10 milliards d’euros avec notamment une augmentation des rémunérations d’environ 180 €, replaçant la France dans le ventre mou de l’OCDE pour la rémunération des soignants. Et maintenant ?
Dans le même temps, le pilotage pragmatique des prises en charge doit être redonné aux équipes avec, pour l’administration, le rôle de facilitateur. Cette responsabilité enfin confiée aux équipes a permis de prendre les initiatives efficaces et rapides, et de faire face à l’imprévu des afflux de malades du Covid 19. Elle doit être retrouvée car elle a fait la preuve de sa capacité à mobiliser.
Sauver l’hôpital avant son apoptose
Deuxièmement, la tension abaissée, pourquoi ne pas donner un temps pour que les soignants et les citoyens-patients dont ils font partie puissent exprimer et formuler leurs attentes ? La parole du citoyen-patient est trop souvent représentée indirectement ou traduite par des enquêtes et autres sondages. Vingt ans après la loi Kouchner, la parole du citoyen-patient n’a pas eu l’opportunité de s’emparer du débat autrement que dans une représentation institutionnelle guindée ou une présence associative dont la diversité cache mal les rivalités. Le citoyen-patient, c’est-à-dire chacun d’entre nous et aussi chacun de ceux qui travaillent à l’hôpital, n’a pas l’opportunité d’apporter son angle, son expérience, son avis. Pourtant, c’est le citoyen-patient et les familles qui sont exposés aux impacts des maladies, au vieillissement, mais aussi aux conséquences sur la santé du dérèglement climatique et des pollutions, et encore à l’accroissement des inégalités dont la pandémie a douloureusement éclairé les réalités. Cette implication du citoyen-patient est d’autant plus attendue que l’hôpital participe largement à l’ascenseur et au lien social. C’est aussi une part essentielle du service au public.
Enfin, on rêve d’un calendrier explicite et resserré. On a besoin de rendez-vous fixes et clairs, d’abord pour espérer sauver l’hôpital avant son apoptose, mais aussi pour réduire l’incrédulité qui prédomine aujourd’hui face au politique.
François Aubart