
Un ou deux textes ? Le débat est reparti. Et comme souvent en matière de fin de vie, les arguments évoqués ne sont pas tous transparents. C’est de bonne guerre, pourrait-on se dire, mais est-ce que le sujet ne vaut pas un peu mieux ?
Reprenons le fil. François Bayrou, notre très immobiliste Premier ministre, a donc relancé le débat en répétant que sa volonté était de scinder en deux le projet de loi sur la fin de vie, dont l’examen à l’Assemblée nationale avait été interrompu par la dissolution en juin dernier. Le Premier ministre souhaite un texte sur les soins palliatifs – un « devoir » pour les Français. Et un autre sur l’aide à mourir – euthanasie ou suicide assisté – qui relève, selon lui, de la « conscience ». François Bayrou précisant que cela ne retarderait pas le débat au Parlement. « On allait travailler ces deux textes concomitamment et en même temps, avec une discussion générale commune pour les deux textes », a tenu à préciser un de ses proches, Erwan Balanant, député (MoDem) du Finistère, porte-parole du groupe, « avec ce compromis, la question est réglée. Qu’il y ait un ou deux textes, l’essentiel est qu’on arrive à un nouvel encadrement de la fin de vie ».
De fait, s’il choisit cette division en deux, c’est que François Bayrou a toujours fait part de son opposition personnelle à l’aide à mourir, avouant que sa foi catholique n’y était pas étrangère. Il n’est pas le seul. Une partie du monde des soins palliatifs s’est toujours opposée à tout acte qui pourrait s’apparenter à de l’euthanasie. « Donner la mort n’est pas un soin », a répété pendant des mois Claire Fourcade, la présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP). « Depuis le début des discussions, nous réclamons que les deux textes soient dissociés. Parce que vouloir mourir et vouloir être soulagé, ce n’est pas la même demande. Si les soins palliatifs relèvent d’une question médicale, la mort provoquée s’inscrit davantage dans un registre sociétal. Deux lois permettraient de bien matérialiser cette séparation », argumentait-elle notamment.
Exit tout débat
C’est clair. Comme l’avait fortement décortiqué Philippe Bataille, sociologue1, ce n’est pas nouveau. Le monde des soins palliatifs s’est construit contre l’euthanasie, cadenassant depuis les années 1980 tout débat sur la mort provoquée, en répétant que lorsque les douleurs de la personne en fin de vie étaient soulagées, il n’y avait quasiment plus de demandes d’aide à mourir. D’où pour eux, une seule urgence : développer les soins palliatifs, exit tout débat.
Et ce blocage a persisté. Si l’opinion, de sondage en sondage, se montrait, de son côté, partisane d’une législation ouvrant la porte à l’euthanasie, rien ne bougeait, ou alors aux marges avec les lois Leonetti, mais le flou persistait, en insistant surtout sur le refus de tout geste ouvertement létal. Philippe Bataille mettait alors les pieds dans le plat, dans un article publié en 2018 dans Libération : « La Société française d’accompagnement palliatif a poussé un cri d’alarme contre les 156 députés qui ont envisagé de légaliser l’aide médicale active à mourir. Ces députés avaient proposé de franchir les frontières de l’interdit de tuer que la loi Claeys-Leonetti 2016 respecte scrupuleusement. À suivre ces débats, n’est-il pas temps d’imaginer deux lois plutôt qu’une ? Une loi sur la fin de vie qui est celle en place, et une autre pour légaliser l’aide médicale active à mourir comme le réclament des pétitions, des manifestes et des associations citoyennes. » Et Philippe Bataille ajoutait : « Que répondre à ces désespérés ? Contrôler les douleurs ne leur suffit pas et ces techniques ne répondent pas à ceux qui situent leur mort avant leur fin de la vie. Les mêmes soulignent les efforts qu’ils ont accomplis jusqu’alors pour préserver leur dignité face à la maladie et les handicaps qui évoluent. Or, c’est de dignité dont ils parlent encore en disant vouloir choisir le moment et la manière de mourir. Les Français l’ont bien compris. Une foule de sondages les disent favorables à l’aide médicale active à mourir. Ce qui conduit à concevoir deux lois plutôt qu’une. Donc une loi pour l’exception d’euthanasie et de suicide assisté distincte de celle de 2016 sur la fin de vie des Français. Il est temps de penser l’accompagnement vers la mort en fonction de la combinaison de deux lois, plutôt que de s’en tenir à une seule qui ne parvient pas à répondre à toutes les situations qui la sollicitent. Seul un autre texte de loi, en plus de celui qui existe déjà, parviendra à désencombrer les soins palliatifs des lourdes questions morales dont ils disent qu’elles freinent leur exercice clinique. »
La fin d’une certaine hypocrisie
C’était clair. Mais le temps a passé, les positions des uns et des autres n’ont guère évolué, figeant toute avancée législative. La multiplication de rapports, d’avis, de conventions pour tenter de donner une réponse à ces fins de vie n’a rien changé à ce blocage. Et c’est dans ce contexte que le dernier texte de loi, présenté donc en 2023-2024 par le gouvernement, se révélait assez habile, établissant, dans certains cas, une sorte de continuité entre le laisser mourir et le faire mourir. Dans certaines conditions, il autorisait donc l’aide médicale à mourir. Mais pour faire accepter cette ouverture, et comme pour s’excuser de cette audace, le législateur se proposait une fois encore de « mettre le paquet » sur les soins palliatifs. Pourquoi pas ? Cela permettait de lever le risque d’un blocage d’une partie des soignants, et de l’autre côté, cela apportait une réponse à la demande de ces patients à bout de course, sans espoir thérapeutique, qui voulaient mourir mais, faute de loi, devaient attendre parfois des mois la survenue d’une mort dite « naturelle ».
Là, avec deux lois une certaine hypocrisie est levée. C’est chacun de son côté. « Scinder le projet de loi sur la fin de vie en deux, c’est la sagesse, parce que dans ce projet de loi initial, il y avait un accord unanime du Parlement pour pouvoir permettre l’accès à des soins palliatifs partout en France », a estimé le ministre de la Santé, Yannick Neuder. Et, insistant encore : « C’est de permettre justement de pouvoir partir dans la dignité avec des soins palliatifs où, globalement, vous êtes pris en charge, vous n’avez plus de douleur, vous pouvez faire le point avec votre famille. Cela permettra aussi une réconciliation nationale sur ce sujet-là, parce que je crois que ces soins palliatifs, on en a besoin, il faut vraiment le faire. » Pas un mot, faut-il le noter, sur le second volet. Et la SFAP a pu être satisfaite. Ce qui n’est, en revanche, pas le cas des partisans d’une aide médicale à mourir. « La scission en deux textes est un risque de diversion pour masquer une volonté d’abandon. Nous ne voulons pas de stratégie dilatoire pour reporter le texte aux calendes grecques », a réagi Olivier Forlani, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale. Et les associations pour le droit de mourir dans la dignité, mais aussi 240 députés socialistes et macronistes ont fait état de leur déception, exhortant le Premier ministre à ne pas scinder le texte en deux parties.
Une position essentiellement stratégique, car ce n’est pas tant le retard que le volet « aide à mourir » pourrait connaître en étant séparé du texte sur les soins palliatifs qui pose problème, mais plus prosaïquement la crainte que cette avancée législative ne soit pas adoptée au final par le parlement. Bref, en creux il y a toujours cette idée de faire « avaler la pilule » d’une ouverture législative vers l’euthanasie par le biais d’un discours enflammé sur le bien-fondé des soins palliatifs.
Voilà. C’est une ambiguïté. Les débats sur la fin de vie reposent bien souvent sur des non-dits des uns et des autres. Et c’est assez logique car l’articulation soins palliatifs/aide active à mourir n’est pas simple, mais cela mériterait parfois d’être dit avec un peu plus de clarté.
Éric Favereau
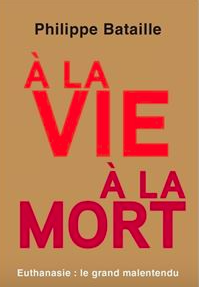
1) Philippe Bataille est l’auteur de À la vie, à la mort,
Éd. Autrement, 2015