
Miss Pat Beauchamp Waddell (1892-1972) est une volontaire anglaise du corps paramédical des FANY (First Aid Nursing Yeomanry) active en France pendant la Première Guerre mondiale. Elle a rédigé ses souvenirs de la guerre, Fanny Goes to War, qui sont très populaires et toujours réédités au Royaume-Uni. Le corps des FANY est une ONG féminine créée en 1907 et dirigée pendant la Première Guerre mondiale par Grace Mc Dougall. Le War Office ayant refusé l’assistance des FANY au début de la guerre, elles rejoignent l’armée belge, installent des hôpitaux puis des convois d’ambulances en lien avec la Croix-Rouge britannique.
En 1914, Pat Beauchamp rejoint un camp d’entrainement des FANY puis en janvier 1915, elle est affectée à l’hôpital Lamark à Calais (installé dans une école). Elle contribue aux soins et à la logistique. Elle prend de cours de conduite et de mécanique pendant une permission et rejoint les convois d’ambulances organisés par les FANY autour de Calais. Au volant d’une ambulance Napier 4 cylindres surnommée Susan, elle va chercher les blessés au plus proche de la ligne de front du nord de la France, au sud de la Belgique, pour les ramener vers les hôpitaux de Calais et ensuite à Boulogne pour les rapatrier.

Gravement blessée, elle doit être amputée
Les mémoires de Pat Beauchamp, jeune femme intrépide et à l’esprit ironique, sont précieux pour mieux comprendre la place des femmes au cœur de la guerre. Elle décrit avec humour la stupéfaction des habitants des environs de Calais en voyant une jeune femme en uniforme, ou pire, en pantalon. Elle décrit la difficulté du travail – démarrer son ambulance à la manivelle même quand le pétrole gèle –, la solidarité au sein des FANY et les relations presque maternelles avec les soldats. Ces mémoires permettent aussi de prendre conscience des discriminations que les femmes blessées de guerre ont rencontrées pour se faire soigner.
Pat Beauchamp est gravement blessée en conduisant son ambulance en 1916 : « Comme je ne pouvais pas bouger, je n’ai pas compris ce qui se passait, et j’ai suffoqué lorsque j’ai senti quelque chose me serrer et me faire terriblement mal. C’était un lacet de botte qu’ils ont posé pour arrêter l’hémorragie (les lacets servent à tout en France !). Les hommes m’entouraient et je les ai vu s’essuyer furtivement les larmes qui roulaient sur leurs joues ravinées. L’un d’eux a même mis son bras devant ses yeux, comme un enfant. Je me demandais vaguement pourquoi ils pleuraient ; il ne m’est pas venu à l’idée que cela avait quelque chose à voir avec moi. J’ai entendu l’un d’eux dire “Complètement coupée” et, rapide comme l’éclair, j’ai demandé “Où est-ce que c’est coupé ?” et ces âmes pleines de tact, de rudes soldats, ont répondu sans hésiter : “La jaquette, Mademoiselle”. “Je m’en fiche de la jaquette”, ai-je répondu, complètement rassurée. »
Conduite à l’hôpital par le convoi, elle doit être amputée : « Alors arrive un aumônier qui me demande gravement : “Qu’êtes-vous, mon enfant ?” Pensant que j’étais désormais méconnaissable avec le mouchoir du Français autour de la tête, etc., je répondis : “Une F.A.N.Y., bien sûr !”. Cela a complètement scandalisé le bon père. Quand il s’est repris, il m’a dit : “Non, vous m’avez mal compris. De quelle religion, je veux dire ?” Il veut savoir sous quelle religion m’enterrer, j’ai pensé, quelle grande et belle âme !
Je pense que ça a dû être l’une des pires demi-heures qu’il n’ait jamais passées. Ce n’est pas un travail agréable d’annoncer à quelqu’un qui aime particulièrement la vie qu’il a perdu une jambe et que l’autre vient à peine d’être sauvée ! Je suis restée sans voix pendant quelques minutes ; en fait, je refusais d’y croire. Il m’a fallu beaucoup de temps pour réaliser toute l’horreur de la situation. Il semble étrange que je n’aie pas senti que j’avais perdu ma jambe. Mais on n’a jamais cette sensation d’absence, même avec des béquilles, les nerfs sont malheureusement trop vivants. »
Tout le monde dans cet hôpital militaire est aux petits soins pour elle. Dès l’amputation, elle rêve de pouvoir être appareillée et reste hospitalisée pendant deux mois en France : « “Quand pourrai-je me déplacer avec une de ces jambes artificielles ?”, j’ai demandé et il m’a juré que si tout allait bien, ce serait dans un an. Un an ! J’avais imaginé l’automne au plus tard. J’étais loin de me douter que ce serait encore plus long. Je me réveillais la nuit en m’interrogeant sur ces jambes artificielles, à quoi elles ressemblaient et comment on pouvait s’en accommoder. Quel aimable passe-temps ! Maintenant que je sais de quoi il s’agit, je trouve particulièrement cocasse d’avoir pensé que l’on pourrait même dormir avec. Mon idée géniale était d’avoir toute la chose bien encastrée, de la laisser là et de n’en parler à personne ! J’étais loin de me douter à l’époque du soulagement que c’est de les enlever. »
« Votre trousse est dans le fourgon, Monsieur »
Pendant son hospitalisation, elle reçoit la croix de guerre de la part du général Ditte qui vient à son chevet avec une nombreuse délégation d’officiels français, belges et anglais : « Patronne, Eva, et Sœurette étaient les seules femmes présentes. /…/ Deux grosses larmes coulaient sur ses joues lorsqu’il a terminé, puis il s’est avancé pour me serrer la main ; ils en ont ensuite tous fait de même et je me suis accrochée au lit avec l’autre, car dans un excès de générosité, ils donnaient de sacrées bonnes poignées de main ! »
Elle est ensuite transférée en Angleterre : « À Douvres : Les aides-soignants n’arrêtaient pas de m’appeler « Monsieur », ce qui était amusant. « Votre trousse est dans le fourgon avant, Monsieur« , et en voyant mon visage : « Je veux dire – euh – Mademoiselle, Dieu me damne ! ça alors, c’est la limite ! » et les mots leur manquaient.
À Londres : Alors que l’on me conduisait hors de la gare – c’était Charing Cross – des vieilles dames avec des fleurs s’exclamaient bruyamment. L’une d’elles s’est écriée : « Mais, c’est une pauvre petite ! » et elle a bombardé Thompson de questions (je me suis sentie complètement idiote !). « C’t elle qu’a ramené les garçons, n’est-ce pas ? Qu’elle soit bénie ! » et elles ont couru après la voiture, en me jetant des bouquets entiers de roses ! »
Mais, à son grand déplaisir, elle est hospitalisée dans un hôpital civil où elle se sent maltraitée. Elle regrette les hôpitaux français où elle était aimée et respectée en tant qu’auxiliaire militaire : « Mes problèmes, je suis désolée de le dire, ont alors commencé. L’Angleterre ne semblait pas préparée à quelque chose d’aussi peu orthodoxe, et je devais supporter l’impression que j’étais une véritable nuisance. Il n’y avait pas d’hôpital pour « les gens comme nous » et on m’a emmenée dans un hôpital civil où le travail militaire semblait au rabais. Comme il s’agissait d’un hôpital civil, il n’y avait pas assez de personnel. « Tout le monde en a assez du travail de guerre, m’a dit une sœur avec dépit, on dirait qu’ils oublient qu’il y a des civils à soigner. »
Plus tard, j’ai été mesurée pour une paire de béquilles, par un individu lugubre vêtu d’une longue redingote noire comme un croque-mort. J’ai protesté contre la façon dont il m’a traitée, comme si j’étais déjà « raide », m’ignorant complètement et disant à l’infirmière : “ Veuillez mettre le cas absolument à plat sur toute la longueur”, après quoi il a solennellement sorti un mètre ruban !
« Si vous étiez un homme… »
À la fin de son hospitalisation, elle peut partir en convalescence mais elle n’a pas d’autre solution que de rentrer dans sa famille. Elle se heurte à des discriminations liées à son état de femme et d’invalide. Faute de ne pouvoir être prise en charge par des structures militaires, les seules expertes pour la prise en charge des amputés, elle reste longtemps ballotée entre des soins externes et des hébergements plus ou moins satisfaisants : « Enfin, j’ai commencé à me déplacer avec des béquilles, la question s’est posée de l’endroit où je pouvais aller pour ma convalescence, et j’ai entendu pour la première fois la phrase alors étrange, mais maintenant trop familière « Si vous étiez un homme, ce serait si facile« . Comme si c’était de ma faute si je ne l’étais pas ? Il ne servait à rien de protester que j’avais toujours voulu en être un ; cela n’arrangeait rien du tout. Comme il s’agissait d’un long voyage en train et que je n’étais guère habituée aux béquilles, j’ai voulu passer la nuit en ville. Mais on se heurte à des gens extraordinaires. Par exemple, l’hôtel où logeait ma tante refusa de m’accueillir, même pour une nuit, sous prétexte « qu’ils ne voulaient pas d’invalides« . Je pouvais être dans un hôpital militaire en France, mais c’était impossible en Angleterre. Finalement, j’ai entendu dire qu’un service W.A.A.C. (Women Army Corps, USA) dirigé par des femmes médecins avait été ouvert à Londres dans un hôpital militaire pour les Tommies, et je me suis empressée de faire une demande d’admission.
À Noël, les deux femmes médecins qui dirigeaient l’hôpital ont visité chaque service pour porter un toast. Je ne sais pas à la santé de qui elles ont bu dans les salles réservées aux hommes, mais dans celles des W.A.A.C., c’était en gros : “Aux femmes d’Angleterre et aux W.A.A.C. qui allaient gagner la guerre, etc.”. J’ai trouvé dommage d’oublier les hommes dans leurs tranchées, alors j’en ai bu un en privé, à leur intention. »
Elle peine à pouvoir se faire appareiller, une nouvelle opération est nécessaire : « Après Noël, on a pensé que j’étais assez bien pour être équipée d’un membre artificiel et, en temps voulu, j’ai déposé une demande d’admission à l’hôpital pour blessés de guerre de Roehampton. La réponse m’est parvenue quelques jours plus tard.
« Cher Monsieur, (je gémis),
Vous devez vous adresser à untel et nous pourrons alors vous donner un lit dans quinze jours, etc.«
Signé : « Sœur D. »
Mon cœur se serra. J’étais de nouveau confrontée à la même question et, en désespoir de cause, j’ai répondu :
« Chère Madame,
Mon problème est que je suis une fille, etc. » et j’ai déversé tous mes malheurs sur le sujet.
Sœur D., qui s’est avérée être absolument au top, a été très amusée et m’a répondu avec beaucoup de sympathie. Elle promit de faire tout ce qu’elle pouvait pour moi et a raconté toute l’histoire au chirurgien, et il fut convenu qu’il me verrait et me conseillerait sur le type de jambe qu’il me fallait, et qu’il déciderait ensuite de l’endroit où l’on m’installerait. Il a été très aimable, mais je suis revenue de l’entretien très déprimée car une autre opération était nécessaire avant de pouvoir porter une jambe artificielle. »
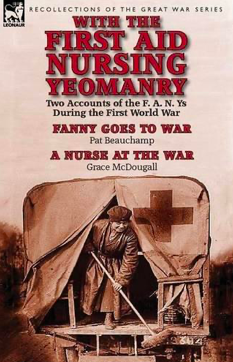
Elle peut finalement se fait opérer, mais on lui refuse d’être hospitalisée dans un hôpital militaire. Elle doit se faire suivre en consultation externe et trouver un endroit où loger : « Le chirurgien a essayé de me faire entrer dans son hôpital pour officiers, où il y avait plusieurs chambres individuelles libres. Vain espoir. Une fois de plus, la phrase familière a retenti, et une fois de plus, je me suis excusée d’être une femme, et j’ai dû prendre des dispositions pour retourner à la maison de retraite privée où j’avais été en août. L’année était écoulée et j’étais encore en train de me faire opérer. J’étais dégoûtée à l’extrême. J’ai finalement été envoyée à Brighton et, grâce à la gentillesse de Lady Dudley, je suis devenue une patiente externe de l’un de ses hôpitaux pour officiers, mais même là, c’était une nuisance d’être une fille. Un autre inconvénient était que tous les gens me traitaient comme si je sortais d’un zoo. Il était malheureusement devenu banal de voir des hommes sur des béquilles, mais une F.A.N.Y. c’était quelque chose de tout à fait nouveau, et donc un objet que l’on dévisageait. »
Ce n’est qu’au bout de nombreuses démarches qu’elle parvient à se faire appareiller à l’hôpital militaire Queen Mary de Roehampton. Un service pionnier pour l’appareillage et la réhabilitation des blessés de guerre amputés, où 11 000 amputés sont passés sur plus de 40 000 soldats amputés pendant la guerre. L’appareillage sera financièrement à sa charge.
« Lorsque je fus enfin en état de me rendre à Roehampton, la question du logement se posa à nouveau. Je ne m’étais jamais sentie aussi malade de toute ma vie – je n’étais pas un homme – les comités et les matrones se sont concertés et ont discuté la question. De toute évidence, j’étais une nuisance terrible et personne ne voulait prendre de responsabilité. La mère supérieure du couvent du Sacré-Cœur à Roehampton en a entendu parler et m’a proposé de m’héberger. Bien que je ne sois pas de leur confession, elles m’ont accueillie comme personne ne l’avait fait depuis mon retour, et j’ai été extrêmement heureuse avec elles. Cela me changeait d’être vraiment désirée quelque part.
Je suis allée à l’hôpital tous les jours pour les essayages et le jour est enfin arrivé où j’ai marché en me tenant aux mains courantes de chaque côté en regardant mon “style” dans un miroir prévu à cet effet au bout de la pièce. Mon excitation n’avait pas de limites ! Au début, c’est un travail fastidieux de l’ajuster sans douleur, et cela a pris un certain temps. »
Malgré ses vœux, Pat Beauchamp n’a pas pu être remobilisée pour rejoindre les FANY et elle ne reviendra brièvement sur les lieux qu’à la fin de la guerre. Elle continuera à travailler pour les FANY, en particulier pour organiser des camps de formation et lever des fonds. Elle sera brièvement mariée à un blessé de guerre rencontré pendant sa rééducation et aura deux enfants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle sera chargée d’amener une cantine mobile en France puis assurera des charges administratives. Elle travaillera avec les forces armées polonaises de l’Ouest dont elle décrit l’histoire et les activités dans son second livre (Eagles in exile, 1944). Elle recevra une troisième médaille de guerre, polonaise. Elle décède en 1972.
Agnès Roby-Brami