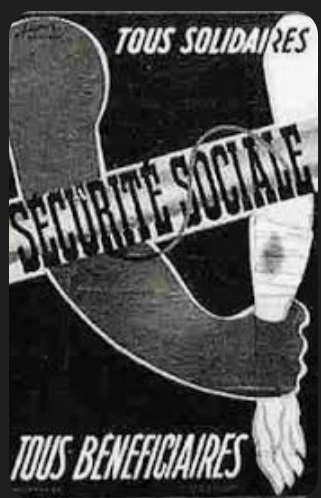
Si toute décision politique a sa part de mystère, celles visant à « sauver le trésor national » qu’est l’Assurance maladie sont de plus en plus transparentes. La ligne est claire : frapper l’assuré au portefeuille et transférer progressivement la gestion de la protection sociale et du système de santé au privé. La France a depuis longtemps entamé une marche forcée vers un schéma à l’américaine dont on connaît les bienfaits : une couverture inégalitaire basée sur des contrats « à la carte » avec des assureurs privés et un cache-misère (au sens littéral) de type Medicare/Medicaid pour dispenser le minimum à ceux laissés sur le bord du chemin. Avec cette lecture, la politique suivie ces dernières années, et accélérée dans les prochains mois, prend toute sa cohérence : franchises médicales, augmentation du « reste à charge », généralisation du secteur 2, déremboursements, jours de carence, offensive contre les affections de longue durée, contre les arrêts de travail, contre l’AME (Aide médicale d’État), etc.
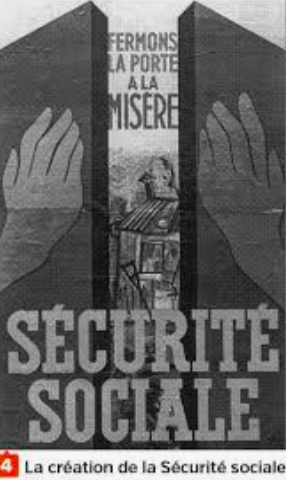
Payer de plus en plus
Dans la vision ultralibérale, équilibrer les comptes revient, avant tout, à cibler l’assuré qui est, chacun le sait, la cause des dérapages ; un profiteur en plus d’être malade. Le secteur public n’étant, par essence, que lourdeur, inefficience et gaspillage, il convient d ’accélérer le transfert du maximum de charges vers les mutuelles et les complémentaires. Du moins, pour ne pas se salir les mains, forcer les assurés à le faire eux-mêmes. Pour être bien remboursé, il faudra payer de plus en plus. Ainsi, par le jeu de l’augmentation des cotisations (pour ceux qui le peuvent), s’installe, peu à peu, une Sécurité sociale-bis, celles des plus aisés, tournant résolument le dos aux acquis de 1945. L’évolution est la même pour le secteur hospitalier : le privé attire maintenant en première intention des praticiens qui, « autrefois », auraient rêvé d’un poste en CHU. En plusieurs endroits du territoire se sont constitués des mini-CHU drainant les patients les mieux renseignés et les plus fortunés. On entrevoit un partage à l’américaine : la prise en charge de pointe, tarifée au plus haut pour le secteur privé et le reste, le trop complexe, le pas rentable, pour le public. L’emballage est immuable : « Nous n’avons pas le choix, le système est au bord du gouffre », etc. La main sur le cœur pour rappeler combien on est attaché à ce trésor national, au principe immuable de la couverture universelle garantissant une prise en charge égalitaire pour tous.
Mais « devant l’ampleur du déficit, des sacrifices s’imposent » sans dire vraiment à qui. Seize à vingt-cinq milliards d’euros de déficit imposent certes des mesures fortes et immédiates. Reste à savoir lesquelles. Pas besoin d’être sorti.e major d’une grande école pour conclure qu’il faut, en priorité, s’attaquer aux plus gros postes de dépenses non justifiées. Dans ses « 60 propositions pour l’avenir du système de santé » publiées le 10 juillet, l’Assurance maladie fixe son déficit à 16 milliards d’euros et programme « un effort inédit pour l’année 2026 avec le déploiement de 3,9 milliards d’économies ». Cela représente un peu moins de 1,5% des 266 milliards de son budget total ; un objectif pas vraiment présomptueux mais une tendance vertueuse. La surprise vient des cibles choisies ou plutôt de celles qui sont, contre toute évidence et logique, laissées de côté. Les médias se sont fait largement écho de la fraude, au point de la présenter comme une cause majeure de déficit.
En 2024, l’Assurance maladie la chiffrait à 628 millions d’euros, soit… 0,24% de son budget.
La fin du grand acquis de 1945, c’est pour bientôt
Des pratiques certes inacceptables et à combattre mais, en comparaison, le mauvais usage du médicament pèse à lui seul… 42 fois plus. Même l’AME, de plus en plus souvent présentée comme un pillage et non comme un acte humanitaire et de santé publique, avec ses 1,4 milliard d’euros annuels (0,53% du budget de l’Assurance maladie), reste loin des 10 milliards gaspillés pour le médicament. L’analyse montre que la part des prescriptions et des consommations non justifiées de médicaments varie de moins de 5% (cas rares comme le diabète insulino-dépendant) à plus de 80% (ex : traitements hormonaux progestatifs) ; la moyenne pour l’ensemble des classes thérapeutiques se situe un peu au-dessus de 50% (plus de la moitié !). Des données aisément vérifiables, tout comme le chiffrage des conséquences de ce record français : autour de 10 milliards d’euros par an (en incluant les coûts de prise en charge des effets indésirables causés). Depuis des années, on assiste, en connaissance de cause, à des dérives massives comme celle des « antiulcéreux » consommés par… plus de 15 millions de Français. Des milliards à disposition, une belle cause de santé publique. « Believe or not », diraient les Anglo-Saxons, cette piste n’est ni citée ni envisagée parmi les 60 (soixante !) mesures proposées par l’Assurance maladie… Une impasse qui laisse pantois et en panne d’explication. En 2025, on ne peut plus dégager d’un « Tout ceci est très exagéré », les chiffres et les décomptes sont là, à disposition, détaillés, attendant depuis des années. Serait-ce pour ménager les médecins en ces temps de tensions syndicales et conventionnelles ?
Pourtant, œuvrer ensemble à une prise en charge optimisée ne ressemble pas vraiment à une agression… Avec plusieurs rapports détaillés sur le sujet, dont, ce mois-ci, celui de la Cour des comptes, difficile de ne pas y voir une volonté délibérée de fermer les yeux, de laisser dériver jusqu’à ce que des « mesures fortes et courageuses s’imposent » pour achever le processus. La part de mystère a disparu ; la fin du grand acquis de 1945, c’est pour bientôt.
Bernard Bégaud