
La santé publique est un drôle de domaine, aux définitions multiples. Selon l’Organisation mondiale de la santé, c’est la « science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d’une activité collective concertée » ou « l’ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population grâce à une action collective ». Pour être simple, la santé publique s’intéresse à un monde où la santé n’est pas qu’un facteur individuel ; elle met en scène des liens de solidarité et de proximité.
Or aujourd’hui, ce qui fait lien dans notre société se délite. La liberté d’agir pour chacun prime sur la solidarité. On met en avant l’individu, et le collectif est rejeté, perçu comme bureaucratique, étouffant. Les décisions politiques relatives à la santé publique suscitent une opposition nourrie par la méfiance envers les politiques mais aussi envers les données scientifiques qui sont à la base des mesures proposées. Sur ce terreau de méfiance et d’individualisme se développent différentes formes de populisme. Tout ce qui vient d’en haut est perçu comme une contrainte, à l’image de la vaccination. Comment, dans ces conditions, les politiques de santé publique peuvent-elles trouver un terreau favorable ? À l’heure des rumeurs et des accusations de complotisme à tout-va, à l’heure où l’individualisme est porté aux pinacles et l’État accusé de bureaucratisme, comment mener une politique de santé publique ? Comment, en matière de santé, faire prévaloir l’intérêt collectif sur les revendications individuelles ? La santé publique et le populisme peuvent-ils s’entendre ? Ou bien la santé publique ne peut-elle que se dissoudre dans un populisme égoïste et rancunier ? Le danger est là.
VIF a organisé, le 1er avril, un débat avec Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, Michel Kazatchkine, ancien directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, et François Bourdillon, qui a été le premier directeur de l’agence Santé publique France.
Un débat animé par Danielle Messager, dont voilà de très larges extraits.

« Aucun d’entre nous n’avait anticipé ce qui est en train de se passer »
Michel Kazatchkine
« Dans l’histoire et cela jusqu’au Covid, le populisme ne s’était pas construit autour de l’anti-science, et les partis populistes n’étaient pas fondés sur le fait d’être anti santé publique. En Allemagne, l’AFD s’est ainsi construit d’abord contre l’euro, en Grande-Bretagne, les partis pro Brexit se sont construits contre l’immigration, en Hongrie, c’était un parti contre le modèle occidental.
Je crois que l’instant du Covid a été, sinon déclencheur, du moins un accélérateur majeur de l’anti science et de l’anti santé publique, car on le voit maintenant chez tous les populistes. Depuis le Covid, les grands leaders du populisme ont en effet tous pris des positions contre les normes, contre les institutions, et tous ont d’ailleurs eu des résultats désastreux dans la lutte contre l’épidémie.
Plus grave, ils ont profondément influencé le paysage de la santé publique ; des publications scientifiques montrent clairement aux États-Unis des liens entre les élus, selon qu’ils soient Républicains ou Démocrates et la couverture vaccinale, et au final, le nombre de décès selon les États. Que s’est-il passé ? Quels ont été les facteurs déclenchants ? Quelque part, dans la perception par la population, il y a le fait que les experts, qui étaient jusque-là des personnalités respectées et indépendantes, sont devenus et ont été perçus comme des personnes de pouvoir, avec une sorte de collusion entre l’expert et le décideur. Le populisme est fondamentalement basé sur l’anti-élites ; or les experts et décideurs ont été perçus comme complice. C’est un facteur majeur.
Un autre élément a été la perte de légitimité de la science, entre ses contradictions, ses hésitations, avec aussi des experts qui donnaient des avis différents sur la transmission, sur le masque, sans recul. Et puis le troisième facteur est le constat que les inégalités en santé sont désormais porteuses de vote populiste ou d’extrême droite. Le fait d’être en mauvais état de santé augmente fortement la probabilité d’être attiré vers la droite ou l’extrême droite.
Et donc à mes yeux, pour résumer, entre la position prise par les grands leaders populistes, l’assimilation de l’expert à l’élite décisionnelle, les incohérences des scientifiques, et le fait que les inégalités font voter à droite, voilà trois facteurs majeurs de cette évolution. On reviendra plus tard sur la situation à l’internationale et sur le fait que la santé mondiale est un peu la santé publique mondiale. Je ne crois qu’aucun d’entre nous n’avait anticipé ce qui est en train de se passer, personne n’a deviné ce bouleversement inédit, qui va ou pas durer, mais dont les dégâts seront de toutes façons gigantesques. »
« Le Covid n’est pas seul en cause »
Marisol Touraine
« Un constat d’abord : la santé, avec la question de l’environnement, est devenue un des points de fixation et d’agression des politiques populistes, ce qui n’était pas le cas avant.
Je suis d’accord avec Michel sur le fait que le Covid a été un point de bascule, mais le Covid n’est pas seul en cause. Lorsque je regarde les vingt dernières années, il y avait déjà les germes de doutes, d’interrogations, et des remises en question de la santé publique.
En France, cela me semble l’aboutissement d’un mouvement assez long, ancré dans plusieurs phénomènes. Car je le rappelle, avant le cas de Didier Raoult, il y a eu Henri Joyeux et Luc Montagnier avec leurs discours antivaccins, avec leurs pétitions demandant la liberté de ne pas se faire vacciner ; il y a eu la crise sanitaire de 2010, avec la campagne ratée de vaccination H1N1, les germes du complotisme étaient bien là. Et les pouvoirs publics font des erreurs. On ouvre des vaccinodromes, mais on ne se préoccupe pas d’associer les professionnels de santé, et on continue d’appeler à vacciner alors que la maladie n’arrive pas. D’où un doute fondamental qui s’insinue : on nous fait l’injonction de se faire vacciner, et on n’a pas d’explication pour la justifier.
La deuxième raison vient du fondement même de la santé publique, qui est la solidarité. C’est l’idée que les comportements individuels doivent pouvoir évoluer pour le bien de tous. Or, il y a le refus, le rejet de tous les signes prescripteurs qui viennent d’en haut, au nom de la responsabilité individuelle, l’affirmation que la santé est l’affaire de chacun et non pas de tous. Je souviens d’une buraliste m’apostrophant, elle me disait « on va tous mourir, laissez-nous mourir comme on veut », et cela parce que j’essayais de mettre en place le paquet neutre… Il y a cette idée d’un bon sens populaire qui est « on sait ce qui est bien pour nous, alors laissez-nous en paix ». Il n’y avait alors pas de pires insultes pour un responsable politique que de se faire qualifier d’hygiéniste… Sous-entendu, vous portez une vision aseptisée de la société qui gomme l’histoire, les territoires, les cultures, au nom d’une vision globale. Et un des échecs est que l’on n’a pas su, avec le Covid, se saisir de cette vision et faire en sorte que surgissent des effets de solidarité. Et puis oui, il y a la vieille antienne le peuple contre les élites, mais elle est aussi contre les entreprises pharmaceutiques qui s’en mettent plein les poches.
Si on regarde à l’échelle mondiale, on assiste à la cristallisation de tout ce que l’on vit à l’échelle nationale, avec des politiques de santé bousculées. On se doit d’accepter que ce qui se passe ailleurs a un impact et une signification pour nous, ce que les populistes n’intègrent pas. De fait, dans le populisme, il y a une forme de xénophobie qui aboutit à accentuer ses effets. Car le refus des politiques de coopération internationale repose aussi sur le fait de considérer que notre argent peut être plus utile chez nous que d’aller le dépenser pour aider des plus pauvres dans le monde.
Aujourd’hui, le constat est lourd : la santé est devenue le domaine public le plus fragile, comment renverser la situation ? »
« N’emmerdez pas les Français »
François Bourdillon
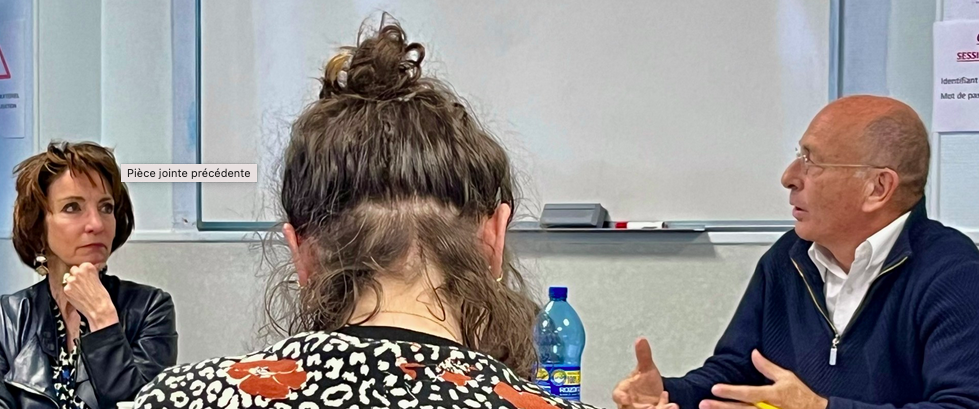
« Nous sommes tous d’accord, le Covid est un moment clé, mais je rejoins Marisol, il y a eu d’autres moments, comme en 2009 avec l’épisode de la grippe H1N1 et la vaccination ratée. Mais j’insisterai aussi sur la montée du populisme avec les questions d’’environnement et la remise en cause des normes, par exemple sur les pesticides par les agriculteurs. Le glyphosate a été réintroduit en 1997, et on voit aujourd’hui que l’usage des néocotinoïdes revient. Ce sont donc des produits interdits que l’on réintroduit, avec cette idée que la norme qui les interdisait empêchait de travailler. Or cette norme a été faite pour protéger le travailleur, et pour améliorer la santé des français. Et comble du paradoxe, c’est au nom de cette santé que les agriculteurs veulent la détricoter : ils pensent qu’ils seront mieux protégés sans la norme, or la norme était là pour les protéger.
Voilà. Puis est apparue une équivalence : les élites sont les fabricants de la norme, ils la produisent, cela fait de la bureaucratie, il faut donc les casser. Mais il faut aussi mettre en avant que des acteurs économiques poussent à cette dérégulation, et on le voit toujours, ce sont eux qui veulent interdire les campagnes contre l’alcool et le tabac aujourd’hui. Sous la pression des lobbies économiques et sous le discours populiste « n’emmerdez pas les Français », on essaye ainsi de déréguler un système de santé publique, qui est déjà bien fragile.
Dès lors, que faire ? Un système de surveillance ne s’improvise pas ; c’est vingt ans de travail, un système d’une complexité extrême, une construction en réseau avec de nombreux acteurs. C’est difficile à monter, mais le détruire en revanche est très facile comme on le voit avec les attaques aux États-Unis contre les CDC (centres de contrôle des maladies), et cela alors même qu’il y a une épidémie de grippe aviaire incontrôlée.
En moins de 60 jours, c’est à terre. Ce qui s’est produit aux États-Unis est incroyable. On casse le thermomètre et une fois qu’il est cassé, on n’a pas plus de norme et le commerce peut se faire sans contrainte… »
Échanges
Marisol Touraine : On n’aurait pas le même débat en France, là, ce soir, s’il ne passait pas ce qui se passe aux États-Unis actuellement. La nouveauté n’est pas seulement que le populisme impacte dangereusement la santé publique, c’est qu’il y a désormais une forme d’internationale du doute, de la suspicion. Les opposants français trouvant des arguments au fin fond du Texas ou de Washington, voilà une nouveauté.
Et je suis d’accord, il y a une dérive qui ferait croire que la liberté individuelle est en lutte contre les normes collectives. C’est un thème central. Il faut trouver de solutions.
Michel Kazatchkine : Le point commun, c’est ce que le populisme appelle le bon sens. On ne va pas entraver le travail des agriculteurs, c’est le terreau du populisme, or le bon sens va souvent contre la norme et la science. Il y a actuellement une conjonction de phénomènes internationaux et européens qui s’amplifient, mais il y a aussi des spécificités.
Le populisme aux États-Unis est particulier : l’antiscience s’est aussi construite sur un arrière-fond libertarien, avec la liberté de prendre le contrôle de sa propre santé, rien ne peut être fait sans mon consentement, et cela s’est heurté au vaccin. Le populisme est certes à la base de ce qui se passe aux États-Unis, mais Trump n’est pas vraiment un populiste. Il instrumentalise le populisme, sa décision d’arrêter le Medicare alors que 80% des gens en sont satisfaits va à l’encontre de ce que le peuple aimerait. Trump va bien au-delà d’un mouvement populiste. Timothée Sender appelle cela le sado-populisme
François Bourdillon : Les inégalités de santé nourrissent le populisme. Elles sont aujourd’hui bien étudiées, la plupart du temps, on retrouve derrière un sentiment d’abandon, d’être oublié. Alors, « quitte à être oublié qu’au moins on me foute la paix, et laisser nous vivre loin des normes ». La question, c’est comment lutter contre cela ?
Marisol Touraine : Les Français, à juste titre, ne comprenaient pas, on leur parlait de vaccins obligatoires, vaccins recommandés, tout cela n’était pas clair.
Michel Kazatchkine : La communication était difficile. Avec le Covid, on apprenait en marchant. Il y a eu beaucoup d’hésitations, d’erreurs, alors que les gens voulaient entendre des incertitudes.
Marisol Touraine : Il faut une parole publique, forte et claire, mais cela ne suffit pas. La difficulté est qu’avec le Covid, on s’est retrouvé face à l’inconnu alors que les gens voulaient entendre des certitudes. Les responsables politiques ne savaient pas, on a alors fait confiance au Conseil scientifique. Mais cela ne suffit pas : il faut des relais, or tous les relais ne se valent pas. À qui faire confiance ? Les médecins généralistes me disaient qu’ils n’en pouvaient plus de répondre à leurs patients pour leur dire les raisons de se faire vacciner.
Michel Kazatchkine : Aux États-Unis, il y a une baisse du taux de vaccination contre la rougeole, alors que l’épidémie s’étend…
François Bourdillon : La piste, c’est la démocratie sanitaire, c’est la proximité, c’est cela qui permet d’avancer sur certaines questions et surtout, c’est cela qui permet de désamorcer des crises. Il y a ensuite la question de l’expertise, une expertise indépendante et forte et respectée. Et enfin, le troisième niveau : laisser aux politiques le soin de prendre la décision.
Marisol Touraine : Le portage politique est la clé. Devant des conflits locaux, on peut arriver à les régler localement. Mais le façonnage, la création d’une opinion publique sur des questions de santé publique, tout cet état d’esprit d’ensemble, tout cela ne se résoudra pas avec de microdébats. Il faut une orientation politique forte, avec des priorités claires. Et créer partout des éléments de confiance. C’est là qu’il faut s’interroger : comment créer de la confiance ?
Michel Kazatchkine : Il y a des pays modèles. Le mot essentiel est la confiance, et en France, c’est ce qui manque, on voit une méfiance vis-à-vis des politiques, une méfiance vis-à-vis des experts. Les pays qui ont le mieux réussi face au Covid sont les pays où la confiance règne.
À l’international, quand les États-Unis se sont engagés avec le Pepfar, ce n’était pas pure solidarité ; il y avait le fait de sauver les vies (une revendication pour les protestants évangéliques), mais c’était aussi un moyen fantastique de soft power pour imposer son influence.
Marisol Touraine : Mais il y a des choses qui marchent, fondées sur le communautaire, sur le tissu associatif. On l’a vu magnifiquement avec les associations comme Aides contre le sida, on le voit avec les camions de santé pour les dépistages qui vont vers les gens, tout cela marche car il y a un lien de confiance. Ne regardons pas la santé publique que par le biais de ce qui est fait en haut.

« Vous parlez de confiance, vous parler de parole publique. Mais comment peut-on avoir confiance quand on nous a menti sur le chlordécone, sur le Mediator®, sur les masques… À qui faire confiance ? Un Conseil de défense a été créé pendant le Covid, mais pourquoi ce vocabulaire ? Pourquoi cette opacité ? Qu’y avait-il à cacher ? Où est la démocratie sanitaire ? On attend que le président seul décide. Or, qu’a-t-on vu ? La France a pris des décisions, elle les a prises toujours avec retard, comme l’a noté le rapport Pittet.
Voilà où naît le populisme. On parle de solidarité, mais quelle est la valeur dominante dans notre société ? C’est l’argent. Lors des dernières élections présidentielles, le Covid à peine fini, il n’y pas eu un mot sur la santé. » (André Grimaldi)