
Brice Perrier est un journaliste atypique, évoluant non sans risque sur un terrain glissant. Il n’a pas suivi une voie facile en choisissant de « penser contre », ou plutôt en doutant des pensées dominantes, en l’occurrence dans le domaine scientifique. Jeune journaliste, il a ainsi travaillé sur un peu tout, puis s’est focalisé sur le champ de la médecine et de la science, en particulier dans l’hebdomadaire Marianne où il a couvert, entre autres, les années Covid. Constatant depuis quelques années qu’il avait de plus en plus de mal à publier ses enquêtes, il a fait un pas de côté, lancé un site payant, Raison sensible. Et il vient de publier L’Obscurantisme au pouvoir, quand la pensée dominante entrave la connaissance, aux éditions Max Milo. À VIF, nous avons débattu avec lui début janvier. Extraits de nos échanges.
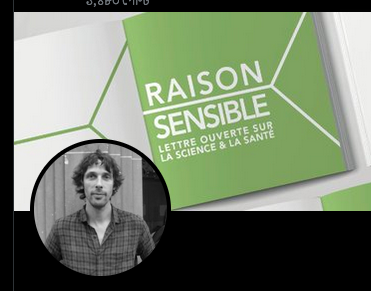
Des sujets inabordables, discrédités
Brice Perrier : Avant le Covid, j’avais vu qu’il y avait des sujets difficiles à aborder pour un journaliste. Il y avait des thèmes qui provoquaient aussitôt des crispations, comme sur les essais cliniques, ou la place de l’industrie pharmaceutique, mais aussi les adjuvants sur les vaccins, l’homéopathie, voire les expériences de mort imminente. Il était difficile d’aborder scientifiquement et raisonnablement ces questions. Il y a quelques années, j’avais assisté à la conférence citoyenne autour des vaccins, et j’avais été frappé de voir combien cela s’était terminé en mascarade où l’on avait évacué les questions gênantes, par exemple sur les adjuvants aluminiques. Il y avait des sujets inabordables. Cela m’a surpris. Que faire ? Car en même temps, dès que l’on posait des questions sur ces thèmes, on était aussitôt catalogué complotiste, ou porteur de fake news.
J’avais vécu tout cela directement, comme l’assimilation au complotisme dès que l’on posait des questions. Et cela allait même plus loin. Quand j’ai travaillé sur l’origine du Covid et que j’ai proposé un livre, j’ai vu mon éditrice, très partante, puis virée…
Bref, je voyais qu’il y avait des sujets mis sous la table, discrédités. La raison ? Ils contredisent la pensée dominante. Bizarrement, on parle d’obscurantisme quand on évoque les antivaccins ou les antiévolutionnistes, or je découvrais que les plus obscurantistes étaient encore ceux qui se gargarisaient d’être la voix de la raison et qui, sous couvert de bien-pensance, discréditaient toutes opinions différentes, la moindre controverse étant alors balayée pour devenir une fake news.
C’est pour cela que je parle d’obscurantisme. Il est, ainsi, au pouvoir. Il n’est pas marginal. La pensée dominante discrédite, et ce n’est pas l’inverse. Il y a quelque chose proche du fanatisme, chargé de croyances, et ce terme d’obscurantisme me paraissait judicieux.
Obscurantisme, dogmatisme, de quoi parle-t-on ?
François Aubart (chirurgien, syndicaliste) : En vous écoutant, je ressens une confusion entre la science, l’institution, et la démarche scientifique. Tout n’est pas équivalent. La démarche scientifique est ouverte, elle est contredite bien souvent dans le temps, la démarche scientifique consiste en effet bien souvent à remettre en cause les acquis. Et vous, vous décrivez un corps social de chercheurs, avec des bornés, des ouverts, des contestataires, oubliant qu’il y a un continuum entre les deux, entre la science et la démarche scientifique, même si au passage, bien sûr, l’institution, elle, peut être figée, immobile, voire conformiste.
François Meyer (médecin) : Il est clair que les travaux de recherches et la science sont deux espaces différents. Il y a des expériences scientifiques qui sont tentées, puis confirmées, d’autres pas. C’est toute la difficulté, et ce n’est pas parce qu’un résultat n’a pas prospéré que c’est le fruit de l’obscurantisme.
Philippe Artières (historien) : Oui, pour moi aussi, cette distinction me paraît un peu étrange. La science est toujours en mouvement, elle ne cesse de grandir, de se corriger. On pourrait même dire que dans mon domaine, à savoir les sciences humaines, nous sommes tous une armée de charlatans, car notre savoir est un savoir fragile. En sciences biologiques, également, ce n’est pas toujours définitif. Cela reste ouvert. D’où mon interrogation, et j’aimerais savoir si ce que vous mettez en débat ce sont les modalités de validation des connaissances ? Mais cela s’appelle des controverses et la science est faite de controverses, on l’a vu dans la lutte contre le VIH où le savoir a sans cesse été remis en cause. Pourquoi, dès lors, parler d’obscurantisme ?
La science fondamentale a ses règles, avec ses publications, j’ai du mal à comprendre contre quoi vous vous insurgez. Est-ce les modes de validation que vous contestez ? Vous passez de l’Académie des sciences à la chambre de l’hôpital, on s’y perd.
Brice Perrier : Obscurantisme, parce que l’on empêche la recherche de faire ce travail de doute. On la discrédite dès qu’elle sort des chemins battus, et des données sont ainsi mises de côté. Prenons un exemple : la médecine par les preuves. Elle est omniprésente, on la vante, on la dit raisonnable, juste, véridique. Or c’est surtout la médecine de ceux qui peuvent se payer les preuves et en l’occurrence, l’industrie pharmaceutique. Car pour mettre en avant des preuves expérimentales, il faut pouvoir monter des essais, les exécuter, cela demande de l’argent. En plus, c’est l’industrie elle-même qui choisit ses thèmes, puis les évalue. Il y une sorte d’obscurantisme structurel. La bonne médecine, c’est celle qui a les moyens. Les autres sont renvoyées à la case fake news.
Quant à l’évaluation de la science, il y a certes les grandes revues, mais parfois elles sont dans l’obscurantisme en dépit des process de lecture. Je l’ai vu sur l’origine du Covid, avec des données cachées, des papiers tronqués.
François Aubart : Quand j’étais à la Direction générale de la santé, j’ai découvert un système de clientélisme dans les appels d’offres, et cela ne concernait pas seulement les médicaments mais aussi les enquêtes de santé publique. En médecine comme ailleurs, la vérité n’existe pas, elle est toujours remise en question. Cela fait partie de la démarche scientifique.
Bernard Bégaud (pharmacologue) : Nos échanges montrent bien qu’il est très difficile d’avoir une position qui est de s’interroger, d’être dans le doute. Aujourd’hui, pour être écouté il faut être définitif. C’est de moins en moins facile, et cela rend fragiles nos analyses.
Paul Machto (psychiatre) : Quand vous parlez d’obscurantisme, j’entends plutôt dogmatisme.
Brice Perrier : Dogmatisme, oui, mais il y a aussi quelque chose de fanatique.
Le poids des réseaux sociaux
Bernard Bégaud : Brice Perrier a souvent raison. Il y a beaucoup de situations où des hypothèses sont rejetées, par a priori, parce que jugées non-conformes ou gênantes. C’est une évidence, pas de doute là-dessus, et je le vois en action moi-même dans certains de nos travaux de pharmaco-épidémiologie sur lesquels il y a des blocages forts. Mais là où je ne suis pas d’accord, c’est quand Brice parle uniquement d’un obscurantisme, venu du haut. Il y a un l’obscurantisme qui vient d’en bas, de ceux qui n’ont pas d’argent, et que l’on veut faire taire. Il y a un vrai obscurantisme chez ces gens-là ; ils sont organisés dans des réseaux sociaux très actifs et cela va bien au-delà de la bande de Didier Raoult. C’est un phénomène nouveau. Si hier leurs propos auraient été discrédités tant ils sont à l’évidence absurdes, aujourd’hui, on observe peu de riposte de la part des scientifiques ou des responsables sanitaires. On voit tomber des pans entiers chez les gardiens du temple, qui ne font pas leur travail, se taisent, voire pire. Ainsi, quand on voit que le journal dit « de référence », Le Monde, défend, en déformant délibérément les faits, les traitements hormonaux dans le cadre de la ménopause, c’est ahurissant. Il ne faut pas s’étonner que lorsque des institutions publiques, les garants de l’indépendance, tombent aussi bas, parfois dans l’anathème ou la désinformation, le débat devient figé. Et ça, c’est un air nouveau, délétère, qui atteint tous les niveaux, en haut et en bas.
Brice Perrier : Je ne dis pas qu’il n’y a pas de fake news, mais elles ne sont pas au pouvoir.
Bernard Bégaud : Les réseaux sociaux représentent une force puissante.
Penser d’autres méthodes
Agnès Roby-Brami (chercheuse en neurosciences) : Vous avez évoqué la médecine par les preuves, l’EBM. Or, il y des trous noirs, avec tout ce qui ne relève pas des interventions médicamenteuses. Comment les évaluer ? J’ai été frappé, par exemple, quand une personne a affirmé lors d’un débat que la kiné ne marchait pas, aucune étude ne montrant son efficacité. Certes, mais démontrer quoi ? On ne peut pas, bien souvent, appliquer pour ces interventions le Golden Standard de l’EBM, avec son modèle d’enquêtes, de comparaisons, d’essais contre placebo, etc. On ne peut pas les appliquer et on se retrouve dans l’impossibilité d’établir une quelconque efficacité par les preuves du fait de la singularité de chaque cas et du contenu de la pris en charge qui ne se prête pas à la modélisation. On parle alors de médecine informée et non pas de médecine basée sur les preuves.
Je prends un autre exemple, celui sur les prises en charge post-AVC. On est face à des patients très différents et on se retrouve devant une impossibilité de standardiser. Quand on regarde les méta-analyses, on se retrouve avec zéro d’efficacité. Cela laisse ou crée un appel d’air pour toutes les médecines parallèles ou alternatives. Il y a un problème méthodologique de base. Il y a nécessité de penser à d’autres méthodes.
Ce que j’ai vécu dans le cas de l’épidémie du sida me paraît décalé par rapport à notre débat. Au début du sida, on vivait sur des croyances. Et on en avait besoin, car on était face à un vide. On ne peut pas laisser le vide devant soi, on se raccroche, on fait ce que l’on peut. Et ce n’est pas la même chose que les controverses dont on parle. Ce n’est pas du même niveau en tout cas, moi, j’ai vécu le vide.
Francis Carrier (militant)
La place du politique et de l’économique
Blandine Destremau (sociologue) : Je voudrais savoir quelle place occupe à vos yeux le politique. Dans vos propos, on ne la voit pas. Or aujourd’hui, par exemple sur les cancers professionnels ou environnementaux, elle a un rôle essentiel pour effacer ces domaines du monde de la recherche, faire en sorte que l’on n’y travaille pas vraiment. Il s’agit de défendre, là, des intérêts politiques. Est-ce que vous parleriez aussi ici d’obscurantisme ?
Philippe Artières : Pourquoi, dans votre critique, n’êtes-vous pas entré par la voie de l’argent, par le biais du libéralisme qui impose ses règles et ses choix ? Pourquoi n’avez-vous pas été regarder de ce côté-là ?
Brice Perrier : Je ne mets pas de côté l’aspect économique, et je parle longuement des essais et de la mainmise de l’industrie sur ce domaine.
Trois sphères distinctes
Blandine Destremau : En nous écoutant, je vois notre objet de débat en trois sphères. Je garderai la notion d’obscurantisme pour le premier, à savoir le registre des croyances, celle des convictions.
Autour de cette première sphère, il y a la sphère des intérêts, de la concurrence, mais c’est classique, on tombe là dans la bonne vieille économie capitalistique avec, n’oublions pas aussi, la production de l’ignorance, qui est une catégorie sociologique bien réelle et dont le but est de faire taire pour ne pas donner accès.
Enfin, au-delà, il y a les sphères politiques. La Chine ne pouvait par exemple pas reconnaître sa responsabilité dans le Covid et a donc cherché à réécrire la science, comme la France avec l’amiante dont les dangers ont été cachés pour des raisons politiques.
Jean-François Laé (sociologue) : Je suis pleinement d’accord avec Blandine, il faut séparer ainsi les croyances et les forces économiques. Mais j’ajouterais un autre élément. Pourquoi penser que les gens sont naïfs ? Chacun a son esprit critique et son autonomie, il choisit et décide. Dans le cas du traitement de la ménopause, les femmes ne vont pas se précipiter pour en prendre un parce que le journal Le Monde l’écrit.
Et après ?
Bernard Bégaud : Y a-t-il de la place, aujourd’hui, pour ce genre de combat ? Débattre sur des questions dont on ne veut pas débattre ?
Brice Perrier : Mon livre ? Personne ne m’a invité ni ne l’a critiqué. Cela ne crée pas de débat, voilà ce que je ressens.
Philippe Artières : C’est aussi une crise du journalisme, de la place des uns et des autres. Regardez dans les journaux, on met en avant les vérificateurs d’informations, plutôt que les autres articles.
François Aubart : C’est exact, il n’y a plus trop de hiérarchies, tout le monde a la même valeur. Qui serait, dans ce contexte, le meilleur superviseur pour trancher ? On ne sait plus. La seule solution, je crois, quand il y a une individualisation si poussée, c’est de jouer collectif.