Après la publication de plusieurs articles suite à la visite de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) en février dernier qui en faisait l’éloge, s’inquiétant des réformes annoncées, la cheffe du service de psychiatrie de l’hôpital général de Chinon nous raconte son histoire et celle de son service.

Je travaille dans ce service, qui se situe au sein d’un hôpital général, depuis novembre 2008. D’abord, en tant que praticien hospitalier contractuel, puis titulaire. Il s’agit d’un vrai choix : je fais 80 km de voiture chaque jour pour venir exercer mon métier au sein d’une équipe pluridisciplinaire dont j’apprécie le travail, discret, mais dont j’ai la conviction qu’il est qualitatif et bénéfique pour mes, nos patients. Il arrive qu’on m’interroge l’air dépité : « Pourquoi travailler si loin ? Vous n’avez pas pu obtenir de poste plus près de votre lieu d’habitation ? »
Si, j’aurais pu, mais l’exercice hospitalier me plaisait plus. Je ne me voyais pas en libéral à enchaîner des consultations toute la journée. Travailler à l’hôpital était – encore à cette période – enviable.
Pendant ma formation d’interne en région Centre, j’étais passée dans tous les services de Tours et celui de Chinon. Puis, j’ai travaillé au CHRU de Tours où j’ai été chef de clinique de 2006 à 2008. La supervision par mes pairs était parcimonieuse, les débuts de la pénurie médiale se faisaient sentir. Pendant un an, les professeurs du service se sont relayés dans un autre service déserté sur le plan médical. J’ai travaillé au sein d’une équipe infirmière compétente, humaine, motivée mais indigente, peu disponible pour des entretiens infirmiers ou pour toute activité thérapeutique. Le bâtiment était fermé, l’agitation fréquente et le recours à la chambre d’isolement usuel. Les effectifs étaient minimaux toute l’année, et c’était le cas dans les trois autres services non universitaires de l’agglomération tourangelle. Alors qu’à Chinon, les infirmiers étaient en nombre décent, ce qui permettait justement de pouvoir faire ce travail auprès des patients que je n’avais que peu pu observer ailleurs : entretiens infirmiers, accompagnement infirmiers, activités thérapeutiques diverses, travaux manuels, atelier cuisine, par exemple, pendant l’hospitalisation complète. En intra, les patients étaient globalement calmes et les chambres d’isolement étaient très peu utilisées. Le service était la plupart du temps ouvert.
Les kilomètres à faire se sont vite effacés au moment de décider de mon avenir professionnel.
L’importance de la formation
En 2019, j’ai repris la direction du service. Ce choix s’est encore une fois imposé. J’avais à cœur de préserver l’outil de soin et la culture psychiatrique que mes prédécesseurs avaient construits, avec l’aide des directeurs, au service des patients, tout en le faisant évoluer en fonction des connaissances actuelles en psychiatrie.
Lors de l’hospitalisation d’un patient, il est évident que le soin psychiatrique est avant tout humain, que seul l’humain peut amener un patient à comprendre et à vouloir prendre un traitement. Un malade est d’abord fragilisé, vulnérable et il a besoin d’être réconforté. Plus les IDE sont en nombre satisfaisant, plus ils peuvent prendre le temps de désamorcer les crises, aider un patient à diminuer sa tension interne, discuter longuement pour lui permettre d’exprimer ses émotions, lui expliquer ses symptômes et sa maladie, lui proposer une activité pour évaluer sa capacité à se concentrer, à gérer sa communication et ses comportements avec les autres. Un infirmier qui n’est pas dans le stress peut accueillir et soulager la souffrance d’un patient, sans recourir nécessairement à un traitement médicamenteux.
La formation, là encore, est primordiale. L’approche d’un malade et la façon dont on s’adresse à lui de manière thérapeutique n’ont rien d’inné. En près de quinze ans, j’ai vu l’équipe infirmière évoluer. Les effectifs sont restés les mêmes, mais les infirmiers DE (diplômés d’État) sont maintenant la très grande majorité. Les infirmiers de soins psychiatriques qui avaient reçu une formation spécifique et de qualité sont en voie de disparition, la dernière promotion remontant à 1992.
J’ai vu le fossé se creuser dans la formation infirmière, le module de psychiatrie étant désormais très réduit dans le diplôme d’État, qui a pour but de permettre un exercice polyvalent. Leur possibilité de stage en psychiatrie est limitée. J’ai constaté une diminution des compétences dans les connaissances psychiatriques chez les IDE sortant de l’école. En plus d’une formation minimale proposée à deux IDE chaque année, il se forment sur le tas, grâce à leurs collègues et à l’encadrement. Nous consacrons aussi beaucoup de temps médical au quotidien à transmettre notre savoir du soin psychiatrique à ces jeunes, heureusement motivés et curieux d’apprendre.
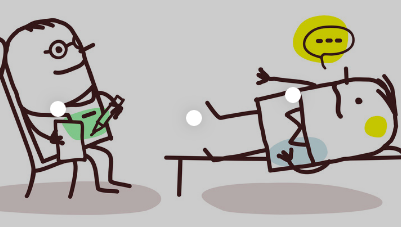
Pénurie médicale majeure
Pourtant, nous sommes une équipe médicale, en diminution constante. Nous avons eu jusqu’à 5 postes de praticiens hospitaliers pourvus et 2 internes de spécialité en formation dans notre service en 2019. Actuellement, nous sommes 2,8 équivalents temps plein. Deux collègues nous ont quittés récemment, sans successeur. L’une d’elle a quitté notre service pour s’installer en libéral, et elle est désormais la seule psychiatre libérale de notre secteur (périmètre comprenant 85 000 habitants adultes). La pénurie médicale est majeure (dire que je me suis enorgueillie de réussir un concours qui recevait moins de 10% des inscrits). Pour ce qui est des internes, pour répondre aux manques de médecins dans les zones sous-denses la réponse du doyen de la faculté de médecine et de l’ARS (Agence régionale de santé) a été d’instaurer des plafonnements par département, ce qui fait que le CHU absorbe désormais la quasi-totalité des choix de stage pour l’Indre-et-Loire, et nous n’accueillons plus que très rarement des internes depuis 2019. Rapidement, ces derniers ne nous connaissent plus et ne choisissent plus notre service. Pourtant, ils y recevaient une formation de qualité car nous nous sommes toujours impliqués pour transmettre notre savoir.
Nous continuons donc à mi-effectif, avec 3 praticiens hospitaliers, à tenter de répondre à nos missions, à donner des avis aux urgences et dans les différents services de l’hôpital, à assurer la prise en charge des patients hospitalisés et à recevoir des patients en consultation. Nous gérons également nos 30 places d’hôpital de jour, notre CATTP (centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) et notre appartement thérapeutique. Nous sommes souvent sous pression.
La demande de soin psychiatrique, grandissante et accrue par l’épidémie de Covid, ne nous permet plus d’assurer des soins de qualité. Les délais d’attente pour une première consultation s’accroissent inéluctablement. Il faut savoir que les adolescents, particulièrement en souffrance actuellement, sont hospitalisés dans notre service de psychiatrie adulte, au milieu de patients adultes en décompensation de toutes sortes de pathologies psychiatriques. Le service spécialisé pour adolescents du CHU, saturé, et avec des lits fermés, ne peut pas les accueillir, ou exceptionnellement. Le CAC (centre d’accueil de crise) du CHU a dû fermer, faute de psychiatre.
Le recrutement des médecins est compliqué. De moins en moins de jeunes médecins font le choix de la psychiatrie et quand ils le font, face à la dégradation des conditions de travail à l’hôpital, ils font le choix du libéral. En 2020, avant la pandémie, neuf psychiatres dans la trentaine qui s’étaient dirigés vers une carrière hospitalière ont fait le choix de quitter leur poste au CHRU de Tours. Comment faut-il le comprendre ? Le libéral permet d’avoir des patients moins lourds, pas de soins sous contrainte, dès que le patient est en crise, il peut être adressé vers les urgences de l’hôpital. Et si la pression financière est différente, la rémunération en début de carrière est bien plus élevée, sans comparaison à la rémunération hospitalière.
Nous avons jusqu’alors pu nous appuyer sur l’équipe infirmière maintenue à un effectif correct, non excessif, dans la moyenne nationale. Pour l’hospitalisation complète, le recrutement de jour était aléatoire, mais tous les postes étaient pourvus. Seul le recrutement de nuit est devenu extrêmement problématique. À tel point que l’encadrement a dû imposer en janvier 2022 un travail jour-nuit aux infirmiers. Il s’agit d’une pénibilité et donc d’une dégradation de la qualité de vie d’un professionnel. Nos infirmiers y ont consenti, soucieux de la continuité et de la qualité des soins.
Notre service fonctionne avec une enveloppe globale qui s’est maintenue et a même été revalorisée en 2019. Mais notre hôpital est en grand déficit, faute de services rentables, pas de chirurgie ni d’imagerie, la T2A a fait son œuvre. Pourtant, les équipes y travaillent sans relâche, dans l’ensemble de l’établissement.

La psychiatrie pour combler le déficit
C’est dans ce contexte que la direction de notre hôpital, soutenue par l’ARS, est décidée à demander à ses agents, cadres et médecins de réfléchir à des économies drastiques. Le service de psychiatrie, qui lui n’est pas déficitaire, doit faire un effort sur ses effectifs, et cet effort est de taille ! L’argent dévolu à la psychiatrie servira à combler le déficit créé par le système de financement des autres services.
La méthode de travail nous sera expliquée, nous dit-on, lors d’une réunion à laquelle seuls les chefs de service sont conviés, un lundi matin. Aucun de nous n’a été consulté sur ses disponibilités et le lundi matin est dans un hôpital une matinée bien remplie.
Je ferai le choix d’être auprès des patients. Si nous étions suspicieux, nous pourrions douter du désir de notre direction de nous voir à cette réunion, au regard du choix de sa date et de son horaire.
Par la suite, il ne sera plus question d’inviter les médecins aux prises de décisions. La direction fait le choix d’une adaptation des effectifs infirmiers et de transformations de postes d’infirmier en postes d’aide-soignant, au seul regard d’économies à faire et non pas en réfléchissant à faire évoluer les pratiques de soin.
Nous apprenons par les cadres et les syndicats qu’un quart des effectifs infirmiers des unités d’hospitalisation complète doit être supprimé, et la direction soumet son projet au vote des différentes instances qui régissent la vie hospitalière, sauf à la CME (commission médicale d’établissement).
En aucun cas, il n’a été question d’une décision en concertation avec les médecins, les cadres et la direction. Cela a pourtant été écrit dans un compte rendu, mais ça n’est pas la vérité.
Les méthodes employées par la direction nous étonnent et nous choquent. Bien sûr, nous baignons dans une logique comptable depuis des années, mais là, faire passer en force un projet en laissant croire qu’il s’agit d’une décision pluridisciplinaire, non, c’en est trop. M. Véran au Congrès de l’encéphale en janvier 2022, a dit : « La psychiatrie a été longtemps le parent pauvre de la médecine et est désormais son enfant chéri. »
Un mépris qui m’écœure
En France, la psychiatrie est en crise. Le gouvernement fait des annonces pour lui venir en aide, et a créé un groupe d’experts chargés d’identifier les facteurs de bon fonctionnement d’un service de soins psychiatriques.
La visite inopinée de la CGLPL (Contrôleure générale des lieux de privation de liberté) en février 2022 est venue mettre en lumière et souligner la qualité exceptionnelle des soins que nous dispensons en psychiatrie à Chinon. Nous avons le taux de recours à la chambre d’isolement le plus bas de France. Notre service fonctionne, mais la direction est décidée à le sacrifier face à un déficit que la suppression d’un quart des infirmiers du service d’intra de psychiatrie ne viendra très probablement jamais résoudre.
Ce mépris apparent de nos tutelles pour notre travail m’écœure. Interrogé par la CGLPL, qui l’alerte de notre situation, M. Véran reprend mot pour mot la réponse de notre direction, sans m’interroger ni me demander d’explication. Le soin hospitalier public, comme de nombreux médecins PH le clament sans être entendus, est en train d’être détruit. Les médecins sont peu écoutés ni soutenus, ils n’auraient pas le droit de se plaindre.
Est-ce parce qu’ils gagnent bien leur vie ? Certes, mais c’est au regard de leurs responsabilités et de la fameuse « charge mentale » qu’ils vivent au quotidien et qui ne fait que s’accroître.
L’exemple d’Orpéa me révolte. S’agit-il d’une transition réussie avec le privé ? On voit, me semble-t-il, les résultats d’une seule logique comptable. Doit-on faire de même avec l’hôpital ? C’est le chemin que cela prend et cela fait peur.
J’ai passé récemment une nuit pliée en deux sur un brancard dans le service des urgences d’une clinique privée de Tours. Le temps d’attente au CHU était de sept heures. Les infirmiers, débordés et stressés, y ont perdu tout sens de l’accueil, pas de bonjour, pas de parole de réconfort à quelqu’un qui arrive souffrant. Quand j’ai demandé un verre d’eau au petit matin, l’infirmière m’a expliqué qu’elle n’avait pas le temps et que, de toute façon, je ne pouvais pas avoir soif car j’étais perfusée. Je n’ai pas eu de verre d’eau. Elle ne se rendait même plus compte qu’elle était maltraitante. Voilà l’état de l’outil de santé en France.
En ce qui me concerne, j’ai l’impression d’une génération de patients et de soignants sacrifiée. En tant que médecins, nous avons passé un concours très difficile, très stressant, dont personne n’a pris soin de mesurer l’impact et maintenant, nous croulons sous le travail, incapables de répondre de manière satisfaisante aux besoins des patients, ou alors au mépris de notre propre santé. Tous mes collègues médecins de l’hôpital où je travaille sont en souffrance. Les cadres également et les infirmiers de certains services, et bientôt du nôtre. Les revalorisations salariales infirmières ont été un signal positif. Pour les médecins, elles ne profiteront qu’à la jeune génération, les PH déjà engagés ne sont pas concernés. Pour atteindre le dernier échelon, il faudra que je travaille jusqu’à la veille de mes 68 ans.
Tout cela n’a plus de sens.
Marion Baudry