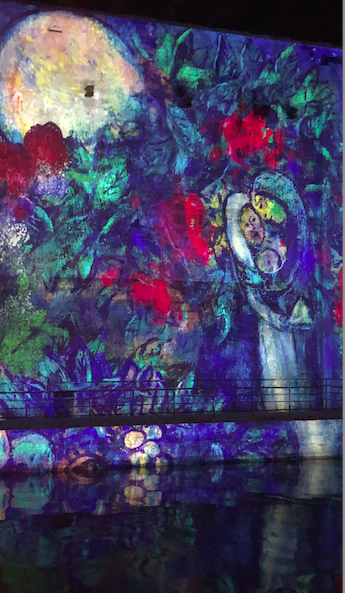
Dès sa création, en 2002, nous avons été confrontés au Centre d’éthique clinique aux dilemmes éthiques posés par la prise en charge médicosociale des personnes vieilles. Ces dilemmes éthiques consistant par exemple à s’interroger pour savoir jusqu’où la médecine doit tenir compte de l’âge dans ses prises en charge, à partir de quand elle en fait trop ou pas assez, si l’on peut « institutionnaliser » quelqu’un contre son gré, qui doit en décider et quelle est la place qu’il convient de réserver en la matière à ce qu’expriment les premiers intéressés, c’est-à-dire les vieux eux-mêmes. Notre expérience nous a conduits à conclure que ce dernier point était particulièrement difficile à explorer et trop facilement laissé pour compte dans les décisions prises à chaud concernant ces personnes. C’est pourquoi, dans le mouvement en cours depuis quelques années d’une attention accrue portée aux droits des malades et au respect de leur autonomie, il nous est apparu important d’initier une recherche pour approfondir la question de savoir ce que les vieux pensent de leur vieillesse, ce qu’ils ont à en dire, ce qu’ils attendent de la société en général et de la médecine en particulier à cette époque de leur vie. Anticipent-ils d’être un jour confrontés à un état où ils ne pourront plus décider pour eux-mêmes ? Le craignent-ils ? Comment gèrent-ils cette crainte ?

Évaluer « la bascule »
L’objet principal de cette recherche, portée à la fois par le Centre d’éthique clinique et l’association Vieux et chez soi et financée par la Fondation de France, a donc été le suivant : entendre, comprendre et faire valoir ce que disent celles et ceux qui craignent de ne plus être suffisamment entendu(e)s le jour venu, du fait de leur avancée en âge et en vulnérabilité.
Notre hypothèse originelle était qu’on pouvait, en devenant âgé, être habité par la crainte de se faire déposséder, à un moment ou à un autre, du sens de sa vie et de la possibilité de la poursuivre telle qu’on l’entend. Nous avons appelé ce moment « la bascule » et imaginé que les personnes vieilles pouvaient craindre d’être confrontées à cette dernière à l’occasion, par exemple, d’une « institutionnalisation » non désirée, d’une médicalisation jugée excessive et non vraiment consentie, de modalités de fin de vie non conformes à ce qu’elles auraient souhaité, ou encore d’une place non adéquate des proches dans les décisions à prendre pour elles-mêmes.
Pour vérifier notre hypothèse, nous avons choisi de travailler de la façon suivante. Nous voulions rencontrer des personnes vivant encore chez elles et ayant refusé jusque-là l’institutionnalisation, ayant déjà ressenti la crainte de « la bascule » ou âgées de plus de 90 ans, avec l’idée qu’à cet âge ce risque de bascule n’est plus très loin, même s’il n’a pas été encore expérimenté. Nous voulions aussi avoir un recrutement aussi diversifié que possible, en termes géographiques autant que socioéconomiques. C’est pourquoi nous avons choisi d’avoir plusieurs lieux de recrutement, à la fois à Paris, en Île-de-France, et en région, dans des zones urbaines autant que rurales, et par le biais d’« agents recruteurs » de différentes origines socioprofessionnelles, médecins, travailleurs sociaux ou membres d’associations.
Notre outil de recherche a consisté en des entretiens à bâtons rompus menés en face-à-face avec ces personnes vieilles, de type entretiens narratifs. Les entretiens duraient environ une heure et commençaient toujours par vérifier le consentement de la personne à participer à la recherche. Ils étaient menés par des chercheurs, rompus à ce type d’exercice, travaillant toujours en binômes. Les entretiens devaient être répétés tous les 6 à 12 mois à partir de la date d’inclusion dans l’étude pour vérifier comment évoluaient ces personnes dans leur positionnement vis-à-vis de la question à l’étude. Le contenu des entretiens a été analysé grâce aux méthodes de référence en matière de recherche qualitative, notamment les méthodes dites de « thématisation séquentielle » et de « grounded theory ».
En décembre 2021, la population suivie était de 100 personnes, dont 58 avaient déjà été vues deux fois et 20 plus de deux fois ; 56 habitaient Paris, 12 en Île-de-France en dehors de Paris, 12 dans des villes de province (Maubeuge et Montpellier), 20 en milieu rural (2 en Bretagne et 18 en Gironde). 75% étaient des femmes, l’âge moyen des personnes incluses était de 89,5 ans ; 65% vivaient seules, 16% en couple et 19% avec quelqu’un d’autre (enfant, petit-enfant ou personne tierce) ; 84% se disaient entourées ou très entourées, 9% peu entourées et 7% très isolées. Dans l’ensemble, ces vieux et vieilles étaient encore bien autonomes : 52% n’avaient besoin d’aucune aide au quotidien, 21% avaient besoin d’un peu d’aide (aides aux courses, travaux ménagers, portage des repas, distribution de médicaments), 21% nécessitaient des passages infirmiers ou d’auxiliaires de vie plusieurs fois par semaine, voire quotidiennement ; 6% étaient complètement dépendants bien que vivant à domicile.

Des résultats surprenants
Sur le plan qualitatif, les résultats de l’étude nous ont franchement surpris. Toutes nos hypothèses de départ ont été infirmées. Tout d’abord, les vieux et vieilles que nous avons rencontrés ont déconstruit notre concept de bascule en tant que risque qu’ils souhaiteraient anticiper. Pour eux, on peut être un jour à la bascule et le lendemain ne plus y être. En tout cas, si l’on y est, on fait tout pour en sortir. C’est un risque que l’on craint certes, mais sur lequel on ne souhaite pas s’appesantir, que l’on ne veut pas anticiper, c’est la condition sine qua non pour continuer de vivre bien. Les vieux refusent de se laisser envahir par la crainte de la bascule.
Leur rapport à la médecine est lui aussi différent de celui que nous avions imaginé. Ils parlent peu de leur santé, de leurs maladies, ils considèrent que ce n’est pas intéressant ; s’il arrive quelque chose, ils feront avec, mais ce n’est pas la peine de s’en soucier avant, les choses arrivent toujours différemment de ce que l’on avait imaginé. La médicalisation signe pour eux l’avancée en âge et la diminution de leurs capacités. Ils font ce qu’il y a à faire pour se soigner, mais tiennent le plus possible la médecine à distance, en refusant là aussi de se laisser envahir par elle. La santé est une occupation, mais elle n’est pas une préoccupation. La préoccupation est plutôt liée à la menace de la dépendance. Ils craignent davantage de ne plus pouvoir marcher, voir, entendre que de tomber gravement malade. On remarque qu’à cet égard, ils réagissent à l’opposé des médecins qui généralement se préoccupent plus pour eux de ce qu’ils considèrent comme vraiment pathologique que de leurs petits soucis de marche, de vision ou d’audition.
Quant à la nécessité de devoir aller un jour en Ehpad, c’est certes une crainte, mais là encore, les personnes que nous avons rencontrées sont moins définitives qu’on aurait pu s’y attendre. Beaucoup disent : « S’il le faut… ». Elles se disent prêtes à s’y résoudre le jour où il le faudra, notamment pour rassurer, ou surtout soulager leurs enfants : surtout ne pas peser sur eux. Du reste, sur ce point, nos hypothèses ne se sont pas confirmées non plus. Les enfants sont le plus souvent vécus comme protecteurs et prêts à défendre les choix des parents contre les services sociaux et/ou médicaux plutôt que l’inverse. Quant à la fin de vie, on ne souhaite pas non plus ni l’anticiper, ni y penser, ni en parler. Alors que le sujet était systématiquement abordé par les chercheurs, très peu de nos enquêtés se sont saisis de l’occasion pour entamer la discussion. Surtout, là encore, ne pas anticiper. Comme si on continuait à cet âge de faire le même pari sur la vie qu’à tout âge, comme si c’était essentiel pour continuer de vivre bien, même si 25% d’entre eux disaient avoir écrit des directives anticipées et désigné une personne de confiance.
Globalement, on retient de ces entretiens que les deux choses les plus importantes pour ceux que nous avons rencontrés étaient : 1) de continuer la vie d’avant, au plus près de ce qu’elle était ; 2) de rester en lien socialement, et surtout avec des pairs, des personnes de sa génération, parce que c’est ce qui permet le mieux de continuer de se sentir appartenir à la société et au monde, de se sentir vivants.
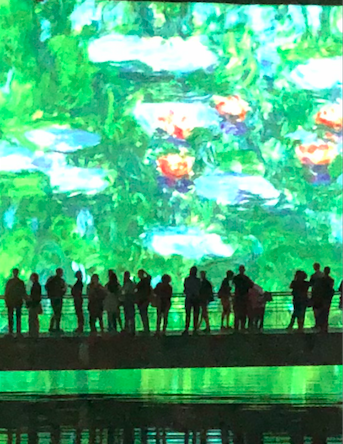
4 grandes catégories
Quels enseignements potentiellement utiles peut-on tirer de ces résultats pour mieux comprendre comment les vieilles et les vieux composent avec le grand âge ?
Il nous semble que l’on peut caractériser les personnes que nous avons rencontrées en fonction d’un élément dominant autour duquel elles organisaient leur vie au moment de nos rencontres. Selon nous, elles se répartissent en 4 grandes catégories :
- Celles pour qui la « vitalité » perdure inchangée, si bien que la vieillesse n’a (ne semble) pas (encore) avoir de prise ;
- Celles pour qui le mot-clé est « autonomie » ;
- Celles pour qui le mot-clé est « relation » ;
- Celles qui sont dans le « retrait », qui attendent que la vie se termine.
Celles et ceux que nous avons classés dans la catégorie « vitalité » gardent le même niveau de vitalité que celui qui a de tout temps été le leur. Cela peut durer jusqu’à un âge très avancé. Ils représentent 20% de ceux que nous avons rencontrés. Il y en a autant chez les hommes et chez les femmes, à Paris qu’en province ou à la campagne, ce n’est pas lié à leur niveau socioculturel, ni à leur niveau professionnel ou économique, mais peut-être davantage à l’appartenance à un réseau social, familial ou communautaire : clan familial nombreux et soudé, syndicat, club du 3e âge, association, communauté de voisinage agricole ou viticole, communauté professionnelle ou paraprofessionnelle, etc.
• Les personnes que nous avons rangées dans la catégorie « autonomie » étaient toutes des personnes pour qui le maintien de leur autonomie était devenu d’autant plus primordial que leur vitalité était entamée du fait de la vieillesse. Comme si elles faisaient en sorte de récupérer leur niveau de vitalité antérieur en s’appuyant sur ce qui avait toujours été important pour elles, l’affirmation de leur « soi », autrement dit de leur autonomie, celle-ci se déclinant de trois façons légèrement différentes selon les personnalités :
- Autonomie-maîtrise : je décide : ce qui compte, c’est moi et la façon dont je décide de ma vie, plus que ma liberté ou mon indépendance. Ceux-là pourraient accepter l’institutionnalisation, à la condition que cela soit eux qui la décident et qu’ils puissent formuler clairement pourquoi ils la décident.
- Autonomie-indépendance : je me débrouille : ce qui compte, c’est de continuer d’être indépendant, y compris si cela passe par la nécessité de se faire aider : la seule chose qui reste pour se sentir autonome est de préserver son indépendance. Surtout ne dépendre de personne, en tout cas pas de ses enfants, même si on leur demande leur aide ponctuellement. Et à ce titre, ne surtout pas aller en Ehpad.
- Autonomie-liberté : je fais ce que je veux quand je veux : ce qui compte, c’est de rester libre de décider de ce que l’on mange et à quelle heure. Pour ceux-là, le collectif est proprement insupportable… et les aides quelles qu’elles soient sont mal supportées.
Nous avons repéré 30% de militants de l’autonomie dans notre cohorte qui se répartissent à peu près également entre ces trois sous-catégories.
• Lorsque la vitalité commence à devenir un peu atteinte du fait de l’âge, d’autres se récupèrent non pas sur la défense de leur autonomie mais en investissant au maximum la relation à autrui. Parce que cela a toujours été un élément essentiel de leur vie. Ce sont souvent des gens qui s‘intéressent à la société, au monde en général, à la politique par exemple. Beaucoup ont été militants ou engagés dans une cause ou une autre. Selon nous, ils étaient 25% dans notre recrutement à faire partie de cette catégorie.
• Quant aux 15% restants, la vie au stade où nous les avons rencontrés s’organisait plutôt autour du mot-clé : retrait. Nous avons classé ainsi les personnes qui ne demandaient plus rien, s’exprimaient peu, étaient passives, peu gaies, laissaient filer, étaient dans l’attente… que la vie se termine.

Accompagner l’avancée en grand âge
Sans vouloir être simplistes ni réducteurs, notre hypothèse à partir de ces 4 catégories, est que la vieillesse suit assez généralement un parcours-type qui pourrait se schématiser de la façon suivante : tant qu’on est dans la vitalité, la vieillesse n’a pas de prise. Et on fait tout pour rester dans cette dynamique le plus longtemps possible. Le jour où on commence à être un peu atteint, on se maintient dans la vie et la vitalité à partir de ce qui a toujours été essentiel pour soi : l’affirmation du soi, ou la relation aux autres, ce qui correspond à des personnalités assez différentes. Cette deuxième période peut durer assez longtemps, elle est émaillée ou non d’accidents de santé ou de la vie qui font friser la bascule. Puis arrive un moment où on n’en peut/veut vraiment plus et où on finit dans le retrait, à moins que l’on ait eu avant un accident de santé définitif. Arrivé à ce stade, ce n’est plus vraiment la vie, et on souhaite en général que cette période ne s’éternise pas. Dans ce schéma, la notion de « bascule » est remplacée par la notion de « retrait ». Quand on y arrive, c’est un point de non-retour, on accepte et on revendique être rendu à la fin du parcours. Cette nouvelle hypothèse, de sortie d’étude, mérite d’être vérifiée. Elle justifie que nous suivions encore notre cohorte suffisamment longtemps pour voir si elle résiste dans le temps.
En conclusion, cette étude confirme ce que beaucoup ont déjà dit : la vieillesse est un sujet existentiel et social, plus que médical ou de dépendance. Les vieilles et vieux ne veulent pas se laisser envahir par des sujets qu’ils estiment secondaires. Pour eux, la maladie et la mort ne sont pas des préoccupations importantes. L’âge non plus. Peu importe de savoir si l’on est vieux, un peu vieux ou très vieux. On est occupé à continuer de gérer le quotidien le mieux possible et à tout faire pour rester dans la vie et dans la continuité de qui on a toujours été. On ne veut pas être considéré comme vulnérable, ni réduit à n’avoir plus que des relations d’assistance. On veut continuer d’exister comme des personnes et des citoyens à part entière. On a besoin de relations signifiantes, avec des personnes qui nous traitent d’égal à égal. Si l’on a besoin d’aide, il s’agit essentiellement d’aides à la mobilité et à la préservation de l’autonomie, ainsi que d’aides au maintien d’un minimum de lien social. Ces éléments devraient conduire à revisiter la façon dont on accompagne l’avancée en grand âge. Probablement, en se focalisant moins sur le médical et la médicalisation/sanitarisation de la vieillesse. Et en en faisant plus sur le plan social et citoyen : améliorer l’accès aux droits (rendre tous les droits individuels accessibles malgré la vieillesse) et l’inclusion dans la société. Le repérage des besoins de la personne à un temps t de son parcours pourrait être mieux ajusté si l’on s’intéressait à savoir de quelle personnalité il s’agit et non seulement de quelle maladie elle souffre : cela permettrait de maximiser les aides au maintien/entretien de l’autonomie résiduelle pour ceux pour qui l’autonomie est essentielle ; de maximiser le maintien dans un réseau social vivant de proximité pour ceux pour qui l’essentiel est la relation à l’autre ; et de ne pas méconnaître la difficulté à continuer de vivre pour ceux qui en sont rendus à la phase de retrait.
Véronique Fournier et Nicolas Foureur