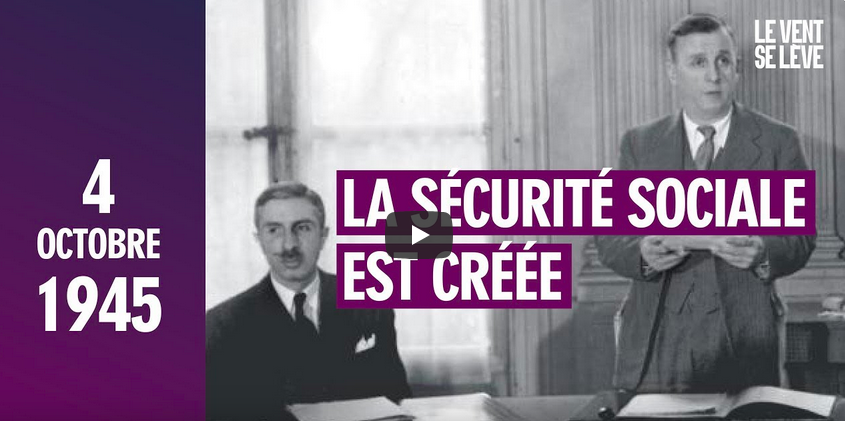
Nous célébrons cette année le 80e anniversaire de la création de la Sécurité sociale par les ordonnances des 4 et 5 octobre 1945, alors qu’Alexandre Parodi, gaulliste, compagnon de la Libération, était ministre du travail. La construction de la Sécurité sociale avec ses nombreuses Caisses primaires d’assurance maladie (une ou plusieurs par département) sera l’œuvre de son successeur, le communiste Ambroise Croizat, ministre à partir du 21 novembre 1945, aidé par le directeur général Pierre Laroque. Cette construction se fera en grande partie grâce à la mobilisation des militants de la CGT. Depuis sa création, la Sécu est attaquée. Les médecins libéraux, le patronat et la droite politique estiment qu’elle « déresponsabilise » les assurés et qu’elle coûte trop cher aux entreprises. La Fédération nationale de la Mutualité lui reproche son caractère obligatoire et sa gestion bureaucratique. À partir de 1967 apparaît dans le discours politique le TROU de la Sécu qui justifie le changement de gouvernance pour réduire les dépenses grâce à une limitation des prises en charge et à une privatisation progressive de la santé. Cette privatisation se fait en suivant la technique du salami, débitant au fil des ans des tranches fines de transfert des dépenses publiques vers les assurances de santé privées dites « complémentaires », si bien que la France est le seul pays de l’OCDE qui a deux financeurs pour le même soin. Nos dépenses de gestion du système de santé sont le double de la moyenne de celles des pays de l’OCDE. Comment est-on arrivé là ?
En 1944, le CNR prend position pour « un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État » (c’est nous qui soulignons). Cette formulation évoque l’État-providence avec un système national de santé gratuite géré par l’État tel qu’il sera mis en œuvre en 1948 en Angleterre en application du rapport Beveridge. Ce n’est pas ce qui a été appliqué en 1945 en France, pour deux raisons majeures : 1) L’État a été discrédité par Vichy, il est à reconstruire alors que les organisations syndicales liées à la Résistance sont puissantes ; 2) La médecine libérale historique est hostile à toute étatisation. Cette hostilité remonte à 1793, date de la création par la Révolution des officiers de santé dont les médecins diplômés n’auront de cesse de combattre l’existence et finiront par obtenir la suppression en 1892. La Sécurité sociale est donc créée en 1945 selon le modèle allemand de caisses dit « bismarckien ». La Sécu est un organisme de droit privé, indépendant de l’État, financé par des cotisations payées par les salariés et les patrons et géré par les partenaires sociaux. Mais le grand patronat français, largement discrédité en raison de sa collaboration avec l’occupant, devra à la Libération se contenter d’un quart de la représentation au conseil d’administration, tandis que les trois quarts reviennent aux confédérations syndicales ouvrières. La CTFC, opposée au caractère obligatoire de l’adhésion à la Sécurité sociale, boycotte les premières élections et laisse toute la place à la CGT. À la différence de l’Allemagne, les syndicats de médecins libéraux français refusent aussi de participer à la gestion des caisses. Contre l’État, ils sont également opposés à « Madame LACAISSE » qui, selon eux, veut les fonctionnariser. Finalement, contrairement à la déclaration du CNR de 1944, la Sécurité sociale ne couvre pas tous les citoyens mais seulement les salariés. Il faudra attendre la création de la CMU en 1999 par Martine Aubry pour généraliser à tous les citoyens la prise en charge par l’Assurance maladie, jusque-là réservée aux seuls salariés. L’importance des indemnités journalières dans les dépenses de santé de l’après-guerre légitimait pleinement la place de la démocratie sociale dans la gestion de la Sécu, comme c’est logiquement le cas pour les accidents du travail ou l’assurance chômage. À cette époque, il n’y avait ni transplantations d’organes, ni services de réanimation ou unités de soins intensifs, ni dialyse rénale…
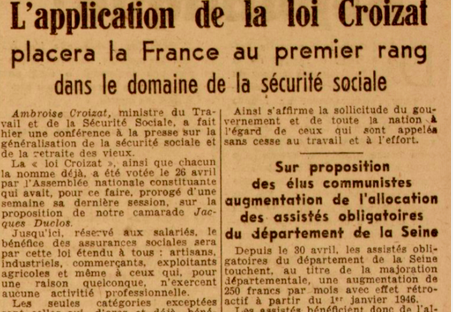
En 1945, la Mutualité est divisée. La Fédération nationale de la Mutualité compromise par sa collaboration avec Vichy est hostile à la création de la Sécurité sociale au nom du principe fondamental de la libre adhésion individuelle, critère de la responsabilité personnelle des adhérents autogérant leur mutuelle. À l’opposé, les mutuelles locales et les mutuelles de fonctionnaires liées aux organisations syndicales sont favorables à la Sécurité sociale et leurs militants participent parfois à sa construction. Quoi qu’il en soit, la création de la Sécurité sociale est une menace pour l’existence même des mutuelles. Pour rallier la Mutualité à la Sécurité sociale, deux décisions vont être approuvées par l’ensemble des partis politiques, y compris le parti communiste : 1) On crée le « ticket modérateur » de 20% que pourront prendre en charge les mutuelles, la Sécu ne devant pas rembourser plus de 80% du coût des soins, à l’exception des affections longues et coûteuses; 2) La loi Morice de 1947 dite « en défense des intérêts de la Mutualité » va autoriser les mutuelles de fonctionnaires à gérer par délégation l’Assurance maladie obligatoire, tout en interdisant aux caisses de la Sécurité sociale de créer leurs propres mutuelles, à l’exception toutefois du régime Alsace-Moselle. Pour des raisons historiques, la caisse de la Sécu d’Alsace-Moselle cogère avec les représentants élus des salariés du secteur privé une Mutuelle obligatoire. Le régime Alsace-Moselle peut ainsi échapper à la concurrence et faire l’économie du doublon de frais de gestion inutile que connaît le reste du pays.
Les relations à quatre entre la Sécurité sociale, les assurances privées dites « complémentaires », l’État et les médecins vont se traduire par une étatisation progressive de la gouvernance de la Sécu et une privatisation croissante des prestations rentables ou rentabilisables. Quelques dates essentielles jalonnent cette évolution.
1) Du côté des médecins
– 1958. La réforme Debré crée les CHU, instaure le plein-temps hospitalier mais concède aux libéraux, en particulier aux chirurgiens, l’existence d’un secteur privé à honoraires libres. Robert Debré pensait que cette concession du privé à l’hôpital public ne durerait qu’une génération. Son petit-fils urologue à Cochin lui a donné tort. En 1973, Robert Debré retraité explique devant un parterre de « patrons» en médecine qu’il n’a fait que la moitié du travail. « Ce que j’ai fait avec la biologie, vous devrez le faire avec la santé publique ». Il est écouté mais pas entendu. Aujourd’hui, le propos est entendu mais toujours pas appliqué
– En 1971 est signée la première convention nationale entre la Sécu et le premier syndicat des médecins libéraux installés en ville, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). La CSMF le paie d’une scission des médecins opposés au conventionnement qui forment la Fédération des médecins de France (FMF). Au fil des ans, les scissions successives se feront en défense du libéralisme. La dernière en date, l’Union française pour une médecine libre (UFML) aux accents poujadistes, réclame la liberté tarifaire pour tous les médecins.
– En 1980, Raymond Barre crée le secteur 2 conventionné à honoraires libres (un véritable oxymore) réservé aux anciens chefs de clinique, c’est-à-dire pour l’essentiel aux spécialistes. Le choix de l’installation en secteur 2 par les nouveaux spécialistes augmente année après année. Les dépassements d’honoraires atteignent aujourd’hui 4,5 Mds d’euros. Fait hautement significatif, la CSMF, signataire de la première convention nationale, s’était prononcée en 1980 contre la création du secteur 2 qui avait par contre reçu l’assentiment de la FMF, opposée au conventionnement national. Le secteur 2 apparaît ainsi dès sa création comme une machine de guerre pour détruire la Sécu.
2) Du côté des assurances « complémentaires »
– 1989, Claude Évin ministre socialiste de la santé organise la concurrence entre les trois complémentaires santés : les mutuelles, les instituts de prévoyance (IP) et les compagnies d’assurance.
– 1991, René Teulade, président socialiste de la Mutualité, convainc le mouvement d’accepter la directive européenne assurantielle en échange d’une promesse de Bruxelles d’élaborer un document spécifique pour les mutuelles, promesse qui ne sera pas tenue. Désormais, les mutuelles doivent se conformer aux mêmes règles que les compagnies d‘assurance à but lucratif. Elles doivent séparer leur activité assurantielle de la gestion des établissements de santé, elles doivent avoir une réserve financière « prudentielle » et leurs administratifs et gestionnaires doivent se professionnaliser. Finalement, la concurrence oblige les mutuelles à ressembler à leurs concurrents : faire payer plus les patients à risque en majorant le taux des cotisations des personnes âgées, diversifier l’offre, allant jusqu’à proposer la prise en charge de médecines dites « douces », réaliser des économies d’échelle grâce à des fusions-acquisitions (selon la DRESS, le nombre de mutuelles a été divisé par presque six en vingt ans). Ainsi, les différences s’amenuisent entre les différents assureurs santé regroupés en 2004 dans l’Union nationale des organismes complémentaires de l’assurance maladie (Unocam), remboursant seulement 13% des soins, mais censée faire le pendant de l’Union des caisses d’assurance maladie de la Sécu (Uncam), remboursant près de 80% des soins. Il s’agit de faire rentrer dans la tête des gens l’idée que l’Assurance maladie repose sur deux jambes et qu’ils ont bien de la chance d’avoir une « bonne mutuelle ».
– 2013, François Hollande, président socialiste de la République, instaure avec l’Accord national interprofessionnel (ANI) l’assurance complémentaire privée obligatoire d’entreprise, d’abord dans le secteur privé puis, à partir de 2025, dans la fonction publique. Fini les sacro-saints principes mutualistes qui avaient justifié en 1945 l’opposition de la FNMF à la Sécurité sociale. Plus question d’adhésion volontaire, plus question d’adhésion individuelle, mais un contrat collectif négocié par chaque entreprise avec les complémentaires mises en concurrence, un accord imposé aux salariés. Il s’agissait certes d’une avancée pour les deux millions de salariés du privé qui n’avaient pas de complémentaire mais d’une reculade par rapport au principe de solidarité, dans la mesure où les chômeurs et les retraités n’étaient pas directement concernés. Les retraités, qui ont vu le montant de leur souscription individuelle à leur mutuelle augmenter, furent les perdants de l’ANI.
Comment s’expliquent les liens entre la Mutualité et le Parti socialiste, alors que les assurances complémentaires sont moins solidaires, moins égalitaires et moins efficientes que la Sécu, avec 8,2 Mds de frais de gestion pour les complémentaires, contre seulement 6,8 Mds pour la Sécu ? La nature de ces liens historiques est à la fois matérielle (financière), idéologique, voire spirituelle, pour nombre de leurs responsables.
3) Parallèlement, la Sécurité sociale va évoluer
En 1967, le paritarisme entre patronat et syndicats prend la place de la démocratie sociale instaurée en 1945. À partir de 1996 (plan Juppé), on assiste à une étatisation progressive de la gouvernance avec en 2004 la nomination du directeur général de la Sécu par le gouvernement pour un mandat de cinq ans avec des pouvoirs étendus, tandis que le Conseil de l’Assurance maladie inclut désormais les représentants des associations de patients et de la Mutualité. Le trou grandissant de la Sécu, dû à la différence programmée entre les dépenses et les recettes (avec des dépenses indues et des recettes confisquées), va largement déterminer la politique de santé marquée par un transfert progressif de la prise en charge des soins courants (hors hospitalisation et hors affections de longue durée, ALD) aux complémentaires. Cette prise en charge des soins courants par les mutuelles dépasse aujourd’hui 50%. Pour accroître les recettes en période de chômage, sans augmenter les cotisations liées au travail, Michel Rocard invente la CSG (contribution sociale généralisée) qui a une assiette plus large que les cotisations mais une moindre progressivité (il faudrait la transformer en « cotisation sociale généralisée », comme le propose la FSU). En 1996, Alain Juppé crée la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) qui finance la dette de la Sécu en empruntant sur les marchés financiers et paie chaque année les intérêts des emprunts grâce à un nouvel impôt, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Depuis la création de la Cades, 79 Mds d’euros ont ainsi été remboursés aux financeurs privés. Enfin, depuis 2017 et l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, les exonérations et diminutions des cotisations patronales ont considérablement augmenté, remplacées par la TVA. Cet impôt sur la consommation est socialement le plus injuste, à l’opposé du principe de la Sécurité sociale assurant la solidarité entre riches et moins fortunés. La TVA représente à ce jour 20% des recettes de l’Assurance maladie.

En guise de conclusion
La crise budgétaire actuelle et la dette de la Sécu vont être l’occasion d’augmenter le reste à charge (RAC) des assurés après la prise en charge par la Sécu. Ce RAC sera payé directement de la poche des patients ou indirectement par les assurances privées complémentaires. Celles-ci ne manqueront pas d’en répercuter automatiquement le coût sur le montant des cotisations annuelles versées par les adhérents. C’est ce que prévoyaient Michel Barnier (augmentation du ticket modérateur) et François Bayrou (limitation des ALD), tous deux adeptes du même principe : « La dépense publique c’est mal tandis que la dépense privée c’est bien », même si cette dernière est contrainte, de fait obligatoire, socialement moins juste et financièrement moins efficiente.
Célébrer les 80 ans de la Sécu ne devrait donc pas consister seulement à rappeler avec fierté et nostalgie l’histoire glorieuse de sa création, tout en se contentant aujourd’hui d’une défense à reculons pied à pied. Il s’agit de reprendre l’offensive en proposant la Sécu 100% conformément à l’esprit et à la lettre du CNR de 1944. La pandémie avait un bref moment éclairé le Président Macron : « Ce que révèle d’ores et déjà cette pandémie, c’est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours et de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe ». La Sécu 100% 2025 devrait bénéficier d’une nouvelle gouvernance assurant la cogestion entre l’État et les représentants élus de la démocratie sociale et de la démocratie sanitaire incluant les professionnels de santé.
Et au final, la taxe Zucman et la nouvelle Sécu 100% seraient deux mesures de rupture susceptibles de rassembler une grande majorité de la population.
André Grimaldi