En France, les médicaments connaissent un problème de financement,
de justice et de raison.
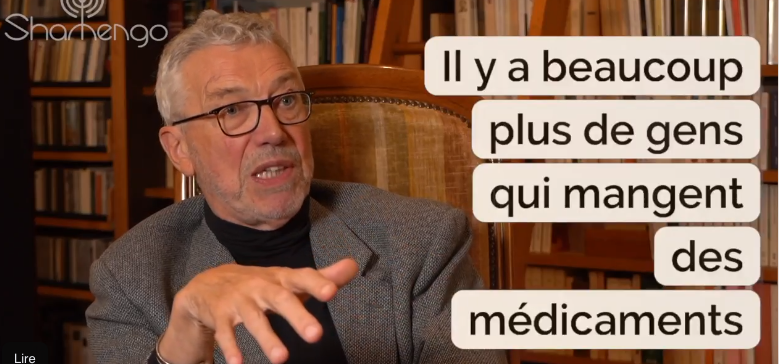
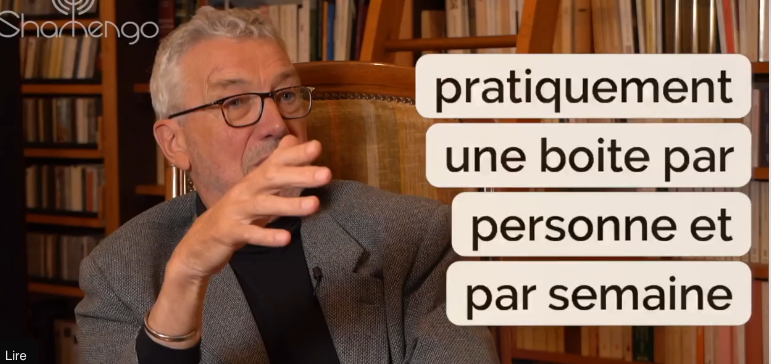
Quelques chiffres d’abord : un budget de la Sécurité sociale de 470 milliards d’euros, largement supérieur à celui de l’État. Dans ce budget, celui de l’Assurance maladie pèse 247 milliards d’euros. Chaque année, la marge de progression des dépenses (généralement 2 à 3%), l’Ondam (Objectif national de dépenses d’assurance maladie), est longuement négociée puis adoptée par le Parlement.
Or – et c’est une première incongruité –, ce budget est saucissonné, coupé en silos, avec une répartition fixée à l’avance entre, par exemple, les dépenses pour la médecine libérale, le budget pour les hôpitaux, les médicaments, etc. Chacune de ces enveloppes est regardée, gérée (par des directions et des administrations différentes) sans réelle vision globale, alors que tout s’interpénètre ; plus on augmente le nombre de médecins, plus les prescriptions s’accroissent, certains traitements peuvent raccourcir ou, au contraire, entraîner des hospitalisations, etc. Cette absence de politique globale, de gestion intégrée explique en bonne part les problèmes auxquels nous n’arrivons plus à faire face. En bonne gestion, il faudrait faire le chemin inverse : partir d’une cartographie de la santé, voir ce qui peut être abordé par les soins, la prévention, etc. Bref, se fixer des priorités, en sachant que l’on ne pourra pas tout faire, puis définir des budgets. L’exact opposé de ce qui est fait, qui consiste à partir des moyens alloués et à demander aux besoins de s’adapter. Un peu comme si pour ses dépenses nourriture, un ménage se fixait chaque début d’année, et invariablement, un budget pain, un budget produits laitiers, un budget condiments, etc., sans se poser la question des besoins globaux ou simplement des envies.
Dépenser plus ici, raboter là
Deuxième constat ; il est clair que, dans un budget en tension qui craque de partout, l’enveloppe de 30 milliards d’euros dévolue aux médicaments ne va plus augmenter, ou très peu. Donc, si l’on accepte de dépenser plus ici, il va falloir raboter là. Comme chaque année, on ouvre le marché à de nouveaux traitements toujours (beaucoup) plus chers, il faut faire du ménage. Sans trop de discernement ni considérations de santé publique : diminution ou suppression du taux de remboursement par l’Assurance maladie, et, surtout, baisses de prix imposées à répétition. À tel point qu’au fil des années, on arrive à une situation absurde : des médicaments relativement anciens mais majeurs car indispensables à la prise en charge de maladies graves (cardiovasculaire, psychiatrie, diabète, infections, etc.) valent 2 à 4 euros en pharmacie, soit un prix ridicule en sortie d’usine. C’est non seulement une inversion de l’échelle des valeurs (un mois de traitement vital pour le prix d’un café et trois fois moins qu’une place de cinéma) mais cela rend, de plus, ces produits absolument non fabricables en France ou en Europe. Cette politique à courte vue a mené à la délocalisation massive des chaînes de production et nous rend dépendants de territoires géopolitiquement sensibles pour 80% de nos soins les plus essentiels ; ce qui ne paraît pas, du reste, émouvoir outre mesure nos responsables politiques. Une autre conséquence de cette délocalisation avec son approvisionnement en flux tendu sont les pénuries dont la fréquence augmente et fait peser une autre menace sur la continuité des soins. Tout ceci n’existait pas, et pour cause, il y a vingt ans.
Pouvait-on et peut-on faire autrement ? Clairement oui.
D’abord, en réduisant les volumes remboursés en jouant sur le gaspillage (plusieurs milliards d’euros par an). Rappelons un seul chiffre : 51 boîtes de médicaments consommées en moyenne par an et par Français, soit une par semaine ; presque 70% par les plus âgés avec une bonne part de médicalisation inutile de symptômes liés au vieillissement. La France bat des records dans le mésusage avec des utilisations hors justification dépassant souvent 50% de ce qui est prescrit ou consommé. Les chiffres sont connus, les données précises et actualisées mais on continue de faire comme s’ils n’existaient pas. Totalement incompréhensible. Sur ce plan, l’affaire du Médiator® n’aura servi à rien.
Des prix stratosphériques
Il y a ensuite cet aveuglement pour l’autoproclamée « innovation » ; là, au contraire, on paye sans barguigner plusieurs dizaines de milliers d’euros, parfois plus, pour un seul traitement. Mille fois plus que pour un anti-hypertenseur, un antidiabétique, un antibiotique ou un corticoïde qui maintiennent en vie ou en bonne santé des millions de français. Mais là le piège a été bien tendu. Tout d’abord, parler d’innovation (qui se proclame) et non plus de progrès (qui doit se mesurer) ; un changement qui n’a rien d’anodin. Ensuite, persuader toute la chaîne (décideurs, prescripteurs, associations de malades) que ces traitements innovants doivent être mis le plus rapidement possible à disposition dans l’intérêt supérieur de la santé publique. Le fameux « accès précoce » auquel le lobby industriel est, on le comprend, particulièrement attaché : évaluation et étapes administratives réduites au minimum pour arriver à un prix qui peut être stratosphérique. Plus question de se fixer, comme autrefois, sur celui des concurrents (les innovations ne sauraient en connaître) ni même des thérapeutiques alternatives. Non : on considère ce que le nouveau traitement est censé faire économiser comme dépenses de soins en traitant ou faisant disparaître la maladie. Du moins si le médicament tient ses promesses, ce que l’on ne sait pas encore, l’évaluation n’étant pas encore stabilisée. Raisonnement que l’on s’est bien gardé d’appliquer aux médicaments plus anciens dont l’impact sur la santé publique, et les économies qui vont avec, sont bien mieux démontrés (ex : anti-hypertenseurs). En tout cas, un pari forcément perdant pour l’Assurance maladie puisque qu’elle paie une promesse et que si celle-ci est confirmée, les économies ne seront pas pour elle.
À l’inverse, pour l’industriel, ou plutôt ses actionnaires, le bénéfice peut être considérable. Nous sommes dans un système rapace, où les industriels, qui sont aujourd’hui plutôt des financiers, se positionnent dans des interstices, des maladies graves sans thérapeutique reconnue efficace, pour lesquelles toute nouveauté apparaît bonne à prendre. En plus, des associations de malades très actives font, on le comprend, un lobbying efficace pour obtenir un accès le plus précoce possible à ces nouvelles molécules. Parfois, sans discussion de fond sur comment aborder cette maladie, entre prévention, traitement médicamenteux ou pas. On le voit aujourd’hui avec la maladie d’Alzheimer. On n’a pas scientifiquement écarté le possible rôle néfaste des somnifères ou anxiolytiques dans la survenue ou l’anticipation de cette maladie, médicaments massivement utilisés sans justification en France. Mais qui s’en soucie ? On laisse les choses aller mais l’on est sur le point d’investir une somme considérable dans un traitement issu de la biotechnologie dont l’efficacité paraît assez limitée et la tolérance discutable.
Notre Assurance maladie nourrit l’industrie et les fonds de pension américains
On objectera que le problème du prix faramineux des thérapeutiques « innovantes » (5 milliards en 2023) n’est pas spécifique à la France. Exact, mais à deux nuances de taille près : dans beaucoup de pays (États Unis par exemple), les systèmes d’assurance santé paient certes cher mais veulent voir des résultats, et évaluent en fonction ; c’est tout sauf un chèque en blanc. Enfin, la majorité des entreprises de biotechnologie étant américaines, le citoyen peut se consoler en se disant que l’argent reste dans le pays et finance sa recherche et son capital innovation. Du fait d’un virage biotechnologique raté, rien de tel chez nous : notre assurance maladie nourrit l’industrie et les actionnaires et fonds de pension américains.
Tout ceci nous ramène au propos du début : il n’y a plus, en France, de politique de santé publique, pas de choix explicites en matière de médicament.
Prenons l’exemple de la première campagne de vaccination contre le papillomavirus, vendu autour de 100 et 120 euros la dose, avec un remboursement à 65%. Les populations défavorisées, souvent sans mutuelle généreuse, ont à juste titre rechigné à payer de leur poche les 105 euros restants (!) pour les 3 doses recommandées (à tort, du reste). Résultat : ce sont donc les jeunes filles qui en avaient le plus besoin (celles qui n’auront pas forcément la chance de bénéficier d’un suivi gynécologique prévenant) qui ont été, de beaucoup, les moins vaccinées. Mais qui se soucie de ces détails ?

Bernard Bégaud
La France malade du médicament, Bernard Bégaud,
Éditions de l’Observatoire