Gheel, un village belge plein de fous (1850)
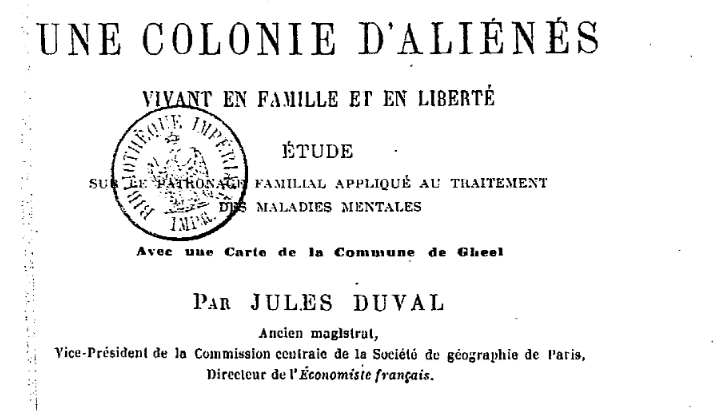
C’est une vieille histoire, mais elle existe toujours. Nous sommes en 1850, Jules Duval, ancien magistrat, vice-président de la Commission centrale de la Société de géographie de Paris et directeur de L’Économiste français publie chez Hachette une monographie sur la ville de Gheel en Belgique. Il entend ainsi participer à la réforme « du régime barbare de la séquestration, appliqué à tant de milliers d’aliénés inoffensifs ».
Car Gheel a adopté le « patronage familial ». En ce milieu de XIXe siècle, des trois principaux systèmes de prise en charge des « aliénés », le délaissement, les soins à domicile, la réclusion, c’est cette dernière qui domine. L’ancien juriste souhaite faire connaître ce qui est menée en Belgique dans une commune inconnue, Gheel, qui consiste à donner « la possibilité de laisser un très grand nombre d’aliénés de toute catégorie en possession de leur liberté corporelle, même de les associer à la vie et aux travaux des familles ». À son retour de Gheel, l’auteur livre un tableau complet de ce système de colonisation agricole. Il veut par cette publication en faire une utile publicité, qui amène d’opportunes imitations.
Près de deux cents ans plus tard, Gheel accueille toujours aujourd’hui des « malades mentaux ».
Extraits.
« Si l’on arrivait à Gheel, même au sortir d’un établissement d’aliénés, sans être prévenu du phénomène spécial qui caractérise cette localité, il y aurait grande chance pour que rien ne trahît le secret. Tout s’y passe, en apparence, comme dans les autres campagnes. Les rues calmes ou un peu animées, suivant le jour et l’heure ; aux fenêtres, quelques figures curieuses ; du monde au travail dans les jardins ; de rares oisifs sur la place publique ou dans les cabarets ; un aspect tranquille, sans apparence de vie active ou de commerce : la monotonie et le silence du village – voilà bien la surface. Mais si le voyageur est en quête d’une colonie excentrique signalée d’avance à sa curiosité, ou si, à titre de médecin aliéniste, il est familier avec les symptômes de la folie, çà et là il remarquera quelques allures tant soit peu bizarres : un passant qui prodigue les saluts ou les sourires, un promeneur absorbé dans les méditations solitaires, ayant l’œil fixé sur la terre ou égaré vers les cieux, un indiscret qui l’aborde brusquement. On ne l’a pas trompé : le voilà bien dans la capitale de la folie. Il questionne, et voici ce qu’il apprend. Sur le nombre total de 5 500 aliénés que l’on compte en Belgique, la commune de Gheel en reçoit de 800 à 1 000. La moitié environ vient de l’hospice de Bruxelles, qui n’a gardé, pour les aliénés non envoyés à Gheel, qu’un petit nombre de cellules annexées à son bel hospice civil de Saint-Jean. Les insensés de toute catégorie sont admis à Gheel, à l’exception néanmoins de ceux dont la maladie, trop dangereuse, exige l’emploi d’une contrainte continue, entre autres les monomanes homicides et incendiaires, ceux dont les évasions auraient été trop fréquentes, ou dont les affections pourraient troubler la décence publique. Quant aux maniaques, sujets seulement à des accès de fureur intermittente, ce sont, ainsi que nous l’expliquerons bientôt, les sujets les plus recherchés des paysans.
La commune de Gheel a si peu soigné sa propre renommée, quelques imperfections réelles ont été tellement exagérées, l’insouciance est d’ailleurs si grande chez tant de parents, que d’ordinaire les familles ne songent à y envoyer leurs malades qu’après avoir épuisé ailleurs des traitements plus vantés, et plutôt pour s’en débarrasser que pour les guérir. Aussi les incurables constituent-ils la majeure partie de la clientèle, et cela contribue encore à déconsidérer la colonie, en diminuant la proportion des guérisons et en augmentant celle de la mortalité. Dans l’admission, il n’est tenu aucun compte de la nationalité, du culte, de l’âge, du sexe, de la fortune. Tout le monde est accueilli avec une sincère sympathie, et reçoit, sauf la distinction des classes quant à la nourriture et au logement, les mêmes soins hygiéniques et médicaux. Après les Belges, qui naturellement sont en majorité, les Hollandais sont les plus nombreux ; viennent ensuite quelques Français et Allemands, plus rarement des Anglais ou des Scandinaves. Les communes et les hospices qui comptent plus de vingt malades sont autorisés à se faire représenter à Gheel par un délégué qui a voix consultative dans les assemblées de la commission administrative. La même fraternelle hospitalité se pratique pour tous les âges, les vieillards comme les enfants ; pour toutes les fortunes, les pauvres comme les riches ; pour toutes les éducations, les ignorants comme les lettrés. Le ton général du pays étant à la simplicité rustique, les riches peuvent s’y croire dépaysés, et ils y sont en effet en petite minorité. Ils y trouveraient peu ce luxe de construction ou d’ameublement par lequel on tente, dans quelques établissements particuliers, de prolonger, à des prix exorbitants, les jouissances et les illusions de la vie sociale, en déguisant les rigueurs de l’incarcération. Cependant il est à Gheel des familles bourgeoises dont les habitudes sont celles de la classe moyenne, et où les aliénés riches peuvent trouver les agréments d’une large aisance sinon les raffinements de l’opulence. Encore même est-il bien peu de jouissances utiles que l’on ne puisse obtenir en élevant le taux de la pension : à un prix incomparablement moindre que dans tout autre asile, on peut se procurer des distractions de tout genre, musique, jeux, promenades à pied, en voiture ou à cheval, livres et journaux, sans compter les amusements gratuits de la famille et de la commune. Les fantaisies de la richesse n’y sont même ni interdites, ni impossibles à satisfaire. On a vu parmi les aliénés de Gheel, un Anglais qui dépensait fort gaiement une grande fortune en fêtes, en chasses, en parties de plaisir. La différence des langues semble un inconvénient, le flamand, qui est l’idiome dominant du pays, étant peu connu au loin ; mais l’analogie de cet idiome avec l’allemand et le hollandais le rend facilement intelligible aux malades des deux nations les plus voisines ; et quant aux Français, ils trouvent leur langue parlée et comprise dans toutes les familles aisées de Gheel, où l’on a soin de les placer. Même ceux des nourriciers qui ne parlent ni le français ni l’allemand ont été mis par une longue habitude, en état de comprendre leurs pensionnaires étrangers. Au surplus, quelques mois de séjour et de conversations initient à peu près à une connaissance élémentaire du dialecte local, dont M. Parigot a rendu l’apprentissage facile en composant un cahier de dialogues en français et en flamand. La commune entière est catholique ; mais la liberté de conscience et de culte, qui, en Belgique, existe pour tout le monde, est plus sacrée encore pour l’insensé, dont la conversion ne saurait tenter aucun zèle. Il est à l’abri de toute tentative de prosélytisme. Le petit nombre d’aliénés protestants qui s’y trouve remplace le culte par la lecture des livres saints ; si néanmoins le besoin de la prière en commun les conduit à l’église, ils y sont admis sans difficulté. Aucun classement systématique, d’après la nature ou la gravité des maladies, ne préside à la distribution des aliénés dans les familles. Une telle précaution, qui a été signalée comme un grand progrès de la science médicale, peut avoir en effet sa raison d’être dans des asiles où les insensés, en contact perpétuel, doivent être assortis en quelque sorte méthodiquement, moins pour leur propre intérêt, qui réclamerait des contrastes aussi bien que des similitudes, que pour la commodité du médecin : réduit à tout gouverner par lui-même sans rien livrer à la nature, il rend sa tâche plus facile au moyen de divisions matérielles et logiques, qui sont l’équivalent de la division du travail dans l’ordre industriel. Dans une commune où l’asile est toujours une maison seule, une famille seule recevant deux ou trois aliénés au plus, les malades n’ont à craindre aucun heurt dangereux de leurs pareils. On se borne à éloigner du chef-lieu de la Campine les tapageurs ou bruyants, ainsi que ceux qui pourraient devenir dangereux au milieu d’une population compacte. Sauf ce triage, le médecin renonce à toute classification qui ne pourrait être qu’arbitraire, à peu près impossible, et finalement inutile. Le mélange même des sexes est considéré à Gheel comme exempt d’inconvénient. En admettant des membres adoptifs, la famille ne perd aucune de ses chastes et pures influences. Cependant, pour ne pas blesser de respectables scrupules, le règlement défend de placer dans la même maison hommes et femmes en même temps, sauf autorisation spéciale. Du reste, hors de la maison, les uns et les autres jouissent du droit commun, et quelques précautions suffisent pour éviter tout désordre. C’est que les aliénés valides sont occupés, distraits, par le travail au grand jour, et que par cela même la surveillance est plus facile. Le déshonneur, pour le nourricier, qui résulterait d’un accident redouble la vigilance de la famille. Votre curiosité est-elle éveillée par ces premiers renseignements, entrez à votre gré dans les maisons, à toute heure du jour librement ouvertes aux parents, aux amis, aux simples visiteurs, comme aux médecins et aux magistrats : même des frères, des sœurs, et autres parents des aliénés viennent à Gheel prodiguer à leurs proches les soins et les prévenances les plus tendres. Dès ce moment, on constate que le régime de la colonie diffère grandement de celui des autres établissements d’aliénés. Ailleurs nul ne pénètre qu’avec la permission du directeur et du médecin ; nul n’est admis, même le plus proche parent, à voir le malade qu’au moment jugé opportun par les chefs de la maison, l’expérience, prétend-on, ayant constaté que l’état maladif risque d’être aggravé, ou le cours d’une guérison interrompu, par de soudaines et vives impressions. Devant les recommandations de la science, devant les règlements de la maison, l’affection la plus dévouée doit se résigner. Combien d’abus cependant peuvent s’abriter derrière une telle rigueur ! Combien de parents, inquiets sur le traitement, sur le régime auquel de chers malades étaient soumis, ont déploré de ne pas pouvoir dissiper leurs alarmes en contrôlant les plaintes ! Est-ce toujours à tort que les cellules des hospices, que les chambres et les appartements-même des établissements particuliers, ont été qualifiés d’oubliettes ? À Gheel, l’asile, c’est ta maison même, toujours accessible, du bourgeois ou du cultivateur livrant tous ses secrets à qui se présente sous les auspices d’un habitant, et surtout de l’un des médecins, dont le zèle et la science sont mis, avec une complaisance infatigable, au service des visiteurs sérieux. Il est telles de ces maisons qui, par leur propreté, leur air d’aisance, leur simplicité de bon goût, supportent la comparaison avec les salles d’hôpital les mieux tenues. Chaque malade a l’usage exclusif d’une chambre de dimension variable suivant la fortune du propriétaire, mais toujours aérée, blanchie à la chaux, nettoyée, carrelée ou planchéiée : souvent il l’embellit d’images, la tapisse et l’orne à son goût. Les plus petites sont de véritables cellules de moines, toujours propres, sinon belles et spacieuses : huit mètres carrés de surface sur deux et demi de hauteur. Autrefois les chambres laissaient beaucoup à désirer, et il en reste encore quelques-unes qui ne sont pas à l’abri de tout reproche : mais d’année en année la réforme, imposée par M. Parigot, continuée par son successeur, sape les vieux abus et démolit les cases trop étroites. À chaque reconstruction, une part meilleure est faite à l’aliéné, qui trouve quelquefois le moyen de faire de sa chambre un atelier, un établi où il travaille s’il est ouvrier, et qui, dans la généralité des cas, n’y passe que la nuit. Le couchage est conforme aux usages de la maison et du pays, sauf exceptions motivées ; toujours sain, propre, garni de paille fraîche et souvent renouvelée. Il n’était pas inouï autrefois que l’aliéné partageât, suivant les mœurs simples de l’ancien temps, le lit de quelque membre de la famille ; aujourd’hui les défenses des règlements, et plus encore la délicatesse des mœurs, un peu moins grossières, ou, si l’on veut, moins fraternelles, ont mis fin à cet usage, qui n’est pas à regretter. La nourriture est également celle des maîtres de la maison, partout simple et frugale, mais suffisante et jamais rationnée, si ce n’est dans l’intérêt du malade. En ceci comme en bien d’autres points, les mœurs font plus que les arrêtés qui prescrivent la composition des repas : il n’est pas rare que le pensionnaire soit mieux nourri que le propriétaire, et si un prix supérieur de pension a été stipulé, les aliments sont préparés à part, même chez le paysan : ils consistent alors en viande de boucherie, en volailles, en petites gourmandises locales, suivant les conventions. Il n’y a d’alimentation un peu chétive à craindre que chez l’ouvrier de Gheel, qui achète tous ses vivres et doit viser dès lors à une économie plus sévère. Le régime peut encore laisser à désirer, quand l’âge ou des crises maladives exigent des soins exceptionnellement délicats et les ressources succulentes d’une infirmerie. En somme toutefois, il faut reconnaître que la bonne santé, l’embonpoint même des aliénés qui errent dans les rues, témoignent en faveur d’un régime où domine le pain de seigle (et par exception le pain de froment), les légumes, les pommes de terre, le laitage et la viande de porc. La bière est la boisson du pays : avec un supplément de prix, le vin peut être introduit, si le médecin ne le juge pas nuisible à la santé. Il est d’observation constante que l’aliéné se plie en peu de jours aux habitudes des repas réguliers dans la maison. Le vêtement, fourni d’abord par la famille, la commune ou l’hospice qui envoie le malade, est entretenu par le nourricier, mais renouvelé par l’administration au moyen d’une somme de trente francs prélevée sur le prix de pension. Aucune couleur ou forme particulière, aucune marque distinctive n’appellent l’attention publique : habillé comme les petits bourgeois de la commune, chaque aliéné se perd dans la foule. Le linge est d’ordinaire propre et suffisant. Ainsi se pratique, sans ostentation comme sans sacrifice, par le simple élan des cœurs et la puissance des habitudes, cette familiarité amicale d’existence, que l’on voit réalisée à peine dans quelques établissements, comme un rare privilège, pour des malades d’un titre exceptionnel. L’admission à la vie intérieure de la famille est à Gheel la loi commune, le droit commun, et quiconque tenterait de s’y soustraire serait frappé de déconsidération. Pour qui est habitué à l’opulence, pour qui n’a visité que les établissements fondés par la spéculation en vue des classes riches, l’aspect de Gheel et surtout des hameaux éloignés semblera certainement pauvre, mesquin, çà et là misérable. Il paraîtra un paradis à quiconque comparera le logement de ces aliénés, tout modeste qu’il soit, avec les infects taudis où végètent la population ouvrière de beaucoup de villes et la population agricole de beaucoup de campagnes. Gheel supportera avec non moins d’avantage la comparaison, balance faite des mérites et des inconvénients, avec les établissements fondés par la charité sociale et privée, notamment avec Bicêtre, la Salpêtrière et Charenton, qui pendant longtemps ont représenté, aux environs de Paris, les types administratifs les plus parfaits de ce genre d’institutions. Le luxe seul fait défaut à Gheel, tandis qu’il se montre quelquefois ailleurs dans le seul but de masquer la prison. Nous ne parlons que de ce que l’on pourrait appeler la vie de consommation et l’existence passive. Que dirons-nous de l’existence active ? À première vue, et sauf examen plus approfondi, celle-ci se développe à Gheel suivant des règles aussi humaines qu’intelligentes, qui découlent de deux principes : « Liberté, travail. »
La liberté sous toutes ses formes, tel est le bon génie de Gheel, celui qui a inspiré la colonie, qui la protège et la conserve. En tête, la liberté d’aller et de venir, qui peut provoquer la plaisanterie au frontispice d’une constitution, mais qui, pour un pauvre fou, est la plus précieuse de toutes ; puis la liberté de dormir ou de se lever, de travailler ou de se reposer, la liberté de lire, d’écrire, de parler à l’heure du caprice, même de correspondre au dehors. Ne pas contrarier l’aliéné, lui permettre toutes ses fantaisies tant qu’il n’y a dommage ni pour lui, ni pour son entourage, ne lui rien imposer de force, tout obtenir par l’attrait : telle est la science suprême du gouvernement des fous à Gheel. Voilà donc ce même homme, qui partout ailleurs est enfermé comme un être dangereux, dont la seule approche excite la terreur des femmes et des esprits timides, appelle les suspicions de la police ! À Gheel, il circule librement dans les maisons, hors des maisons, dans les rues et sur les routes, à travers les jardins et les champs. À moins d’inconvénients évidents ou particuliers, il entre dans les lieux publics, fume sa pipe au café, joue sa partie de cartes, lit ses journaux, boit son pot de bière avec ses voisins et camarades. Le vin seul et les liqueurs spiritueuses lui sont interdits, sous peine d’amende contre le cabaretier. Même les jours de marché, il n’est pas reclus ; on se borne à le faire surveiller de plus près par les gardiens, s’il est sujet à quelques écarts. Il vaque donc à ses affaires à son aise et sans trouble. Pour lui, la liberté, l’égalité et la fraternité, si elles n’ont pas de valeur politique, sont de précieuses réalités de la vie. Il est homme, et traité comme tel au même titre que tous ses frères en Dieu. Dans une telle condition, il ne peut échapper à personne des plaintes fondées, comme celle qui s’exhalait un jour de la poitrine d’un pauvre aliéné, enfermé dans un établissement, où l’entouraient pourtant des soins intelligents et dévoués : « On nous dit malades pour nous contraindre et nous opprimer, et on ne nous accorde pas les bénéfices des malades ! Souvent, lorsque j’ai mal dormi, je voudrais sommeiller le matin. Mais point : l’heure est arrivée ; la cloche sonne, il faut se lever, bon gré mal gré. Je ne suis donc plus un malade ! » À Gheel, il eût été invité à se lever ; on eût même insisté amicalement, s’il n’y avait pas eu d’excuse sérieuse ; mais on ne l’y aurait point forcé. Aucune cloche ne sonne la limite précise du sommeil et de la veille. Le plaisir et l’exemple de l’activité, l’approche des repas y sont de suffisants aiguillons contre l’attrait du lit. Il n’est fait violence au désir du repos qu’à titre de traitement médical et non à titre de règle uniforme de discipline. Le pauvre insensé, admis ainsi à participer à la vie de la famille, occupe sa place au foyer comme à la table. Si intime est le mélange de ces existences ; entre lesquelles la raison établit pourtant une profonde inégalité, qu’au premier abord on ne les distingue pas bien. De la femme qui prépare le dîner ou de celle qui le sert, l’une et l’autre rivalisant d’empressement et quelquefois de loquacité, quelle est la maîtresse saine d’esprit, quelle est la pensionnaire folle de son cerveau ? Écoutez, observez, et vous ne le déciderez souvent qu’au bout de quelques minutes d’examen attentif. Une fois admis ce terrible malheur de la raison perdue, rien de plus consolant, pensera-t-on assurément, qu’une telle existence. Mais la fréquence des accidents et des évasions n’en balance-t-elle pas largement les avantages ? Non : les accidents ne sont ni communs ni graves. Les querelles et les rixes sont facilement apaisées, fort rares d’ailleurs, ce qui dérive, à part même tout autre influence, de la tendance qu’ont les fous à s’isoler plutôt qu’à se rassembler, tendance qui n’est pas contrariée à Gheel. À l’égard des suicides, les faits ont dissipé les craintes. Les morts volontaires et violentes sont presque inconnues : on en a vu une seulement en 1850, une autre en 1851 ; rareté qui ne doit pas étonner, si l’on considère que la mélancolie qui enfante le dégoût de la vie peut souvent être calmée par ce changement de fond en comble de toute l’existence, et que le désespoir de l’incarcération n’y aggrave jamais la prédisposition naturelle. En même temps la dispersion dans des familles distinctes, souvent isolées, prévient tout danger d’imitation contagieuse. Quant aux attentats graves contre les personnes, on en compte seulement deux dans le cours d’un demi-siècle. Aussi la sécurité est-elle complète ; la rencontre d’un fou est aussi indifférente que celle de tout autre voisin, même pour les femmes et les enfants. Quand éclatent des accès intermittents de fureur, le nourricier et sa famille, aidés au besoin des voisins, les dominent aisément, et la rébellion devient d’autant plus rare que l’aliéné acquiert bien vite la conscience de la défaite certaine qui toujours l’attend. La fureur passe-t-elle à l’état chronique, on recourt aux moyens matériels de coercition, lesquels sont le plus souvent des caleçons ou camisoles de force. L’infirmerie offrirait au besoin ses ressources. Ainsi disparaît tout danger. À l’encontre de ce que l’on pourrait supposer, les évasions ne sont pas fréquentes : on n’en compte pas plus de quatre ou cinq par an. La piété envers sainte Dymphne est une chaîne invisible : en fuyant le pays, en s’éloignant de son église, les aliénés perdraient son puissant patronage. Pourquoi d’ailleurs tenteraient-ils de s’emparer par force où par ruse d’un bien dont ils jouissent ? S’ils sont dépaysés, ils possèdent du moins dans cet exil temporaire toute la liberté qu’ils pourraient chercher ailleurs. Comme cependant les insensés ne raisonnent pas ou raisonnent mal, on a dû organiser tout un système de mesures pour déjouer les tentatives d’évasion. À la première disparition d’un pensionnaire, le nourricier en avise le bureau administratif de Gheel, qui met tout de suite en mouvement les gardiens, la police, la gendarmerie, les autorités locales. D’ordinaire, l’intervention de tous ces agents est rendue inutile par le concours spontané de la population. Il est passé dans les mœurs publiques, à plusieurs lieues à la ronde, que tout individu dont les allures font suspecter la folie – et dans le pays on s’y connaît – soit reconduit à Gheel comme à sa résidence légale. Une prime d’un franc par lieue de parcours, accordée à quiconque ramènera un aliéné, stimule le bon vouloir de chacun. Ainsi se pratique surtout le territoire de la commune, et même en dehors, une surveillance générale et permanente qui déjoue la plupart des tentatives d’évasion. On admettra qu’elles doivent rarement réussir, si l’on considère qu’en suivant les routes battues, l’aliéné risque d’être reconnu et atteint ; s’il veut se sauver à travers les landes, son vagabondage accuse ses projets, et facilite son arrestation dans un pays découvert. Comme néanmoins ces mesures n’ont pas toujours suffi, l’usage s’est établi de temps immémorial d’entraver par des anneaux et dès chaînettes aux pieds les aliénés qui manifestent quelque tendance à s’évader. Ces entraves ne peuvent être posées qu’avec la permission du médecin.Les plaies et les douleurs autrefois constatées, et qui ont suscité de justes plaintes, provenaient de la brutalité impunie de quelques nourriciers – et d’un système de chaînes aujourd’hui complètement abandonné. Les entraves maintenant adoptées contre les tentatives d’évasion consistent en deux anneaux ou bracelets garnis de peau de mouton et réunis au moyen d’une chaînette légère d’un pied de longueur. L’aliéné a ainsi la marche gênée ; il ne procède que par petits pas, tout en pouvant circuler à son gré ; il continue à jouir du spectacle de la vie extérieure, du soleil, du grand air, des conversations publiques ; il se mêle à tout le mouvement de la ville où de la campagne, plein d’attraits pour sa curiosité. Combien est préférable un tel sort au mortel ennui, au sombre désespoir que suscite dans l’âme l’emprisonnement dans un hôpital ! Qu’importe aux malades que leurs membres soient libres, que les cloisons soient capitonnées et rembourrées, si au-delà se dresse devant eux la dure barrière des verrous et des grilles de fer, des portes inébranlables, des murs infranchissables ? La chaîne est seulement déplacée, reculée de quelques pas ; en vain l’apparence a changé ! La captivité n’en reste pas moins une oppression qui irrite la victime. Après avoir fait une si large part à la liberté, Gheel, on doit le reconnaître malgré d’aveugles ou jalouses critiques, est autorisé à la revendiquer comme le premier principe de tout son système. Le travail en est le second. Bien que chaque aliéné soit libre de s’en abstenir, que nulle discipline matérielle, nul moyen coercitif ne l’y contraignent, quelques paroles sympathiques et l’exemple suffisent fréquemment pour soustraire à l’oisiveté un grand nombre d’insensés. On en compte d’ordinaire la moitié, quelquefois les deux tiers qui s’occupent utilement. À la maison, femmes, jeunes filles, vieillards infirmés, mêlés sans aucune distinction aux enfants et aux servantes, participent à tous les soins du ménage. La plupart des artisans, tels que tailleurs, cordonniers, menuisiers, maréchaux ferrants, boulangers, corroyeurs, etc., trouvent place dans la petite industrie locale. Il en est qui travaillent pour leur compte, et acquièrent une clientèle en rapport avec leurs talents. Il y avait naguère un excellent menuisier, fort intelligent mécanicien, qui gagnait beaucoup d’argent dans l’exercice de son industrie. Cet homme, Hollandais d’origine, ayant servi dans l’armée française, fut fait prisonnier en Russie, puis incorporé dans les cosaques du Don. En 1815, étant en Belgique dans les rangs des alliés, il déserta, ou plutôt il reprit sa liberté et sa nationalité, pour se marier à Bruxelles, où il tomba dans des hallucinations qui rendirent nécessaire sa translation à Gheel. Il y habita vingt-cinq ans, exerçant avec succès son art, raisonnant fort sainement de toutes choses, sauf qu’il affirmait que toutes les nuits le diable entrait dans son corps par les talons et s’y logeait quelque part, ce qui amenait pour conclusion de tous ses discours la demande d’une sonde pour chasser le malin esprit. Les femmes qui s’entendent en un travail de main, comme les fileuses, les couturières, les dentellières, trouvent aussi, à utiliser leurs aptitudes dans le bourg. Les malades originaires de la campagne se livrent à la culture des jardins et des champs : on a soin de placer autant que possible les ouvriers agricoles dans les fermes. Les fous furieux sont les plus recherchés des paysans, et quelque étrange que cela paraisse, l’explication de cette préférence est facile. La fureur témoigne de l’énergie de l’organisme ; la sève intérieure, physique ou morale, est désordonnée, mais abondante. Dans leurs périodes de calme, les fous de cette catégorie sont de vigoureux travailleurs, dont le concours est très profitable au fermier, tandis qu’il ne peut tirer aucun parti d’un idiot, d’un paralytique. Vienne chez les premiers le réveil soudain et violent du mal, le cultivateur et sa famille, aidés des passants et des voisins, y ont bientôt mis ordre. L’accès se calme, le fou se remet à un travail qui est la principale fortune de l’exploitation ; et, grâce à l’enchaînement logique qui s’observe dans le bien comme dans le mal, ce travail, qui profite au fermier, améliore par une énergique et continue diversion l’état du malade, en rendant les accès de plus en plus rares. Bien que les travailleurs aliénés n’aient à réclamer aucun salaire, les nourriciers comprennent qu’une rétribution quelconque est un utile et juste aiguillon : ils allouent à leurs pensionnaires une pièce de 50 centimes ou de 1 franc par semaine, un pot de bière, un peu de tabac, suivant les convenances. Quelquefois l’intervention paternelle du médecin prescrit ce qui est à faire avec une autorité qui est toujours écoutée.
Si les bienfaits du travail ne sont plus méconnus aujourd’hui dans aucun asile, il est très rare que l’on puisse l’y introduire d’une façon quelque peu générale. Pour les hommes manquent les ateliers ; les jardins, les parcs, quelquefois des champs étroits, se prêtent seuls à l’activité musculaire. Aussi ce progrès est-il encore une rare exception. Même dans ces cas, les occupations sont soumises à une régularité d’heures, de mouvements et de discipline, qui leur donne un caractère artificiel et contraint, et en diminue beaucoup les avantages ! Dans la plupart des meilleurs établissements, la vie entière se passe livrée à une accablante oisiveté du corps qui abandonne tout le jour le malade à ses rêves, sans lui procurer cette fatigue musculaire si propice au sommeil de la nuit. C’est à rendre fou l’homme le plus sensé. Quant aux occupations de l’esprit, qui peuvent y être plus aisément introduites au moyen de livres, de jeux, de spectacles, de réunions de société, elles tendent à exalter le cerveau, qu’il faudrait calmer, et à rompre de plus en plus l’équilibre entre l’âme et le corps. Ailleurs, comme dans les hospices russes, qui sont organisés militairement, le travail devient une habitude machinale qui n’opère pas de révulsions énergiques sur les égarements du cerveau ; ce n’est plus qu’un tribut hypocrite payé par l’obéissance passive à l’autorité absolue. Il en est de même des occupations des femmes qui trouvent dans l’aiguille une ressource toujours sûre et rarement répugnante : l’activité facile et pour ainsi dire instinctive ou machinale des doigts laisse l’imagination divaguer à son gré. La dérivation est nulle ou à peu près. Pour elles une application soutenue ne paraîtra même pas sans inconvénient dans les asiles d’aliénés, si l’on considère que le travail s’y exécute avec une régularité monotone, sur des bancs ou des chaises où l’on reste assis pendant des heures entières, d’ordinaire avec immobilité ou calme tout au moins. Pour beaucoup de maladies mentales qui ont leur cause, chez les femmes surtout, dans les obstructions du système sanguin et les troubles corrélatifs du système nerveux, de telles conditions sont loin d’être favorables à la guérison. Seul le labeur des champs réunit tous les avantages : charme naturel, variété d’occupations, mouvements multipliés où la force se combine à l’adresse, fatigue du corps ; autant de contrepoids sérieux aux emportements de l’esprit ! Que l’on ajoute le grand air et la vue de la nature, et l’on admettra volontiers que les campagnes librement ouvertes de Gheel ne doivent pas laisser regretter les salles les plus hautes et les mieux aérées, même les préaux les plus ombragés et les parcs les plus pittoresques des établissements fermés. Toutes les occupations des aliénés n’ont pas un caractère aussi sérieux, et les arts, la musique surtout, leur fournissent des distractions qui concourent à l’amusement de toute la communauté sensée ou insensée, comme jadis à l’apaisement de l’âme du roi Saûl. C’est un pauvre fou, connu sous le surnom de Grand Colbert, habile violoniste qui a fondé l’Harmonie ou société chorale de Gheel, et mérité que, par cette création, son nom vécût avec honneur dans la mémoire de tous les habitants. Ses confrères raisonnables ont eu le bon esprit d’orner de son portrait le salon de leur société, et cet hommage n’est pas un des moins touchants témoignages de la fraternité cordiale, sans préjugés, sans fausse honte, qui caractérise cette honnête population de Gheel. Dans les concerts de l’Harmonie, aux fêtes patriotiques comme aux solennités religieuses, les rôles sont distribués entre les musiciens suivant les talents de chacun, sans égard à l’état de son cerveau : que le jeu et le chant soient justes, c’est tout ce que l’on demande. Pour perfectionner les dons de la nature, une école de chant à l’usage des aliénés entre dans les prévisions du règlement ; il est à désirer qu’elle soit au plus tôt mise eu activité. Le directeur en est désigné par la voix publique : c’est un Allemand, nommé Müller, compositeur distingué, chef de l’Harmonie Gheeloise, qui ambitionne l’honneur déformer parmi les aliénés des élèves qui fourniraient à ses concerts un utile concours, comme ses filles se tiennent pour flattées de leur préférence lors des jours de danse. Nous avons nommé les solennités religieuses : c’est dire que les fous y ont leur place. Si l’on ne les laisse pas entrer volontiers dans l’église paroissiale de Saint-Amand, celle de Sainte-Dymphne leur est ouverte. Dans celle-ci on les voit souvent implorer à genoux les secours et les grâces du Ciel. Seuls, les ambitieux qui se croient dieux, rois ou princes, ne s’agenouillent pas ; à part cette innocente prétention, à laquelle on ne fait pas violence, ils se conduisent, comme les autres insensés, avec décence et respect. Plusieurs d’entre les aliénés chantent au lutrin. Dans les processions, ils se mêlent avec piété aux autres fidèles. Là comme partout, les individus, même sujets à quelques écarts de raison, subissent l’influence du ton qui règne autour d’eux, et donnent l’exemple du recueillement. Ils se montrent généralement très attachés aux croyances de leur enfance. En état de santé et de maladie, aux approches de la mort, ils sont admis aux sacrements toutes les fois que leur état mental n’exclut pas la conscience morale, pieuses consolations que l’art médical, en dehors même de toute sollicitude religieuse, ne peut que sanctionner, parce qu’elles rehaussent le pauvre insensé à ses propres yeux, aux yeux mêmes de la population, en même temps qu’elles fortifient le corps par l’âme. La liberté, le travail, les distractions n’obtiennent ces merveilleux effets que dans le milieu propre à Gheel, la vie de famille ; et c’est là, à vrai dire, le trait profond qui distingue la commune belge de toutes les contrefaçons administratives. »
Jules Duval, Gheel, ou Une colonie d’aliénés vivant en famille et en liberté
(Paris, Hachette, 1867)
« Belgique § 4. Organisation et règlement de la colonie de Gheel »
(Ernest Bertrand)
« La sortie des aliénés est autorisée, en été, depuis six heures du matin jusqu’à huit heures du soir, et en hiver, de huit heures du matin à quatre heures du soir, sauf les exceptions expressément autorisées par le comité permanent. La fréquentation des cabarets leur est interdite ; cependant les aliénés tranquilles peuvent y être admis pour y prendre des rafraîchissements, mais il est strictement défendu de leur servir des liqueurs spiritueuses. Tout individu qui maltraite des aliénés dans la commune, qui les enivre, les excite ou les irrite, est puni. Il est interdit aux aliénés d’aller dans les rues ou dans le voisinage des granges avec des pignons couvertes. Les nourriciers ne doivent pas laisser divaguer dans les rues et sur les places publiques les aliénés dangereux, ceux qui font du bruit ou qui blasphèment, ainsi que ceux qui sont indécents ou d’un exemple dangereux pour la moralité publique. Ils accompagnent à l’église les aliénés et ne peuvent y amener les aliénés furieux, ceux qui troublent le service divin ou ceux à l’égard desquels il faut prendre des mesures de coercition. Le collège des bourgmestres et échevins peut ordonner la réclusion, à l’infirmerie ou chez les nourriciers, des aliénés qui troublent la tranquillité publique, et même leur renvoi de la commune (art. 37 à 41 du règl. de 1832 ; règl. De police du conseil communal).Sous le rapport du service hygiénique et médical, la commune de Gheel et les hameaux qui en dépendent sont divisés en quatre sections, à chacune desquelles est attaché un médecin. Un médecin-inspecteur, nommé par le ministre de la Justice, préside à l’ensemble du service. Il est spécialement charge du contrôle des visites, de la rédaction des rapports médicaux et du service de l’infirmerie, il délivre les certificats de guérison et constate d’office les guérisons si les médecins de section ont omis de les constater. Les médecins de section doivent, chaque jour, à une heure fixée, se rendre au centre de leur section, chez un nourricier désigné à cet effet, afin de recevoir les noms des malades de la section qui ont besoin d’être visités à domicile. Ils visitent au moins une fois par semaine les aliénés de leur section, et aussi souvent que de besoin ceux d’entre eux qui exigent des soins spéciaux ainsi que les malades. Ils doivent se rendre immédiatement auprès des aliénés toutes les fois que les nourriciers réclament leur assistance. Tous les trois mois, ils constatent, sur un livret qui est remis au nourricier à l’entrée de chaque aliéné, l’état physique et moral de cet aliéné ; la constatation est précédée d’un examen, dont le résultat doit être transmis au médecin-inspecteur dans un rapport général comprenant tous les aliénés de la section. Ce rapport est communiqué au comité permanent et transmis par le comité à la commission supérieure, avec les observations du médecin-inspecteur, s’il y a lieu. Indépendamment des médecins de sections, les administrations et les personnes qui ont effectué le placement peuvent faire donner des soins à leurs aliénés par tels médecins qu’il leur plaît de désigner ; mais ces médecins sont soumis aux mêmes règles de surveillance et à la même responsabilité que les médecins de section. Le médecin-inspecteur visite au moins quatre fois par an toutes les sections. Ces visites sont inscrites, avec leurs dates, sur le livre des visiteurs déposé au siège du comité permanent. Il doit de plus tenir le registre imposé aux médecins-chefs des établissements ordinaires, pour y constater l’historique, les phases et le traitement de la maladie mentale de chaque aliéné, et en transmettre chaque année le résumé à l’administration supérieure par l’intermédiaire de la commission supérieure d’inspection. »
Ernest Bertrand, « Belgique § 4. Organisation et règlement de la colonie de Gheel », Lois sur les aliénés en Angleterre, en France, et dans les autres pays : résumé des critiques que soulève en France la législation sur les aliénés (Paris, 1870)
Philippe Artières
Pour aller plus loin :
• Jacques-Joseph Moreau de Tours, Lettres médicales sur la colonie d’aliénés de Gheel (Paris, 1845)
• Gheel, la ville libre des « fous », Retronews