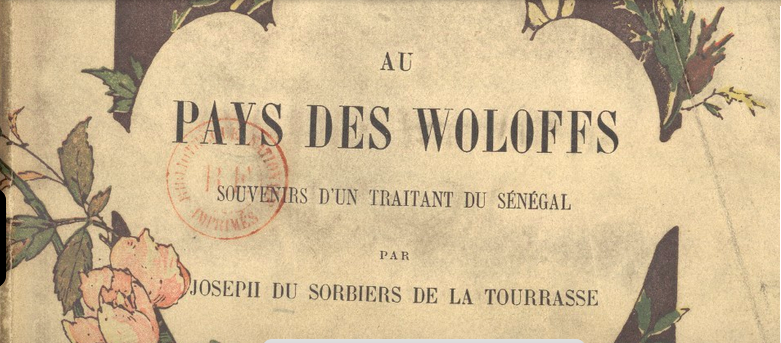
Les malades appartiennent au large peuple des silencieux de l’histoire. Il est rare qu’on entende leurs voix. À l’exception de quelques récits d’écrivain·e célèbre – pensons à La Doulou d’Alphonse Daudet – ou de quelques mentions dans des journaux personnels miraculeusement conservés, il existe peu de témoignages « du fond du lit » de la maladie ou des soins qu’elle génère.
Les récits de voyage sont une source formidable pour l’histoire mondiale du XIXe siècle. Si on se plonge dans cette littérature de « souvenirs », il arrive qu’on tombe sur quelques pages qui, soudain, éclairent des situations des plus ordinaires. C’est souvent le cas dans les écrits d’Européens au moment des conquêtes coloniales et de l’édification des empires belge, britannique et, bien sûr, français. Le voyageur note ce qu’il n’écrirait pas sur son lieu de vie habituel.
Ainsi en est-il d’un jeune commerçant, Joseph de la Tourrasse (1866-1931), qui part s’installer au Sénégal en 1886 pour y servir une société de commerce en gomme et arachide. Curieux, il observe et prend des notes sur sa vie, celles des colons, mais aussi sur les mœurs et cultures des populations locales. En 1897, il reprendra ses remarques dans un ouvrage, Au pays des Woloffs. Si ses souvenirs sont intéressants, c’est que son séjour de quatre ans correspond au développement du chemin de fer, et à un engagement militaire français important. La Tourasse conteste en effet l’idée d’une colonisation de population ; faire venir vivre des familles françaises au Sénégal lui semble inopportun, notamment en raison du climat et des maladies. Son propos rejoint sa propre expérience : lui-même victime de fièvres, atteint de paludisme, il doit être hospitalisé quelques semaines à l’hôpital militaire de Dakar.
Philippe Artières
À l’hôpital de Dakar
(Écrit sur mon lit d’hôpital)
« Me voici à l’hôpital depuis huit jours. À vrai dire, je ne sais pas très bien ce qui s’est passé pendant ce temps-là. Je me rappelle seulement qu’à mon entrée dans la salle, le major a dit en se tournant vers le prévôt : « Encore un qui est envoyé trop tard ! »
Ces paroles m’ont frappé confusément, bien que je parusse insensible, et je crois que je me suis dit en moi-même : « Non, il se trompe ; il n’est pas vrai que je sois si bas ! » Et, en effet, la grande crise est passée ; je n’ai presque plus de fièvre, mais je suis si faible que je puis à peine me soulever seul sur l’oreiller.
Nous sommes une quarantaine dans la salle, presque tous militaires ou marins. Le service est fait par des infirmiers noirs, sous la surveillance des sœurs et d’un infirmier en chef européen.
Le matin à huit heures, et le soir à cinq heures, le médecin-major fait sa visite, escorté du prévôt et de la sœur. Elle ne dure pas en tout plus d’une demi-heure. Devant chaque lit, à côté du numéro d’ordre, est la pancarte où sont consignés les noms, les attributs, le genre de maladie, les remèdes précédents de chacun de nous. Un quart d’heure avant la visite, on prend notre température, et il nous faut rester immobiles, le thermomètre sous le bras. Le docteur arrive alors comme un tourbillon, dévisage les malades, ordonne toujours la même chose, et s’en va ainsi de lit en lit jusqu’au dernier.
Depuis six heures du soir jusqu’au lendemain sept heures, tout est hermétiquement fermé, portes et fenêtres. On suffoque dans cette grande salle, d’où s’exhalent des miasmes enfiévrés. De temps à autre, au milieu du silence, s’élève la voix plaintive de quelque moribond en délire ; d’autres fois, c’est le hoquet solennel d’une agonie. On aperçoit l’ombre d’une sœur ou d’un infirmier qui glisse le long des rideaux ; j’entends quelques mots à voix basse, puis c’est tout.
Des civières circulent apportant des malades ou remportant des morts, on ne sait. Personne d’ailleurs ne fait plus attention qu’à soi, tout le reste devient indifférent. À travers un cauchemar, on frissonne pourtant à la pensée de la table de marbre glacé de l’amphithéâtre ; puis on se rassure. Qu’importe, puisqu’on ne sentira plus ?
Pendant la journée, on a du moins quelques distractions. On tire les rideaux qui encadrent votre lit, et l’on voit des convalescents blêmes et courbés errer comme des fantômes. À dix heures, ils s’assoient à la table du milieu, racontent quelques joyeuses histoires de campagne ou de colonne, et l’on se prend à envier leur sort. À deux heures, la salle est close de nouveau jusqu’à quatre heures : il faut rester dans son lit les rideaux fermés.
On me donne pour la journée un litre d’une affreuse tisane, que je vide régulièrement dans mon pot. Le soir, quand les accès de fièvre reviennent, je demande une cuvette sous le prétexte de me laver les mains ; j’y trempe mes mains brûlantes, et j’humecte avec mon mouchoir mes lèvres desséchées.
Ce matin, un père missionnaire de la congrégation du Saint-Esprit est venu visiter notre salle. Il a fait, comme le docteur, le tour des lits, adressant à chacun un sourire, une parole de religion et de paix aux plus malades, recevant souvent bon accueil, mais quelquefois aussi injurié.
Il s’est approché de moi : « Croyez-vous en Dieu, mon enfant ? », m’a-t-il dit. Et comme je protestais de ma foi, il m’a serré la main et m’a donné une petite médaille de la Vierge. Je l’ai gardée précieusement ; elle me rappelle celle que ma mère mettait à mon cou quand j’étais tout petit. Si je sens arriver ma dernière heure, je la mettrai sur ma bouche avant d’expirer ; car, hélas ! pour ne pas effrayer les autres malades, il est interdit au prêtre de venir assister les mourants. Quelle tristesse de s’en aller ainsi au milieu de l’indifférence générale, sans qu’un visage ami se penche sur vous une dernière fois, dans un lieu enfin où la mort elle-même a perdu sa majesté ! Ah ! je revois encore cette scène d’hier soir, et ce pauvre petit sergent d’infanterie mort tout près de moi. Il avait accompli en colonne des prodiges de bravoure ; mais il en était revenu si malade qu’il fallut le transporter à l’hôpital. Il était trois heures de l’après-midi.
Soutenu par deux Noirs, il s’avança tremblant au milieu de la salle, le visage décomposé. Il attendit longtemps que l’infirmier stupide eût contrôlé les papiers et matricules du régiment, puis on le fit coucher dans un lit à côté du mien. À peine étendu, il se mit à murmurer des mots entrecoupés de plaintes et de sanglots. On courut chercher le prévôt absent. La sœur tâchait de calmer le sergent en lui présentant un bol de tisane. « Voyons, numéro 3, lui disait-elle de sa voix douce, buvez un peu, cela vous remettra », et elle essayait de faire passer le liquide tiède entre ses dents qui se serraient.
Au milieu de la salle, l’heure du repas avait groupé les convalescents, qui semblaient complètement étrangers à cette scène. La sœur et moi, nous étions seuls à entendre son gémissement plaintif, accentué d’abord, et qui s’affaiblissait de plus en plus. Tout à coup, le moribond se dressa sur sa couche, me regarda avec des yeux hagards ; puis son visage contracté sembla s’animer d’une douceur infinie, un vague et triste sourire voltigea un moment sur ses lèvres décolorées. « Maman, murmura-t-il, mam… » Il n’acheva pas le mot chéri, et retomba raide mort sur son oreiller.
Le docteur arriva enfin, s’approcha du sergent, lui tâta le pouls, prit sa température par acquit de conscience, et fit signe à l’infirmier de faire avancer une civière. Quatre Noirs enlevèrent le cadavre encore chaud, un autre changea les draps du mort, et dix minutes après, le lit, devenu vide, recevait un nouveau moribond. »
Joseph du Sorbiers de La Tourrasse, Au pays des Woloffs (1897), pp. 172-175