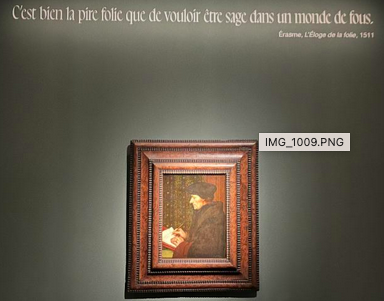
Il est difficile de se réjouir et de se dire qu’il s’est passé quelque chose d’historique pendant ces six premiers mois de 2025 où la santé mentale a été déclarée grande cause nationale. Il n’empêche, on en a parlé. Du côté de l’édition, des livres forts ont ainsi été publiés, rencontrant un écho important. Que ce soit celui de Nicolas Demorand (Intérieur nuit), ou celui d’Adéle Yon (Mon vrai nom est Élisabeth) ou encore celui de Philippa Motte (Et c’est moi qu’on enferme).
Ces succès ne sont pas banals, mais la question qui se pose est celle-ci : est-ce significatif et si cela l’est, de quoi ? Commençons par celui de Nicolas Demorand. Comme nous l’avons déjà écrit, la première phrase de son livre, venant d’un personnage aussi connu et public que cet homme de médias – « Je suis un malade mental » – est tout sauf anodine. Cette affirmation revendiquée a marqué les esprits, crevé un plafond de verre, donné une visibilité à ceux ou celles qui, d’ordinaire, se cachent. Elle a montré que l’on pouvait être malade mais vivant, travaillant comme tout un chacun. C’est une vraie avancée contre la stigmatisation qui est un des combats majeurs de la plupart des associations de malades ou de proches des malades. Être « fou » et diriger la plus importante émission de radio de France, ce n’est pas rien… Même si l’on ne sait pas trop ce que cela veut dire, ni les effets que cette annonce peut entraîner. Pour autant le livre de Nicolas Demorand avait ses limites, faisant ainsi totalement l’impasse sur la crise de la psychiatrie dans la société, et décrivant la maladie mentale comme purement organique, une pathologie comme n’importe quelle autre, tombant du ciel comme un orage imprévu, et nécessitant au final une prise en charge somme toute classique, médicamenteuse et biologique.
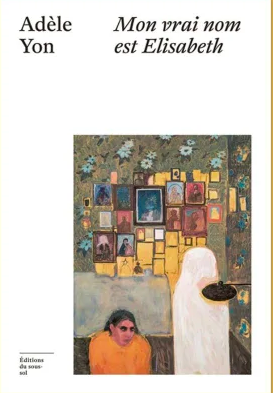
D’où l’intérêt majeur (et la belle surprise) du succès encore plus énorme du livre d’Adéle Yon, qui, d’une certaine façon, est le contrepied parfait du livre de Nicolas Demorand. Voilà en effet l’arrière-cour de la folie. C’est l’histoire d’une arrière-grand-mère – celle de l’auteure donc – qui a été cataloguée schizophrène, et son arrière-petite-fille, jeune universitaire, inquiète à l’idée que cela se répète, va délier les innombrables chapitres autour de son aïeule en s’appuyant sur une documentation et des entretiens absolument passionnants. C’est en effet à partir d’un minutieux travail d’archives (lettres, dossiers médicaux, témoignages, photos) qu’Adèle Yon reconstitue peu à peu le destin de cette femme effacée, dont le prénom avait disparu des conversations familiales, si ce n’est comme une ombre silencieuse, transmise de génération en génération. Son arrière-petite-fille découvre la vie d’une femme libre, combative, cassée par un mari autoritaire et six maternités imposées. Adéle Yon montre les effets que la folie éventuelle de l’un a des liens avec les autres vivants, catalogués, eux, comme bien normaux. Des liens complexes et variables. Comment réagir ? Adèle Yon raconte. Il y a souvent un silence comme réponse. « Un silence », explique-t-elle dans un entretien, « c’est à la fois le signe des traces que cette histoire a laissées, et un mécanisme pour s’en protéger. De la part de la sœur de ma grand-mère, ce n’est pas du déni, c’est presque plus profond. Refuser de savoir, c’est sa manière de rester debout. Je pense qu’elle ne considère pas que je cherche la vérité. Elle ne donne pas le même sens que moi à ce mot. Pour elle, ce n’est pas une quête de vérité, c’est une mise en péril. Parce que chacun se construit sur des récits nécessaires à l’équilibre. Alors quand elle me dit qu’elle ne veut rien savoir, je pense qu’elle exprime, consciemment ou non : “Ce que tu pourrais m’apprendre déséquilibrerait trop la manière dont je me suis construite.” Et ce serait invivable pour elle. »
De fait, son livre pointe tout ce que laisse de côté Nicolas Demorand, à savoir que la maladie mentale n’est pas seulement le résultat d’un désordre neurologique, mais que la folie s’inscrit dans une histoire, qu’elle a des effets familiaux en chaîne. Et l’on ne peut qu’être rassuré par le succès de son livre, montrant que le diagnostic de maladie mentale n’est pas aussi simple qu’un banal diabète.
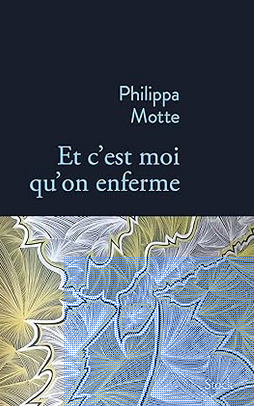
Philippa Motte, auteure du troisième livre, Et c’est moi qu’on enferme, a un peu le même profil qu’Adèle Yon. C’est une jeune femme d’aujourd’hui, toute brillante, consultante en entreprise. Et elle, c’est de sa maladie qu’elle va nous parler, là encore un trouble bipolaire comme Nicolas Demorand. Elle raconte ce monde ailleurs, ses folies, ses dérapages, ses enfermements, ses emballements, mais aussi la prise en en charge qu’elle a vécue, ou plutôt qu’elle a subie. Elle décrit ses moments d’excitations outrancières et ses phases d’effondrements. Au-delà de l’aspect logiquement égocentrique de son récit, il y a ce constat que l’on retrouve dans beaucoup de témoignages. C’est que le monde de la psychiatrie est perçu comme un ennemi pour le malade ; le malade doit se défendre, se cacher, en tout cas le malade a compris qu’il doit être « compliant » pour plaire à son thérapeute car c’est lui qui a les clés pour le laisser sortir. On est loin de la solidarité thérapeutique. Et ce constat est impressionnant, car on l’entend souvent, en particulier chez tous ceux ou celles qui ont, par exemple, subi des phases d’isolement ou de contention. Ces derniers disent tous qu’ils ne se sont jamais remis de ces premiers moments, de cette violence initiale, et le regard sévère qu’ils portent aux psychiatres vient souvent de cette violence subie, et surtout non expliqué. Philippa Motte le confirme, racontant ainsi l’absence de réponses et d’explications aux demandes qu’elle a faites. On ne lui dit rien sur les effets des médicaments, rien sur les raisons de son isolement, rien sur ce qui se passe. Philippa Motte est enfermée, et elle a vite compris qu’elle se devait d’obéir pour retrouver sa liberté.
Trois livres donc qui ne font évidemment pas le printemps. Comme nous le disions, on ne peut éviter de mettre ces récits en rapport avec la situation sur le terrain. Le monde de la psychiatrie va toujours aussi mal. Un exemple ? À Laval, en Mayenne, en ce mois de septembre, la psychiatrie adulte « s’effondre inexorablement », selon le syndicat Force ouvrière. Ainsi, le service de psychiatrie adulte de Laval qui comptait huit médecins n’en a plus que trois aujourd’hui, et deux vont partir à la retraite en novembre. L’hôpital de Laval n’aura donc plus qu’un seul psychiatre à partir de novembre.
C’est finalement un étonnant paradoxe de ces mois écoulés : des paroles et des écrits se sont exprimés autour de la folie, quelque chose s’est libéré, avec force, essentiellement d’ailleurs en provenance de patients ou de proches. Mais en écho, on ne peut que noter une pauvreté du discours des autorités ainsi qu’une certaine absence de réaction des psychiatres. Les premières font des annonces qui ne sont suivies d’aucun effet. Et les seconds semblent se taire ou se réfugient dans une pratique solitaire. Le monde de la santé mentale reste ainsi cloisonné, éparpillé, sans volonté commune, et les frontières entre les différents acteurs semblent même se creuser. Dès lors, que faire ? Au moins, maintenir ce souhait lancé à tout-va : « Fous, ne lâchez pas les mots, peut-être qu’à force ils vont être entendus »…
Éric Favereau