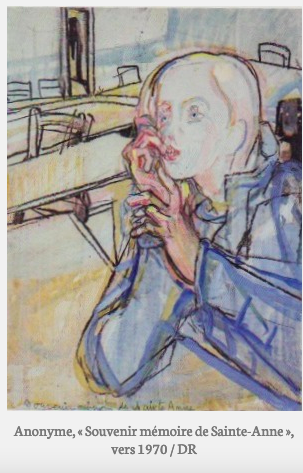
Lors d’un séjour dans un village de montagne, j’ai été appelé au secours par une amie, pour un couple de personnes âgées, traumatisé par un incident assez dramatique qui s’est déroulé fin décembre avec leur petit-fils, Philippe, un jeune homme de 23 ans.
Originaires du village, anciens enseignants tous les deux, ils sont venus s’installer définitivement dans leur maison de famille à leur retraite. Ils me font le récit de ce qui est arrivé. Hélène en est encore très affectée et Jean-Pierre va me décrire ce qui s’est passé deux mois auparavant. Ils sont inquiets et soucieux d’essayer de comprendre. Mais surtout, ils appréhendent le retour de Philippe pour les vacances.
Philippe est un grand jeune homme qui fréquente un Esat – un centre d’aide par le travail pour handicapés – après avoir été en institut médicoéducatif (IME) pendant son enfance et son adolescence. Après une souffrance néonatale, il a été victime d’un retard de développement, d’un retard intellectuel et de difficultés d’élocution. Cependant, malgré ces handicaps, il se lie facilement avec les autres, il n’est pas dans un repli et dans un évitement des contacts relationnels. Il est bien connu dans le village, venant à toutes les vacances depuis son plus jeune âge, allant voir les uns et les autres.
Les parents sont divorcés. Il vit chez son père dans une petite ville du centre de la France, voyant sa mère chaque week-end dans la grande ville à proximité. Grande ville où il y a un CHU et un service de psychiatrie.
Les grands-parents font le récit des derniers mois : la mère, soucieuse de voir son fils sous traitement neuroleptique depuis plusieurs années, s’inquiète d’un « traitement à vie », et insiste pour que Philippe arrête ce traitement. Il n’y a aucun suivi régulier par un psychiatre, un médecin généraliste assurant le renouvellement d’ordonnance… Après quelques hésitations, le père se range à l’avis de son ex-femme. À l’Esat, seul un psychologue voit Philippe de temps en temps, et cette décision de l’interruption du traitement ne donne lieu à aucun discussion médicale.
Au fil des semaines et des mois, l’état de Philippe se détériore. Il se replie sur lui-même, parle de moins en moins, se renferme. Au bout de quelques mois, le père s’inquiète. Il a l’impression que Philippe a des hallucinations, parle de plus en plus tout seul, a des éclats de rire bizarres. Philippe dit que ces collègues de l’Esat disent du mal de lui. Manifestement, il se sent persécuté. Lui qui téléphonait quasi quotidiennement à sa grand-mère, avec qui il a toujours eu un lien assez fort, espace ses appels, ne dit plus grand-chose. Lorsqu’il vient chez ses grands-parents en décembre, ceux-ci le trouvent très changé. Très replié, il n’a pas envie d’aller voir ses connaissances du village. Lui qui bricolait volontiers avec son grand-père reste dans sa chambre.
Un après-midi, il redescend de sa chambre, sombre, assez renfermé. Lorsque son grand-père lui propose une petite activité, il « explose », le bouscule, le fait tomber et là, c’est un déferlement de violence physique ! Coups de pied, coups de poings. La grand-mère affolée tente de le calmer, téléphone au père qui lui conseille d’appeler le 15. Lorsque les pompiers arrivent, Philippe est calmé, remonté dans sa chambre. Il accepte de les suivre sans difficulté et d’aller avec son grand-père aux urgences de l’hôpital le plus proche. Le grand-père reçoit les soins nécessaires, pas de fracture à la radio. Philippe va être vu par une psychiatre de garde qui rétablit le traitement neuroleptique. Ils vont passer tous les deux la nuit à l’hôpital et rentrent le lendemain au village.
Les grands-parents devront insister pour qu’un compte-rendu circonstancié soit établi… qu’ils vont transmettre au père qui a pris un rendez-vous avec un psychiatre du service de psychiatrie.
De ce récit bouleversant, je suis assez révolté du vide thérapeutique ! L’absence d’accompagnement et de suivi soignant, tant de ce jeune homme au long parcours psychiatrique, que des parents qui sont laissés, démunis, abandonnés aux aléas de la vie, aux difficultés existentielles de leur fils, aux interrogations qu’ils peuvent de poser quant au suivi, au traitement prescrit, à l’absence d’un accompagnement psychologique, voire psychothérapique de ce jeune adulte. L’étiquette « handicapé » se suffirait-elle à elle-seule ? Une activité professionnelle protégée, spécialisée serait-elle suffisante ? N’y a-t-il pas là une illustration de la décadence de ce que l’on peut nommer une psychiatrie de proximité, un abandon de ce qui a été nommé « politique de secteur psychiatrique » dans sa conception de soins diversifiés, de prévention et d’accompagnement au long cours, un service public de qualité ?
Paul Machto