C’est un petit livre d’une petite maison d’édition, La Guillotine, qui tient à préciser qu’elle est contre la peine de mort. C’est un témoignage, celui d’un étudiant en journalisme qui, en pleine année universitaire, craque, se dissocie, a une bouffée délirante, etc.
Nous sommes en mai 2008, et pendant dix ans, Adrien va être hospitalisé, traité, pris en charge, médicamenté. Pendant des années, il va chercher quelque chose à laquelle se raccrocher. Il va de lieux en lieux, de chambres d’isolement en médicaments qui assomment. Adrien tente de parler, mais on ne l’écoute pas. Ou alors d’une façon étrange.
Son témoignage, bref et simple, le confirme. Pourquoi ne pas entendre le malade ? Lui aussi veut… guérir. Exemple, avec ce passage sur les traitements.
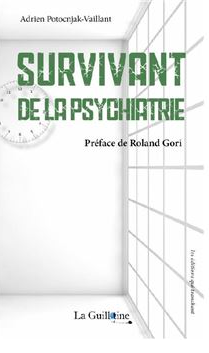
Le traitement
« L’ensemble de mon parcours a été marqué par des traitements aux effets secondaires insupportables. Insupportables, car incompatibles avec une vie normale. C’est peut-être difficile à imaginer, mais c’est réellement comme cela que ça s’est passé. Dès le premier épisode, on m’a prescrit un neuroleptique. C’est tout ce que l’on m’a proposé. Je l’ai pris, mais il avait un effet secondaire qui le rendait invivable. J’ai donc arrêté de le prendre régulièrement, et je le prenais de temps en temps parce que je me rendais compte qu’il me permettait de passer une bonne nuit.
Ensuite, il y a eu la période Abilify. Le Dr S., qui m’a suivi à mon arrivée à Chambéry, ne jurais que par lui. Je lui faisais des retours très clairs sur le fait qu’il m’empêchait d’avoir une vie normale. Hypersomnie, fatigue, sensibilité émoussée… Pourtant, elle ne m’a jamais fait de proposition alternative. En 2015, on me prescrit un nouveau neuroleptique. Je le prendrai pendant plusieurs mois, malgré des effets secondaires très lourds. Pendant cette période, je ne pouvais littéralement rien faire. Je ne pouvais plus aller acheter du pain à la boulangerie située à deux pas de chez moi. Je devais prendre la voiture. Je ne pouvais plus marcher, ni faire le ménage, à peine faire mes courses. Et ces nuits interminables… Le désespoir de voir affiché 16h00 sur le téléphone quand on ouvre les yeux. Mes rêves tournaient en boucle. Mon esprit n’avait pas suffisamment d’inspiration pour meubler quinze heures de sommeil. Puis, il y a ces traitements qui empêchent de se concentrer. On ne peut alors plus lire, plus écrire, plus travailler… Je les ai tous arrêtés, les uns après les autres, lorsque j’arrivais au bout de ce que je pouvais supporter. Les problèmes qu’engendrent les traitements sont terribles. Ils peuvent aussi déclencher une boulimie : impossible dans ce cas-là de ressentir ses besoins. Cela m’est arrivé. J’ai mis du temps à retrouver des sensations normales, à manger normalement, à ressentir la satiété. J’ai fait de gros efforts. Sachant que le médicament qu’on me prescrit à l’heure actuelle fait manger plus que de raison, j’ai anticipé. Et pourtant j’ai pris deux kilos au début de la prise du traitement. Puis j’ai décidé de ne plus acheter de pain, de fromage, de gâteaux et de chocolat. Il y a un enjeu important autour du poids, un enjeu de normalité. Ce n’est pas agréable de manger trop, et de peser plus que ce que l’on devrait pour une raison qui nous échappe. Après ce traitement qui m’empêchait même de marcher, faire du vélo a été une sensation très agréable.
Ah, cette première fois sur un vélo depuis deux ans ! C’était incroyable. Je devais juste faire un tour dans le quartier… J’ai pédalé quinze kilomètres. Malheureusement, en plus des effets secondaires, l’apnée du sommeil est apparue chez moi en janvier 2016. Au bout du compte, elle a eu les mêmes conséquences : je dormais quinze heures par jour et j’étais épuisé. Déjà, quand je prenais certains traitements, le Dr G. disait que la dépression venait de moi. Là, je n’avais pas de traitement pour me justifier. “Vous voyez, vous dormez toujours beaucoup alors que vous ne prenez rien ! C’est que cela vient de vous”, m’a-t-elle dit. Ce sont ces erreurs qui ont mené à un nouveau diagnostic erroné de bipolarité. Car il y a ce risque que l’on dise que les effets secondaires viennent du patient. Quand bien même celui-ci le nie.
On ne m’a jamais écouté quand je disais que je n’étais pas dépressif. Le pire, c’est que ces dépressions, ce sont les psychiatres qui les ont provoquées avec les traitements. On voulait ainsi me soigner sur la base d’effets secondaires induits par des traitements. On répondait “regardez, vous êtes dépressif !”, quand il s’agissait d’effets secondaires. Et on voulait me donner des médicaments contre la dépression. C’est kafkaïen.
En mai, mon apnée du sommeil s’estompe avec l’arrivée du printemps. Je vais voir le Dr G. pour lui demander de me donner quelque chose, car j’ai peur de rechuter. Les essais restent infructueux. En décembre 2017, lors d’une hospitalisation, un médecin a suggéré qu’une infirmière ou un infirmier vienne chez moi m’administrer le traitement, tous les jours, à heure fixe. Déjà, prendre un traitement sans l’aide de quiconque, tous les jours à peu près à la même heure, ce n’est pas toujours évident. On est avec des amis, on est à une terrasse, on passe un bon moment ; ce n’est pas naturel.
En plus, le traitement peut sédater : si on le prend, on sait que le sommeil va venir. Là, en plus, il aurait fallu que je sois chez moi chaque jour en début de soirée. Bien sûr, j’ai refusé. Cette idée de faire venir un soignant tous les jours chez moi en dit long sur la mentalité de certains psychiatres. Pour eux, la vie normale est secondaire. Il s’agit exclusivement de prendre un traitement. À tout prix. Cette proposition refusée et mes arrêts successifs de prise de traitements sont à l’origine d’un malentendu : certains médecins ont commencé à imaginer que je ne n’étais pas sérieux avec les traitements. Pourtant, cette idée est fausse. Chaque fois que l’on m’a prescrit quelque chose, je l’ai pris. Je l’ai pris jusqu’à la limite, jusqu’au moment où il rendait ma vie insupportable. Je l’ai pris parce que c’était tout ce que l’on m’offrait comme perspective de mieux-être. Il y a eu trois phases avec les traitements dans mon parcours de soin. Lors de la première, j’ai essayé plusieurs traitements pour ensuite les arrêter à cause des effets secondaires, et je pouvais m’en passer pendant des moments assez longs.
Lors de la deuxième, on me prescrivait systématiquement de l’Abilify, qui m’assommait et me déprimait au bout de quelques semaines, et puisque je ne le supportais, plus je l’arrêtais et je connaissais de nouvelles dissociations. Puis il y a eu la période où on me donnait de l’Olanzapine, et je l’arrêtais également au bout d’un moment, car j’avais compris qu’il provoquait une hypersexualité.
De nouvelles dissociations ont également suivi ces arrêts. Dans un premier temps, j’ai été démuni face à l’hypersexualité. Je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait, et je ne me voyais pas aller parler de ces manifestations en disant que cela venait du traitement : j’avais peur de ne pas être cru – crainte confirmée quand on voit les réactions des médecins à qui j’en ai parlé. Quand j’ai découvert ce terme, le Dr G. m’en a prescrit un autre qui a marché dans un premier temps ; puis, au bout d’un an, il a provoqué les mêmes symptômes. J’ai alors essayé tous les neuroleptiques, sauf le Xeroquel qui était selon elle trop sédatif ; tous ont provoqué une hypersexualité.
Le pire, c’est qu’aucune des trois médecins que j’ai vues ne m’a cru quand j’ai dit que l’hypersexualité venait des traitements. Je note que l’infirmière, la psychologue et le sexologue m’ont tous cru. Qu’est-ce qui ne va pas alors avec les psychiatres ? Ils nous donnent des traitements, et on n’aurait pas le droit de dire que les traitements nous posent des problèmes ? Pourquoi la parole du patient est-elle si difficile à entendre ? “Avec vous, tous les traitements posent problème, M. Potocnjak”, m’a dit une autre psychiatre, comme si je faisais preuve de mauvaise volonté. Ça fait des années que j’essaye avec la meilleure volonté possible, des années que je ne demande qu’à vivre une vie normale ; c’est ma seule exigence. Alors, c’est peut-être qu’il y a un problème avec les traitements ? Il existe deux générations de neuroleptiques. La deuxième génération est censée provoquer moins d’effets secondaires que la première ; pourtant, ils ont tous occasionné chez moi des effets lourds et invivables.
Aujourd’hui encore, je prends l’un de ces traitements ; l’effet secondaire qu’il entraîne est extrêmement pesant. Pourtant, nulle part n’est annoncée une troisième génération de neuroleptiques. Pourquoi n’y a-t-il pas de recherches, des recherches sérieuses sur une troisième génération de neuroleptiques ? Je ne dois pas être le seul à souffrir de ces effets secondaires ! Comment peut-on prescrire de tels médicaments et ne pas prendre en compte les vies de ceux qui en sont affectées ? On semble juger que ce n’est pas nécessaire, pourtant ces pathologies concernent beaucoup de monde. C’est comme la recherche sur ces pathologies, où en est-elle ? Juge-t-on la situation actuelle satisfaisante ? Le comportement des spécialistes montre clairement que ces pathologies ne sont pas connues ; il faut démonter une fois pour toutes le mythe de la folie et de l’irresponsabilité des malades.

Le Dr G., la psychiatre qui m’a suivi de 2015 à 2020, ne proposait aucune solution. Enfin si, une, mais elle était aberrante : combiner deux neuroleptiques, espérant que les effets de l’un contrebalanceraient ceux de l’autre. L’un des neuroleptiques avait provoqué une hypersexualité, l’autre une dépression et des insomnies ; je n’ai pas voulu savoir ce que provoquerait leur prise combinée. J’ai réfléchi à une solution ; les neuroleptiques provoquent chez moi cet effet secondaire, l’hypersexualité, mais je dois en prendre un sinon je vais rechuter ; il faudrait donc un autre traitement qui aille à l’encontre de l’hypersexualité. J’ai découvert qu’il en existait, des antidépresseurs pour la plupart. J’ai passé plusieurs mois à essayer tous les antidépresseurs qui pouvaient neutraliser l’hypersexualité. Malheureusement, cette solution n’a pas marché ; les antidépresseurs ont eux-mêmes des effets secondaires très lourds, et combinés avec le neuroleptique, je n’ai pas pu les supporter. Mais il fallait essayer.
J’ai dû le faire seul. Le Dr G., et c’est révélateur, se contentait de me prescrire le neuroleptique, malgré ses effets secondaires. Elle a fini par dépasser les limites, et du haut de son autorité médicale, par affirmer des choses qui n’étaient pas supportables. Dans l’absolu, je n’ai rien contre le fait de prendre un traitement. Si le prendre évite des hospitalisations, je ne demande que ça. Il faut juste que ces traitements permettent de vivre une vie normale. Pourquoi ne m’a-t-on pas écouté quand j’évoquais les effets secondaires ? C’était tout juste si on ne me disait pas qu’il fallait que je fasse avec, alors que le cœur même de ce que je disais était qu’il était impossible de vivre avec eux. Les psychiatres rendent le traitement sacro-saint, et il leur fait négliger la parole de leurs patients, alors que cette parole devrait être au cœur du parcours de soin. La vision commune de la “folie” y est pour quelque chose ; on estime que ces traitements sont bien suffisants pour soigner quelque chose que l’on ne comprend pas, malgré leurs effets secondaires terribles. Pourtant, il faudrait que naisse une prise de conscience de ce que provoquent et font vivre ces traitements… »
Éric Favereau
Survivant de la psychiatrie, Adrien Potocnjak-Vaillant, éditions La Guillotine (La Guillotine, les éditions qui tranchent <editionlaguillotine@gmail.com>)