Les noms des hôpitaux psychiatriques (HP) font partie du langage commun ; de Sainte-Anne à Paris à Montfavet en Avignon ou Colson en Martinique, ils sont chargés de représentations. On y entre rarement, on les contourne. Tout le monde connaît ainsi le nom de Maison-Blanche, cet hôpital psychiatrique construit à la fin du XIXe siècle en banlieue parisienne, à Neuilly-sur-Marne, pour y interner des femmes. Rares sont pourtant celles et ceux qui franchissent le portail de ce site aujourd’hui déserté, pour partie habité par des familles tsiganes. Deux chercheurs sont allés fouiller dans ce monde englouti, dont ils ont rapporté de nombreuses lettres de ces folles oubliées. Car – et c’est l’autre apport majeur de ce livre – les psychiatrisés n’ont pas seulement été exclus du monde, ils le sont encore très largement de l’histoire, les archives des dossiers individuels pourrissant derrière nombre de ces murs, comme si les folles et les fous n’avaient pas droit de mémoire.

En 1993, Paule Muxel et Bertrand Solliers, dans leur film Histoires autour de la folie, avaient tenté pour Ville-Évrard ce travail quasi archéologique. Dans Le Grand renoncement, la démarche est différente, elle consiste à exhumer un ensemble de lettres pour faire entendre ces femmes qui vécurent dans ce lieu d’oubli. Au côté de photographies prises lors de leur exploration, Franck Enjolras et Jean Noviel livrent le récit de « leur expérience », suivant le cheminement de ce que fut pour les individus qui entraient à l’HP cette mise hors du monde progressive qui leur fait oublier Paris dont ils viennent majoritairement, ses bruits et ses odeurs, le nom de ses rues… Pour rendre compte de ce processus, ce sont les documents qui sont d’abord mis en avant, ceux rédigés par les principaux intéressés ; pas de témoignages, mais des mots destinés à d’autres et que les chercheurs transcrivent. C’est cette urgence qui domine : sortir ces traces de l’oubli. Comme les requêtes d’un mari pour sa femme internée sur des objets des plus ordinaires : « Ne pourriez-vous pas, Monsieur le Docteur, lui faire obtenir de la viande hachée ? C’est la seule chose qu’elle mange avec plaisir. Et qui dans son état me paraît un bon reconstituant. »
Des lieux miroirs de leur époque
Apparaissent également dans cette manne d’archives des écrits de la sociabilité qui se construit au sein même des services entre les psychatrisés. Quand on sort, on n’oublie pas celle ou celui qui est resté au-dedans. Comme Antoinette et Amélie, qui communiquent d’un monde à l’autre en 1912. Elles savent qu’elles vont se revoir, que la sortie n’est jamais définitive : « Tu vas être bien surprise en recevant ma lettre depuis les premiers jours de septembre que j’ai reçu ta dernière lettre : c’est que je suis malade. » Amélie s’en inquiète, car pour elle : « Je vous le promets, j’aimerais mieux la mort que d’être à Maison-Blanche, j’aimerais mieux six mois de prison. » Mais Antoinette de lui répondre : « Tu dis que tu voudrais bien t’en aller de Maison-Blanche. Moi, c’est le contraire. Je voudrais bien encore y être. Je te jure bien que je ne demanderais pas la sortie et que je me trouverais bien tranquille d’être folle. » Les archives de l’asile conservent des centaines de ces histoires, de ces relations qui se nouent au sein des cours de promenade, dans les couloirs et les dortoirs.
Et les chercheurs d’exhumer aussi cette lettre non envoyée en 1913 au président Raymond Poincaré d’une certaine Eugénie, qui témoigne que sans cesse ce désir d’être contemporaine l’animait alors qu’elle est hospitalisée. La folle vit le présent, elle veut témoigner de son soutien à la France coloniale – au Maroc, malgré certaines prises, de nombreux soldats sont morts dans les combats. « J’ai éprouvé un grand chagrin, je prends part du grand deuil de l’Élysée, et de notre chère France dont vous êtes le chef. […] J’ai grand espoir qu’un jour viendra que nos chers Français l’emporteront – la victoire. »
Ce volume n’offre qu’une brève plongée dans ces archives, il alerte sur ces gisements qui, si on les prend au sérieux, dévoilent une autre histoire collective. Ce qui frappe en effet, c’est combien ces lieux périphériques sont miroirs de leur époque, de la vie « normale ».
Une visite à Sainte-Anne
Refermant ce livre, je songe à la visite que nous avions faite à l’automne 2021 avec l’architecte David Mangin à Sainte-Anne, en plein Paris, dans ce labyrinthe dont la majorité des bâtiments fut édifiée en 1880. Au cours des 140 années suivantes, le lieu a été rempli de nouveaux édifices constituant un petit musée à ciel ouvert de l’architecture hospitalière. Les notes que j’avais prises viennent étrangement télescoper la lecture du Grand renoncement.

« À peine entrés, passe sanitaire bipé, nous avançons dans une allée piétonne arborée. À droite, entre deux bâtiments du XIXe siècle, un tennis. David s’engage le long, comme s’il voulait immédiatement aller voir le derrière de cet îlot du 14e arrondissement, comme si peut-être la meilleure manière de comprendre l’organisation d’un lieu est aussi de s’y perdre. Comment, dans cet espace qui avait à l’origine trois entrées et sorties et n’a plus désormais qu’une entrée et une sortie, piétons, valides et invalides, voitures des soignants et ambulances circulent-ils ?
Des voitures en pagaille
À peine quittée l’allée Verlaine qui traverse la parcelle menant de la rue Cabanis à la rue d’Alésia, l’espace piétonnier est vite un lointain souvenir tant, durant les deux heures que dureront notre visite, les voitures vont davantage que les patients et les soignants être présentes. Il y en a garées partout, et selon des modes différents. Les places des automobiles des médecins-chefs et autres professeurs sont nominatives et un panneau en désigne le bénéficiaire. Plus loin, côté ouest, il y a un parking pour une véritable flottille d’ambulances blanches marquées du logo « GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences ». Plus loin encore, les voitures des personnels (infirmières, cadres de santé, brancardiers…), celles et ceux dont nous découvrirons les portraits en noir et blanc sous une des galeries, occupent le moindre espace de ce qui était un jardin au début du XXe siècle. La grande question qui semble animer notre guide est comment l’espace est organisé dans ce grand rectangle avec, au départ, un plan très simple, harmonieux, donnant une place importante au vide.
Le modèle premier est celui du cloître, l’architecture psychiatrique se déploie à partir de cette forme simple du carré en symétrie puis, au fur et à mesure des années, se transforme, s’ouvre.
Depuis que nous sommes entrés, nous n’avons pas vu un lieu d’hospitalisation, mais des locaux syndicaux, des espaces techniques, une cantine-restaurant et des immeubles d’habitation pour le personnel… 60 % des équipements sont de cette nature. David Mangin appelle cela l’économie présentielle. Déjà, boulevard Saint-Jacques, il m’a montré tous les commerces que l’hôpital génère mais aussi les infrastructures comme la crèche et l’école maternelle en face.
Le règne des acronymes
On se retrouve devant un bâtiment arrondi où sont stockés des mobiliers défraîchis, à travers la fenêtre, de vieilles chaises roulantes et un déambulateur… Puis soudain, on aperçoit derrière un grillage un homme en pyjama dans ce qui semble être le jardin d’un pavillon d’hospitalisation. Nous tombons sur un plan qui nous permet de nous situer, et commençons à comprendre un peu comment cela fonctionne. Notre intelligibilité des lieux ne nous permettra pas d’indiquer son chemin à une dame venue pour consulter et qui cherche le centre de neurologie. David Mangin s’amuse de « cette petite cité des acronymes », une langue de dingue incompréhensible pour celui qui ne la connaît pas : « Secteur 17-18. Hôpital de Semaine. Pôle 16ème ».

La signalétique dans ces allées qui portent toutes le nom d’un poète, d’une artiste plus ou moins « folle » (Camille Claudel, Edgar Poe ou Antonin Artaud) est moins littéraire… Il y a les Urgences psychiatriques CPOA, le centre Raymond Garcin, mais aussi le tribunal de grande instance, la bibliothèque et le Relais H. David date les bâtiments, chacun est marqué par sa période : les constructions des années 1960 sont provisoires pour durer, en 1980, on met plein de façades de verre, les années 2015 sont celles de la fenêtre encastrée… On a cassé des murs et à leur place, on a élevé de hauts grillages. David préfère les murs. Ils structurent l’espace comme ces galeries couvertes qui, à la fin du XIXe siècle, avaient été pensées pour relier par tout temps un pavillon à un autre. C’est l’histoire de la psychiatrie que les noms de chaque pavillon rappellent : on part de Magnan et on arrive à Daumezon.
Sécurité vs intérêt des malades
Notre regard s’arrête sur les ajouts et les petites modifications : ici, un ascenseur, là, une rampe, ailleurs, un cendrier ou un lecteur de badge. Tout, nous dit-il, participe d’une histoire des normes ou plus exactement de la mise en conformité successive des bâtiments. Mais à Sainte-Anne, les architectes des Bâtiments de France doivent sans doute discuter ferme avec les pompiers et la direction de l’hôpital.
Penser un lieu comme une institution psychiatrique, c’est, semble-t-il, d’abord faire en sorte que le schéma directeur réponde à un ensemble d’injonctions de sécurité très éloignées de l’intérêt des patients. Nous n’en croisons pas, de ces fameux patients, en dehors de cette personne âgée venue consulter en « neurologie » dans les Algeco, qui marche lentement au bras d’un ambulancier sur une rampe de macadam. Nous déambulons encore, découvrant le dernier-né des bâtiments, « une débauche de matières et de formes », me glisse David, et au pied duquel, au fond d’une fosse, deux infirmières grillent une cigarette.
Enfin, sans savoir comment nous y sommes parvenus, nous sommes au milieu du square. David Mangin semble avoir trouvé son endroit. Il s’y sent mieux qu’au milieu du carré de culture coincé contre le nouveau bâtiment. Là, il y a un énorme peuplier « Le grand arbre », des sculptures, un bassin vide, un kiosque presque abandonné. On se sent soudain dehors alors qu’on est au beau milieu de Sainte-Anne. Borde cet ilot préservé des voitures, une drôle de construction en bois qui porte le nom pompeux de « Fondation pour la recherche en psychiatrie et en santé mentale ». Ce petit chalet semble abandonné. Les bancs dans le square, eux, sont bien là. On s’assoit un instant avant de quitter l’hôpital.
J’avais oublié combien lors de cette visite nous avions été frappés par la place des inscriptions, que ce soit celle des parkings ou des services et autres administrations.
Et si les écrits des psychiatrisés et de leurs familles étaient mis en silence, recouverts par ces signes… ? Et si l’un des instruments de l’oubli était ce langage ? »
Philippe Artières
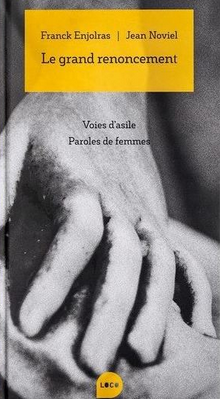
Le Grand renoncement, Franck Enjolras et Jean Noviel (éd. Loco, 2021)