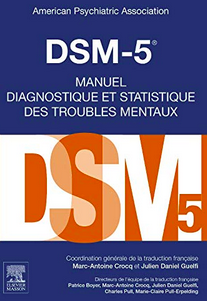
La demande de diagnostic est évidemment compréhensible, légitime pour quelqu’un qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui cherche à savoir ce qui se passe en lui, « dans sa tête » comme on dit. Également pour les personnes de l’entourage cette question survient chargée d’inquiétude, d’incompréhension. Parent, conjoint, ami·e, « mais qu’est-ce qu’il lui arrive ? »
Mais lorsque cette demande, cette attente est reprise par les pouvoirs publics, invoquée comme indispensable par certains psychiatres, cela devient autre chose. Je me demande si ces praticiens ne seraient pas en quête d’affirmation de leur savoir et leurs connaissances, avec comme soubassement souvent inconscient, un désir de reconnaissance, scientifique, publique. Lorsque la question du diagnostic devient comme une exigence évidente, nécessaire, indispensable, cette demande initiale est transformée en une sorte d’injonction à désigner, mais alors à enfermer dans un état, dans une pathologie précise. Cela vient figer, fixer une situation à un moment t.
D’ailleurs, lorsqu’il s’agit de certains de ces « chers confrères », il va s’agir plutôt d’asséner comme un verdict, comme un couperet qui tombe sur un entourage déjà accablé par la situation incompréhensible à laquelle elle est confrontée souvent depuis des semaines, voire des mois. Ce sont des propos entendus par des proches, des parents qui ont poussé la porte d’un psychiatre, d’un psychothérapeute voire d’un psychanalyste par exemple, à qui ils viennent livrer leur désespérance : « le psychiatre nous a dit ne vous attendez pas à ce qu’il fasse polytechnique, à propos d’un enfant de deux ans ». Ou encore autre parole entendue par un père reçu par un chef de service psychiatrique, à propos de son fils aux brillantes études jusque-là, hospitalisé pour une bouffée délirante: « Il faut vous rendre à l’évidence, votre fils est schizophrène ».
Le diagnostic vient là, non pas pour rassurer, mais pour affirmer un savoir. Et surtout indirectement il vient fermer une porte, clore un avenir. D’où le mot qui m’est venu précédemment un verdict !
Face à ces risques de verdicts, j’ai rencontré nombre de situations analogues où il s’est agi pour moi d’abord de ne pas prendre au pied de la lettre de tels énoncés, de tenter de contenir ma colère lorsque je connaissais le praticien en question, de retenir mon accablement face à une telle absence de prise en compte de l’inquiétude du parent qui frise parfois un certain niveau d’inhumanité, d’absence d’une compassion minimale. Il faut alors tenter de faire un petit exercice intérieur, de se dire cette personne a perçu comme cela ce qui lui a été dit, qu’il l’a ressenti comme tel, voire même qu’il l’a peut-être interprété ainsi. Il faut trouver la façon d’accueillir ce désarroi avant de tenter de construire un accompagnement thérapeutique possible : car il y a là un lien perdu, parfois définitivement avec la psychiatrie ! Et en tant que psychiatre moi-même, je devais m’efforcer de tenter de restaurer une confiance possible, car j’étais immanquablement assimilé à un représentant de la psychiatrie, à cette psychiatrie-là.
Or il n’y a pas une psychiatrie, il y a des psychiatries ; comme il y a des façons très différentes de pratiquer la médecine.

Tel est toujours le travail indispensable qu’un thérapeute doit mettre en œuvre avant toute chose : restaurer un lien, un accueil possible, démystifier la perception d’une unicité de la psychiatrie, en prenant soin à ne pas porter de jugement sur le cher confrère. En quelque sorte, chaque thérapeute ne peut faire l’abstraction qu’il fait partie de l’institution psychiatrique.
En exagérant, il m’arrive de réagir de façon virulente dans des discours publics en parlant du « terrorisme » du diagnostic, de cette injonction à donner rapidement un terme qui va empêcher l’inconnue de l’évolution à venir, du devenir de la situation de la personne. Ce qui apparaît prioritaire c’est avant tout, d’abord de prendre en compte la souffrance psychique et parfois corporelle, et les interrogations qu’elle génère. D’autant plus qu’il peut y avoir une intrication de plusieurs éléments psychopathologiques : quelqu’un peut être délirant, persécuté et déprimé, dissocié, avoir des rituels obsessionnels etc. etc. Alors dans ces situations-là, c’est quoi LE diagnostic ?
Dans les années 70 avec l’émergence de la contestation de la psychiatrie et de ses pratiques asilaires, c’était la notion d’« étiquettes » qui était dénoncée, tant dans le cadre du mouvement antipsychiatrique, que dans l’air du temps militant. D’ailleurs ce terme d’« étiquette » n’est-il pas signifiant de l’évocation d’un objet, d’une chose ? Car telle était et est encore souvent la position dans laquelle est tenue une personne malade. La personne devient objet … de soin. Le malade est d’abord nommé ainsi. De l’adjectif « malade », il devient un nom commun, LE malade. Ce n’est plus un sujet, une personne, un individu, et encore moins un citoyen. Or la coutume, qui frôle la blague, bien répandue, est de dire que lorsque vous mettez trois psychiatres en présence d’un patient, vous aurez trois diagnostics différents …
Certains de mes agacements furent aussi l’insistance avec laquelle des psychiatres particulièrement écoutés avançaient lors de séminaires ou de colloques de l’importance du diagnostic. Certes s’adressant à un auditoire de praticiens, de thérapeutes, ils n’avaient nul besoin de préciser cette importance pour le psychiatre, pour le thérapeute, d’établir son hypothèse diagnostique. J’insiste là fortement sur la notion d’hypothèse diagnostique.
Ce n’est évidemment pas inutile mais n’est-ce pas d’abord à usage interne, si je puis dire … C’est un peu pour essayer de repérer à qui l’on a affaire : un psychotique ? un névrosé gravement déprimé par exemple ? et dès lors comment s’orienter dans la relation, comment s’y engager, vers quelle thérapie possible.
C’est donc confondre une sorte de nécessité professionnelle interne aux praticiens avec ce qui est devenu une sorte de revendication de certaines associations encouragée par les pouvoirs publics, avec comme un mantra, « la lutte contre la stigmatisation ».
D’où l’efflorescence incroyable d’experts, de ces pseudos centre-experts, qui ne servent qu’à donner l’illusion à l’entourage que LE DOCTEUR sait très bien quelle est la maladie du malade, donc ce qu’il faut faire pour soigner, voire guérir ! Un bon traitement médicamenteux, psychotropes la plupart du temps, parfois avec un zeste de psychothérapie qui va soigner, guérir votre enfant, votre parent. Pas d’inquiétude, on maîtrise la situation …
Ces centres experts, sorte de plateforme analogues à ces centres d’assistance tous azimuts, sont d’ailleurs bien dotés et encouragés financièrement, surtout lorsque de bons mécènes assurent le fonctionnement de telle ou telle fondation qui s’engage fortement à ENFIN développer la recherche … génétique, psycho-pharmacologique, et d’autres techniques prometteuses et modernes.
Par rapport à ses nominations, divers, différent, malade, fou, schizophrène, paranoïaque, dépressif, bipolaire, etc. etc., est-ce que la question ne serait pas de comment nommer un individu en souffrance ? Comment changer le regard sur la pathologie psychique ? Comment se déprendre de cette peur d’utiliser le mot de fou, de folie ? Avec l’espoir de trouver une nomination, un mot qui soit acceptable, propre, aseptisé, non excluant permettrait d’accueillir, enfin, une personne, un individu, de faire hospitalité à un humain. À une époque, nous avions assimilé cette question au rejet de l’autre, parce qu’on le trouvait différent, parfois s’exprimant dans une langue, un discours incompréhensible, parce que délirant, extravagant.
On pourrait s’amuser à faire le même parallèle avec les différentes nominations des établissements accueillant des malades mentaux : il y eut d’abord les asiles d’aliénés, puis empruntant la voie de la médecine, respectable et rassurante, ce furent les hôpitaux psychiatriques. On quittait la référence au renfermement pour passer du côté du soin. Puis dans les années 70, au moment de l’essor, de la prééminence, pour ne pas dire l’hégémonie de la psychanalyse l’hôpital psychiatrique changea de nom : ce fut les centres hospitaliers spécialisés (CHS ). Enfin plus près de nous, dans ce mouvement d’évacuation de la notion de psychisme, les centres psychothérapiques sont devenus Établissements de santé. Dernier changement, désormais ce sont les Établissements publics de santé.
Et si au travers de cette succession de nomination tant pour les individus que pour les lieux d’accueil et de soins, il s’agissait d’un malaise à dire, à regarder en face la folie qui existe depuis des millénaires. N’est-elle pas indissolublement liée à l’être humain ? Ne fait elle pas peur à chacun, à chacune d’entre nous. Changer les noms serait peut-être une tentative pour mettre à distance nos propres démons intérieurs, nos propres angoisses, propres divagations, et autres délires. Ce dont il s’agirait alors, ne serait-il pas de pouvoir « savoir accueillir », pour soulager les souffrances psychiques, corporelles, et donc de donner les moyens et les conditions pour permettre à des lieux de continuer à exister, avec des gens formés à l’accueil, à l’accompagnement et au soutien des personnes en souffrance psychique mais aussi à leur entourage?
Paul Machto