Alain Gérard est une figure de la psychiatrie. Il a inscrit son exercice dans le mouvement. Par séquences professionnelles longues, il a pratiqué la psychiatrie publique, la recherche clinique, il a été expert à l’Agence du médicament et a suivi une formation psychanalytique. Alain Gérard est maintenant posé depuis une trentaine d’années comme psychiatre libéral à Paris. Auteur de nombreux ouvrages, il vient de publier aux éditions Michel Lafon Le malheur inutile. Il y interroge des témoins et des injonctions à souffrir par la violence des managements, des craintes pandémiques, des dérèglements de la société. Il engage à inventer une nouvelle pratique de soin et surtout à refuser le « malheur inutile ». Peu de temps avant la sortie en salles de Sur l’Adamant.

François Aubart : Votre livre et ce film sont tous les deux tournés vers le grand public. Ils ont en commun une vision positive, optimiste, voire accueillante de la maladie mentale et des fragilités à un moment où notre monde bascule vers plus d’angoisse. Vous semblez travailler désormais avec un regard volontairement décalé, sensible aux bascules de la société. Pourquoi ce changement ?
Alain Gérard : J’ai développé un peu par hasard une double formation à la pratique psychiatrique, à la fois avec un regard biologique et un regard psychanalytique. J’ai toujours considéré qu’il était important que les citoyens soient mieux informés sur les problèmes de santé dans le champ de la psychiatrie au sens large. J’ai essayé à chaque fois de marquer des frontières entre, par exemple, la dépression-maladie et, simplement, des souffrances psychiques ; des frontières entre ce qui relève du bon usage des médicaments et ce qui relève des psychothérapies en essayant à chaque fois de préciser des champs cliniques, et en regard, proposer de bonnes utilisations des outils de traitements.
Des gens qui devraient aller bien
F. A. : Pourquoi ce sous-titre, « 5 histoires de liberté retrouvée » ?
A. G. : Parmi ceux que je reçois en consultation, les gens que j’évoque dans le livre ne relèvent pas de la maladie mentale. J’ai le sentiment, depuis quelques années, de recevoir de plus en plus souvent des personnes en souffrance qui viennent me consulter alors que c’est la société qui les entoure qui est malade.
Prenons l’exemple de cette jeune infirmière, Valérie. Elle a la tête sur les épaules ; elle a choisi sa formation, son métier qu’elle aime. Elle a été heureuse au travail. Et puis de poste en poste, elle découvre que le métier devient de plus en plus difficile, des collègues absentes, des sollicitations de plus en plus nombreuses. Elle est fatiguée, jusqu’au jour où la cadre de soins lui demande de compter dans la pharmacie le stock de médicaments classés dans les stupéfiants et où elle répond qu’elle ne va pas pouvoir le faire. « J’ai des malades qui m’appellent et souffrent, je dois aller les voir. » La cadre lui lancera en retour « Mademoiselle si vous ne supportez pas les cris je vais vous offrir des boules Quies ». À la fin de son travail, elle ira compter les médicaments. Elle rentrera chez elle en banlieue parisienne. Le lendemain matin, elle ne peut se lever. Elle est sidérée de ce qui est, en fait, le résultat de toute une usure, d’un métier qui lui plaît mais qui a été vidé de son sens.
Lors de nos échanges, mon rôle n’était pas seulement de lui prescrire des médicaments pour l’aider à tenir dans une situation qui n’était pas normale. Cela a aussi été de l’aider à s’extraire d’une situation qui était pathogène en sortant de mon rôle classique et lui proposer d’aller vers une alternative professionnelle.
Dans ces différentes histoires, je raconte des gens qui, au départ, n’ont pas de fragilité particulière; ce sont des gens qui, normalement, devraient aller bien et qui, dans cette société dans laquelle nous vivons se mettent à aller mal et ne peuvent pas répondre aux injonctions croissantes, somme de demandes familiales, professionnelles, sociétales intenables. Regardez la somme de ce qui est demandé à une mère ou un père de famille qui n’habite pas Paris, qui veut s’occuper de ses enfants, de leur scolarité, qui ne veut pas qu’utiliser que des plats tout préparés, qui veut s’occuper un peu de sa propre personne en faisant un peu d’exercice physique et en respectant les règles d’hygiène de vie que recommandent la « faculté » et les « experts » des domaines différents, qui est soir et matin dans les transports, qui fait face aux exigences dans le travail.
F. A. : Cette approche est-elle différente de vos livres précédents ?
A. G. : C’est une approche plus sociologique parce que les gens qui viennent maintenant me voir ne font pas partie des gens qui ont les métiers les plus durs. Ils ne sont pas mineurs, ils ne sont pas cantonniers, ils ne sont pas des ouvriers à la chaîne, ils sont des gens des classes moyennes. Mais ils sont soumis à des sommes d’exigences intenables.
F. A. : Et la réponse univoque du médicament n’est pas celle que vous avez adoptée et proposée, mais quelque chose qui est à la fois plus compliqué et plus simple.
A. G. : J’avais le sentiment un petit peu naïf que je soignais « bien » et que « je m’en sortais » quand je prescrivais un médicament psychotrope. Je n’avais pas d’état d’âme à le faire parce que j’avais le sentiment à chaque fois de bien rationaliser ma prescription, à la fois dans le choix du médicament, dans sa posologie, dans la manière de démarrer les traitements et dans la durée de ces traitements. Mais, petit à petit, je suis entré dans une sorte de doute sur ma manière de travailler. J’ai été amené à intervenir auprès de personnes, me demandant très au-delà de ce qui était mon rôle habituel qui était alors de les remettre « en forme » , mais on me demandait de faire en sorte qu’elles retournent dans un mode de vie qui était devenu en réalité pathogène. Elle subissait un métier où le management était mauvais ; elle devait éduquer deux enfants, avoir un peu de disponibilité pour son conjoint, faire un peu de sport, aller de temps en temps au cinéma, résister aux exigences des transports. La prise en compte de tous ces facteurs avait toujours été en arrière-plan dans mon travail. Mais, dans les dernières années, j’ai fait le constat que cet arrière-plan passait au premier plan. Je devais réfléchir sur les manières de « traiter » et en quelque sorte, sortir de mon rôle précédent.
F. A. : Pourquoi ce titre, Malheur inutile ?
A. G. : Évidemment qu’il n’y a pas de malheur utile, mais il y a des malheurs inévitables. La mort d’un proche, la maladie, un accident, peuvent être considérés comme des malheurs inévitables. Ce que j’appelle un malheur inutile est un enchaînement d’évènements où on aurait pu faire autrement. Les folies du management dans certains systèmes, les exigences de rentabilité dans d’autres domaines tout un tas de variables pourraient fonctionner mieux et autrement sans que ce soit la grande révolution. Et c’est pour ça que j’ai écrit une introduction qui évoque les propos de Franklin Delano Roosevelt qui, en 1940, parlait « des choses essentielles que notre peuple attend de son système économique et social ». « Elles sont simples », écrivait-il en les énonçant. On se dit, quatre-vingts ans plus tard, qu’il n’y a pas grand-chose de ce qu’il annonçait comme possible et simple qui ait été résolu et Roosevelt n’était ni communiste ni trotskiste. On aurait pu, avec un minimum de de réflexion et de bon sens, éviter bien des malheurs de vie.
F. A. : Il y aurait donc une sorte de continuum entre d’un côté ces situations de malheurs inutiles que vous venez de décrire et, à l’autre bout, ces malades très abîmés, très fragiles, psychotiques, qui sont accueillis Sur l’Adamant si bien filmé par Nicolas Philibert…
A. G. : C’est un film qui m’a beaucoup touché. Il me fait écho lorsque j’étais jeune psychiatre à l’hôpital. La psychiatrie dite « institutionnelle » avait le temps de prendre le café avec les patients, d’échanger, de « passer du temps » avec eux. C’était un mode d’activité qui était loin d’être parfait parce que c’était quand même dans une espèce d’enfermement hospitalier. Heureusement, il y a eu une période assez extraordinaire qui a permis, avec le « secteur », d’organiser la sortie de l’hôpital pour tous les patients qui le pouvaient. Simultanément, il y a eu une terrible réduction des moyens accordés à la psychiatrie en général et en particulier à la psychiatrie publique. Cette qualité d’échanges a disparu dans beaucoup d’endroits ; on voit là, à travers un film qui est une œuvre d’art, comment une société de proximité qui va bien peut permettre à des individus qualifiés de fous d’exprimer des potentialités fantastiques. On les voit jouer de la musique avec talent ; on les voit écrire et dessiner avec bonheur ; on les entend prendre la parole, on les voit cogérer un budget ensemble.
Un travail de déstigmatisation fabuleux
F. A. : Et cela, dans l’architecture magnifique d’un bateau-péniche conçu pour le projet il y a dix ans avec ses persiennes ouvertes sur la ville, ses promenades extérieures ensoleillées et une passerelle porte ouverte sur le quai de Paris.
A. G. : Oui, c’est étonnant. Cela contribue à donner à l’œuvre cinématographique une poésie, un recul exceptionnel. Le metteur en scène a su se fondre de manière magnifique. On ne le voit pas. Il est dans le mode de vie avec les gens qui lui parlent. Il y a une présence de tous ces êtres exceptionnels. À ce titre, c’est un travail de déstigmatisation fabuleux. On ne peut que regretter politiquement qu’il n’y ait pas plus d’Adamant sur tous les territoires.
Pour ces patients, je pense que si on associait davantage psychiatrie institutionnelle, chimiothérapie bien conduite et psychothérapie adaptée on transformerait l’avenir des patients. D’ailleurs, il y a dans le film un patient qui l’exprime avec une pertinence assez étonnante en évoquant pour lui-même la nécessaire chronologie du médicament puis de la communication.
Recueilli par François Aubart
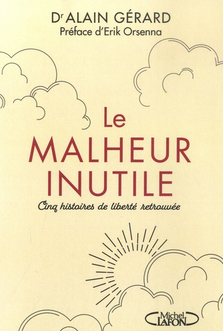
Le malheur inutile, Alain Gérard, éditions Michel Lafon