
Delphine Glachant est psychiatre, militante, ancienne présidente de l’Union syndicale de la psychiatrie. Dans un long témoignage, publié dans la revue Pratiques. Cahiers de la médecine utopique, elle raconte son histoire. Nous le republions avec leur autorisation, tant il montre que le pire peut côtoyer le meilleur.
Armenouhi Tchitchekian, ma mère, s’est éteinte le 27 septembre 2023. Elle était infirmière de secteur psychiatrique. Avec elle s’en est allée une partie de l’histoire familiale, qui croisait la grande histoire. Hasard des événements : le Haut-Karabagh disparaît en même temps. Tout comme le grand tremblement de terre d’Arménie, en 1988, avait emporté des dizaines de milliers d’Arméniens en même temps que ma grand-mère maternelle était partie.
Je fais mon premier Covid dans la foulée. Ma mère m’a légué, d’une manière et d’une autre, une attention aux plus vulnérables et une manière de les approcher en respectant leur dignité, par-delà les considérations médicales. Elle m’a enseigné l’indispensable et le respect du savoir infirmier, le savoir-faire, le savoir-être. Elle m’a ainsi transmis ses interrogations sur les rapports de domination, mais aussi, sans le vouloir, sa façon de se débrouiller ou pas avec cela. Elle m’a aussi appris la ténacité pour faire face à l’adversité. Adolescente et jeune adulte, j’en ai soupé des soirées à écouter ses histoires de fous, des fois avec intérêt, voire avec fascination, des fois avec une certaine fatigue. Et que de dîners écourtés ou sans elle parce qu’elle partait à pas d’heure à sa séance d’analyse. Sa bibliothèque m’en imposait. J’ai lu certains livres. La plupart, non. Finalement, j’ai choisi la psychiatrie à la fin de mes études médicales et là, je suis presque repartie de zéro. Par chance, les deux enseignants universitaires de psychiatrie de ma région étaient psychanalystes.
Je m’y suis retrouvée. Faisant mon internat en Picardie, j’ai découvert la psychiatrie asilaire, particulièrement à Clermont de l’Oise. Après le choc initial, j’ai appris à décoder quelques fonctionnements de base d’un service de psychiatrie. Par exemple : le pécule distribué chaque mois au PC (poste de commande) par les surveillants aux patients qui avaient travaillé en ergothérapie. Cela ressemblait fort à un centre d’aide par le travail intra-muros. Étages non mixtes, dortoirs, salles communes. Je n’ai pas le souvenir d’ateliers thérapeutiques. Le premier patient que j’ai admis dans ma première garde s’est suicidé dans la nuit par strangulation avec ses draps. Le médecin chef s’est pendu aussi durant mon premier semestre.
Ce n’est pas facile d’apprendre à être psychiatre
Ce n’était pas évident de rentrer dans ce monde. Mon immaturité politique ne me permettait pas à l’époque de comprendre les tenants et les aboutissants de tout cela, même si cela me questionnait et m’a amené à lire rapidement Asiles d’Erving Goffman. Plus tard dans mon internat, toujours à Clermont de l’Oise, j’ai pu connaître les rudiments de la psychothérapie institutionnelle, sur laquelle j’ai fait mon mémoire de spécialité, et le travail de psychiatrie de secteur. J’ai aussi adhéré à l’Union syndicale de la psychiatrie, que je n’ai plus quittée.
Ce n’est pas facile d’apprendre à être psychiatre. On a tous besoin de « pairs aidants ». Certains diront des compagnons ; d’autres des maîtres. C’est un peu pompeux pour moi. Ni dieux ni maîtres. Avec les figures qui m’entouraient, il fallait bien que je trouve mon chemin. Mon expérience ensuite à Ville-Évrard (93) m’a permis d’approcher des questions plus directement politiques, notamment dans ce qui se joue au sein d’un établissement. J’en ai retenu quelques fondamentaux : ne pas faire de concession, repérer les enjeux de pouvoir, analyser le discours, observer la valse des prétendants, ne rien lâcher. Le médecin-chef qui m’a appris cela était peu apprécié, il ne savait pas se tenir avec les autres professionnels, mais il m’a appris une chose clinique importante : il posait les bonnes questions aux patients, les ramenant toujours vers leur subjectivité.
À La Courneuve et Stains, j’ai découvert la psychiatrie sociale. Quand les gens ont comme première préoccupation ce qu’ils vont pouvoir manger le soir ou leur expulsion à venir, s’ils ont un logement, le travail thérapeutique n’est pas le même. L’assistante sociale devient la professionnelle la plus importante du service ou encore l’interprète qui fera l’intermédiaire avec l’immigré sans papiers. C’était difficile, mais cela m’intéressait. La vie m’a amenée au centre hospitalier Les Murets (94). J’y ai approfondi ma connaissance et aiguisé mon attrait pour la psychothérapie institutionnelle, qui balbutiait au sein du secteur, et qui donnait sens à mon travail. J’ai pris conscience de l’importance de la médiation artistique. Le travail institutionnel était captivant, petit pas par petit pas, avec des collègues qui ont beaucoup nourri mes réflexions. Je me suis beaucoup investie. Mais avec les années, les conditions du travail se sont fortement dégradées. Et mon moral avec.
Les rapports avec la direction se sont tendus. J’étais souvent confrontée à des situations très insatisfaisantes, avec des effectifs médicaux et infirmiers insuffisants, des personnels trop peu formés, certains ayant peu d’intérêt pour leur métier. J’ai bien compris que la bonne volonté ne suffisait pas. C’est la réflexion qui fait avancer. Les bons sentiments n’ont rien à voir avec le soin et vont parfois de pair avec des agir brutaux. J’ai compris aussi que la peur peut prendre tout un chacun, soignés et soignants, dans ses entrailles, mais que ce sont les patients qui subissent tout cela avant tout.
J’ai décidé de mises en chambre d’isolement parce que le personnel avait peur
Pour que les choses bougent, il faut du collectif. Rien ne se décrète tout seul ni par une poignée. Et il est bien difficile de mettre au travail le collectif. J’ai assisté à des scènes de maltraitance le plus souvent par négligence, mais parfois aussi de la maltraitance directe, discrète. J’ai eu parfois honte de ce que je faisais, des mises en chambre d’isolement faute d’arriver à réfléchir ensemble, collectivement. Des mises sous contention, parfois scène de barbarie où la jouissance d’arriver à maîtriser le patient se mêle à l’inconfort et à la gêne de l’avoir fait. Je me sentais responsable car en tant que médecin, on nous apprend à être ceux qui prennent les décisions. J’ai décidé de mises en chambre d’isolement parce que le personnel avait peur, parce que j’avais le souci de protéger les équipes, parce que je savais qu’il me serait reproché de ne pas l’avoir fait pour cette même raison, parce que je n’ai pas eu le cran de m’opposer à cette attente collective.
Nous étions trop souvent dans l’agir. J’apprécie que la question de la contention devienne un vrai sujet, qu’elle sorte du non-dit. Le développement qu’en fait Mathieu Bellahsen dans son dernier livre, Abolir la contention, est important. Culture de l’entrave résonnant avec la culture du viol. Le corps devient objet de possession de l’autre. On ne fait pas assez attention au corps en psychiatrie. J’ai aussi décidé de contentions, exceptionnellement. Précipitation, tension, peur, c’était toujours des moments difficiles, des situations dont on sort rincé. Le sentiment de culpabilité m’étreignait souvent, la honte parfois. Plus d’une fois dans mon exercice, je suis passée par des phases de fatigue psychique intense. Pour relever la tête, je me suis engagée dans le syndicalisme à l’USP, et j’y ai trouvé auprès de collègues et amis militants un cap intangible pour continuer à avancer, malgré les politiques de destruction de la psychiatrie et du secteur auxquelles nous faisons face.
J’ai milité au Printemps de la psychiatrie, qui m’a permis d’autres compagnonnages essentiels. J’ai bougé de mes lignes. J’avais bien compris en débutant la psychiatrie que je ne savais rien, les années m’ont montré les transformations permanentes et nécessaires pour y exercer. Et à cette heure, à mon âge, comme bien d’autres, je suis sûre que jusqu’au bout j’apprendrai et j’évoluerai.

En 2022, je suis partie vivre en Bretagne. Chemin faisant, je me suis retrouvée à postuler dans le secteur de Landerneau dans le Finistère. Lieu de soins que je connaissais pour ses journées d’études de psychothérapie institutionnelle fort intéressantes. Lieu chargé d’une histoire psychiatrique particulière dont l’équipe actuelle continue de s’inspirer. Mon éblouissement (si, si…) a été extrêmement prometteur. Pourtant, j’ai mis quelques mois à me repérer dans la complexité de ce montage, où tout s’imbrique, mais où des nouveaux chemins se dessinent chaque jour. L’institutionnel se travaille sans cesse. J’ai mis du temps à connaître tout le monde, et surtout le réseau, si riche.
Quel accueil dans ce secteur, mais quel accueil !! Au-delà de la gentillesse des uns et des autres, une véritable culture de l’accueil est travaillée, qui traverse les patients et le personnel. Encore une fois, le temps laissé à l’observation, la possibilité de poser des questions, auxquelles tout le monde répond, la réunion accueil/formation où anciens et nouveaux se racontent leur perception et l’histoire du secteur. Une fonction phorique ressentie dans le quotidien.
La fonction soignante reconnue en chacun, soignant et soigné, sert de holding aux nouveaux. À Landerneau, on fait de la psychiatrie de secteur, de la vraie, celle où tout le monde circule, patients, soignants, d’une unité à l’autre, vers la ville, vers la mer. Plus de dix gîtes (comprenez séjours thérapeutiques) s’organisent chaque année, y compris pour aller à la pêche ! La voiture solidaire, conduite par les patients, dont le carburant est payé par la pâte à crêpe, sert à emmener ceux qui le souhaitent vers les lieux de soins, faire leurs courses ou pour des sorties à plusieurs. Les personnes, les biens, la parole circulent. Mais on fait aussi de la psychothérapie institutionnelle, pensée, élaborée, où le collectif est central. Tout se discute. Avec un planning de réunions très pointu, qui, loin d’être ce que certains pourraient appeler de la réunionite chronique, sert simplement de canevas pour que (presque) tout puisse se faire. La réunion temps et moyens, pour attribuer les voitures, répartir le personnel ; la réunion planning ; la synthèse matinale, où les infos circulent avant d’être retransmises aux équipes dans la journée. Tel patient qui a appelé dans la nuit parce qu’il était angoissé. Telle patiente qui n’est pas venue à l’hôpital de jour alors qu’elle était attendue. La continuité d’être, ce n’est pas qu’une formule. C’est un souci de l’autre partagé. Quand quelqu’un commence à décompenser, on en aura tellement parlé au cours de plusieurs synthèses successives que lorsqu’il arrive sans prévenir au centre médico-psychologique (CMP), ça va de soi qu’il est accompagné à l’hôpital, tranquillement, où là-bas, il est attendu et accueilli.
Parfois, les entrées se font directement, mais le plus souvent, les personnes passent par les urgences de ce centre hospitalier général (CHG), de l’autre côté du rond-point. Deux infirmiers du service de psychiatrie se détachent pour aller faire l’entretien d’accueil : un infirmier de l’intra et un autre du CMP. Il n’y a pas de psychiatre sur place, l’urgentiste fera les prescriptions de base, voire d’urgence. La nuit, ce sont deux infirmiers de l’intra qui y vont, ce qui laisse seulement deux infirmiers dans l’unité pour quarante-sept lits. C’est peu, trop peu. Ce chemin que font les infirmiers pour aller vers le patient qui se trouve aux urgences est essentiel. Le plus souvent, ils se connaissent. Si ce n’est pas le cas, cela fera un premier repère pour le patient qui arrivera dans une unité d’hospitalisation qu’il ne connaît pas, parfois pour la première fois en psychiatrie. Encore une continuité essentielle.
Le centre médico-psychologique, vrai QG pivot de tout ce secteur, est ouvert 7 jours sur 7, de 8h30 a 21h30 ; sauf le dimanche, seulement l’après-midi. La première fois que je suis allée à Landerneau pour repérer les lieux, un dimanche d’octobre, j’ai même pris une photo de la pancarte à l’entrée tellement j’étais bluffée. Et d’ailleurs, un infirmier, me voyant de l’intérieur, m’a invitée à entrer dans le CMP et nous avons discuté un moment.
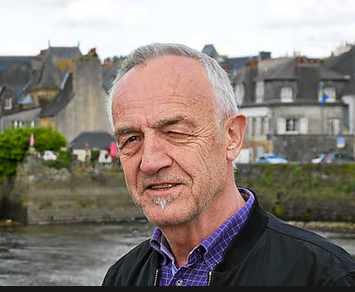
Ça fait maintenant presque un an que je travaille à Landerneau. Je retrouve un enthousiasme à travailler et j’oublie que la psychiatrie est dévastée ailleurs. Je reprends espoir et conviction que le soin digne, humain, émancipateur existe. Je suis toujours épatée par tout ce qui se discute dans les réunions, soignants/soignés, les assemblées générales des clubs thérapeutiques. Il y a trois clubs, tout comme il y a trois CMP : le principal à Landerneau, et ses antennes à Crozon, à Pont-de-Buis.
La population approche 110 000 personnes, le territoire est très étendu, sa topographie particulière complique les circulations ; il est très diversifié par son histoire sociale. Il y a aussi un hôpital de jour, bientôt un deuxième, un Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), un appartement associatif de trois places, une maison communautaire de cinq places et un studio. Mais surtout, chaque club thérapeutique organise ses propres ateliers dans divers lieux, aux CMP ou en ville.
L’équipe parcourt les nombreux foyers, maisons de retraite, sur tout le territoire du secteur, avec visites systématiques régulières. La prévention prend tout son sens. L’équipe se répartit aussi la psychiatrie de liaison dans les services MCO (médecine, chirurgie obstétrique). Sans compter, depuis un an, un projet jeunes qui se déploie dans les lycées et donne lieu à pas mal de consultations des 15-18 ans, ainsi que des groupes spécifiques au CATTP. Il y a un peu moins de quatre-vingt-dix infirmiers pour l’ensemble du pôle. Cela fait une grosse équipe, qui circule beaucoup d’une structure à l’autre. La plupart des infirmiers ont une double affectation….
L’essentiel du travail soignant se fait en ville ou au domicile des patients. Les soignants sont autonomes, mais réfèrent de ce qu’ils font aux médecins. Il n’y a pas d’aide-soignant, mais une bonne équipe d’agents de service hospitaliers (ASH) qui participe largement à la dynamique quotidienne. Ceci, c’est l’architecture externe des soins, mais je veux revenir sur l’architecture interne, qui est d’une richesse inimaginable et très pensée. Je me forme au quotidien, comme tout le monde. Chaque jour se succèdent de nombreuses réunions entre professionnels ou avec les patients. Toutes donnent lieu à réflexion et discussion. Je vois cela comme très foisonnant, tout en étant calme. La réunion du pécule par exemple, comme moyen de régulation des tensions, mais aussi comme façon de mettre au travail chaque patient dans ses soins grâce au collectif. Comme à la clinique de La Borde, chaque journée commence par un café-accueil où les ateliers du jour et les tâches quotidiennes sont énoncés ; et les patients s’inscrivent. Cela donne une dynamique intéressante. Il y a la feuille du jour, etc. tous ces repères quotidiens immuables qui aident les patients et les soignants (!) à structurer leurs journées… et leurs pensées. La cafétéria, l’ergo, la relaxation, la méditation, l’écriture, le sport, le théâtre, le poulailler, l’aquarium, les oiseaux, l’atelier bois, les jardins… Ah les délicieux légumes du jardin… j’en passe évidemment tellement il se passe de choses.

Régulièrement, peut-être tous les deux mois, un événement vient ponctuer la vie du secteur : fête du jardin, fête des associations, foire aux puces, soirée de la poésie, mise en place du foyer pour la période des fêtes de fin d’année, tournois de pétanque… autant de prétextes pour que soignés et soignants préparent ensemble et se retrouvent dans la convivialité. Ce sont aussi de nombreuses occasions de vendre les produits des ateliers, y compris des crêpes, forcément, ce qui permet d’apporter de l’argent aux clubs thérapeutiques, lequel sera réutilisé pour pérenniser l’existant ou de nouvelles initiatives.
L’argent, nerf de la guerre, donne lieu à une réunion comptes quotidienne. Cet argent a permis à l’association Treizerien1, cadre juridique des trois clubs thérapeutiques, d’acquérir la maison communautaire, avec de nombreux dons et un crédit de vingt-cinq ans !
Globalement, les familles sont sollicitées rapidement et régulièrement après le début de soin en hospitalisation. Les visites quotidiennes sont par contre limitées de 17 heures à 18h30. Pour ne pas empêcher les patients de participer à tout ce qui se passe dans le secteur.
Mais aussi la réunion institutionnelle hebdomadaire, pendant 1h30, de tout le personnel, y compris les aides soignantes (je le souligne parce qu’elles ont une place essentielle dans l’ambiance des soins), lieu éminemment important, dans lequel les gens parlent. Évidemment, cette réunion se fait avec un animateur, quel que soit son statut, mais le plus souvent il s’agit d’un infirmier, qui fait la régulation et cela fonctionne. Je suis souvent captivée par la qualité des échanges et la liberté de paroles. Je trouve capital que dans toute réunion, il y ait un ordre du jour et que l’animateur accepte le rôle de distribution de la parole. Je n’ai pas la naïveté de croire que toute hiérarchie disparaît dans ce cadre, mais le dispositif permet qu’elle soit contenue, voire de mettre en évidence les abus de verticalité. La culture de l’équipe permet cela. C’est là que l’équipe traite les injonctions de la direction, notamment autour de la préparation de la certification, mais aussi de ce qu’implique la nouvelle tarification à l’activité en psychiatrie : le codage généralisé. J’ajouterais un certain nombre d’ombres au tableau, car ce secteur fait un très bon travail, mais n’est pas un village gaulois isolé. Ce secteur subit comme partout les méfaits des politiques de santé. Notamment, l’établissement mène une politique de contractualisation qui précarise et fragilise les personnels. Ils restent en CDD des années, ne sont « stagiairisés » qu’au bout de six-huit ans. C’est inadmissible.
Il n’y a pas de chambre d’isolement dans le service
Ce mois-ci, le dispositif d’alarme du travailleur isolé (DATI), mis en place dans les services de psychiatrie en 2004 après le double homicide de Pau, arrive dans le service alors que jusque-là, les équipes s’en étaient passées. Ressentir le besoin du DATI, c’est mauvais signe et l’arrivée du DATI en lui-même modifie l’ambiance. Cela témoigne de situations dans lesquelles l’équipe se sent en insécurité, dépassée dans sa capacité de contenance. Il y a eu pas mal de turn-over ces dernières années (30% de l’équipe infirmière s’est renouvelée), alors que ce n’était pas le cas dans des temps plus anciens. Le rythme de travail est soutenu. Ça me fait plaisir de voir des personnes engagées dans leur travail, ce qui a raisonné avec le mien, mais le collectif doit faire attention et réfléchir encore.
Il n’y a pas de chambre d’isolement dans le service. L’isolement n’est réalisé en chambre banalisée que lorsqu’il y a quelqu’un en contention. C’est rare. Entre dix et quinze patients par an. Jusqu’à la semaine dernière, ça faisait quatre-cinq mois qu’il n’y avait pas eu de contention. Un homme délirant, agité, agressif, toxicomane, impulsif, a été hospitalisé. La loi de 2023 est respectée à la lettre, y compris dans l’information aux proches.
Globalement, quand quelqu’un ne va pas bien et est instable, le personnel se relaie pour rester presque tout le temps avec lui. C’est le principe. La capacité de contenance psychique est vraiment la clé. Comme il est nombreux en journée et que tout le monde se sent concerné, jusqu’aux assistantes sociales, ASH, psycho, etc., cela fonctionne pas mal. Des packs sont aussi réalisés, plusieurs fois par semaine, pour plusieurs patients. Franchement, je suis épatée par tout ça. Ça peut paraître une évidence de soigner comme ça, mais c’est très loin d’être le cas. J’ai retrouvé un plaisir à travailler qui me fait beaucoup de bien.
Voilà… Je dresse peut-être un tableau trop positif, mais pour moi, cela reste vraiment un bastion de la vraie psychiatrie de secteur et de la psychothérapie institutionnelle. J’entends beaucoup de personnes désespérées comme je l’ai été, ou j’observe des professionnels qui ont renoncé. Beaucoup quittent le service public. Les jeunes générations pensent plutôt à l’installation dans le privé. Mais de nombreux Landerneau existent et peuvent se multiplier. Les directives qui nous aliènent peuvent être subverties ou encore être utilisées pour continuer à travailler l’émancipation des patients. Le tout, c’est de créer du collectif et le mettre au travail, le collectif associant soignés et soignants.
Delphine Glachant
