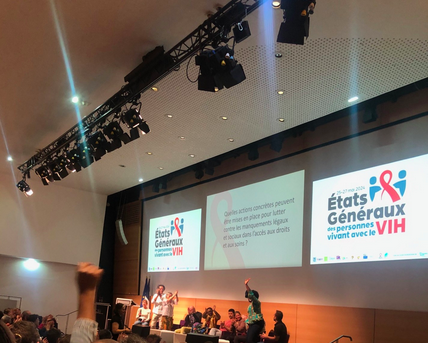
Dans les années sida, lorsqu’on ne connaissait aucun traitement, l’annonce de notre séropositivité nous inscrivait dans une sorte de loterie du destin : tu vis ou tu meurs ! Aucun pronostic ne permettait de savoir si tu allais développer des maladies opportunistes et à quel rythme. J’ai personnellement été contaminé en 1985 et bien que mes défenses immunitaires se soient effondrées, je n’ai jamais eu de maladie opportuniste. Pour d’autres, l’annonce de la contamination était le prélude aux maladies qui se succédaient et à une mort rapide.
La plupart d’entre nous étions jeunes, en pleine forme, assoiffés de vie et pourtant nous assistions impuissants à la disparition de nos proches, de nos amis, de nos amants. Nous nous interrogions « Pourquoi suis-je encore en vie ? ».
Cette confrontation à la mort, inhabituelle pour des jeunes, nous avons dû nous y habituer et nous avons aussi dû écouter ceux et celles qui voulaient mettre un terme à leur souffrance et à leur déchéance.
Choisir sa mort ? Une phrase redoutable quand on pense à l’envie de vivre qui habitait tous ces malades. Cette question apparaissait quand le corps lâchait et qu’il n’y avait plus d’espoir. Pour beaucoup, prolonger une agonie n’était pas envisageable. Après nous être tant battus pour vivre, le dernier acte de bravoure pour niquer la mort était de la provoquer ! L’étrangeté de cette maladie, l’impuissance du monde médical ont permis, parfois, d’ouvrir des espaces, de trouver des oreilles attentives pour discuter de cette mort anticipée.
Pour mon mari, le choix de sa mort était très important. Sa descente aux enfers fut rapide. En quelques mois son corps s’est affaissé. Après de nombreux allers et retours entre la maison et l’hôpital, dans le secret de sa chambre, il avait décidé de ne pas aller plus loin et de faire appel à un ami pour l’aider à mourir.
Tout fut minutieusement organisé, le jour, l’heure et la visite de l’ami fidèle prêt à tenir sa parole pour lui faire la piqure fatale. La vieille de la date fatidique, une éclaircie se produisit : la nuit fut douce et le lendemain matin plus léger que d’habitude. Gilles appela son ami pour décommander la visite libératrice.
Ainsi, il continua de vivre, mais en choisissant à tout moment s’il voulait ou pas continuer.
À cette époque, il n’y avait pas de loi spécifique sur l’accompagnement à mourir. Je me suis souvent demandé comment les choses se seraient passées dans le cadre de la loi Leonetti. Et je me demande comment le législateur rédigerait la loi actuelle pour prendre en compte ces demandes de mort assistée qui, à l’époque, étaient accordées par simple humanité.
Un ami proche m’a un jour demandé de venir pour aider son amant à mourir. Nous étions seuls. J’ai encore en moi le souvenir de ces moments dramatiques dans la solitude de ce que nous vivions.
J’ai le souvenir d’une amie proche qui s’était résignée à aller finir sa vie dans un centre de soins palliatifs et qui, quelques jours plus tard, s’était décidée à ressortir en choisissant simplement que l’heure n’était pas venue ! Elle est morte des semaines plus tard.
Ce qui m’interroge, c’est que le monde médical était globalement à l’écoute du désarroi des malades et je n’ai jamais entendu de réflexions de type éthique pour ne pas aider quelqu’un à mourir.
À l’époque où un nouveau projet de loi pour la fin de vie est en discussion, je suis désorienté par le silence : où sont les associations de lutte contre le sida ? Où sont les témoins de cette époque qui pourraient dire comme moi que la fin de vie doit être accompagnée dans le respect de la demande des malades?
Ce silence est pesant. Que proposeriez-vous aujourd’hui à tous ces malades dont le pronostic vital est engagé, mais sans terme précis, qui vivent une dégradation progressive de leur état et se voient réduits à des corps décharnés et vidés de toute force ? J’espère que la future loi prendra en compte ces situations et que l’on saura demain répondre avec chaleur et humanité au choix de ceux qui ne peuvent plus vivre.
Francis Carrier
Hier militant à Aides, président de Grey Pride, et un des fondateurs du CNaV (Collectif national autoproclamé de la vieillesse)