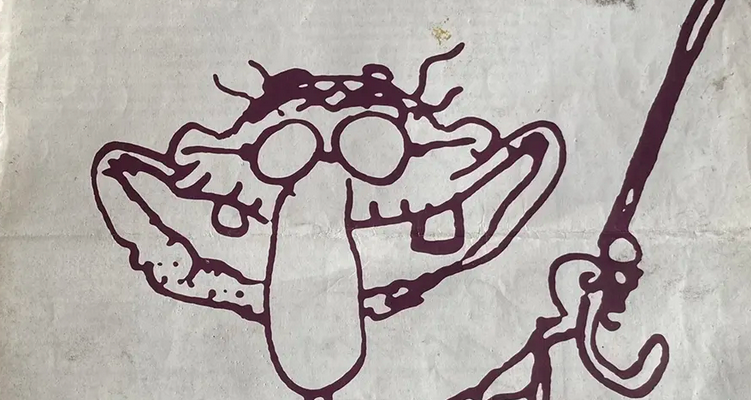
Pourquoi tant de dégout, tant de peur ? Le suffixe -phobie que l’on utilise pour différentes occasions à la particularité de pouvoir être interprété de façon très différente :
D’abord, une dimension psychologique : dans ce cas, la vieillophobie, c’est la peur intime de vieillir. Peur du corps qui change, peur de la dépendance, peur de la mort. Cette peur, chacun la porte en lui, parfois inconsciemment. Elle conduit à des comportements d’évitement : ne pas se dire vieux, repousser les signes de l’âge, consommer du « anti-âge ». Ensuite, une dimension sociale : dans ce cas, la vieillophobie, c’est le rejet collectif des vieux. Mépris, stéréotypes, invisibilisation, exclusion. Les vieux sont considérés comme inutiles, coûteux, dépassés. C’est une discrimination structurelle comparable à l’homophobie, au sexisme, au racisme.
Le mot vieillophobie a une spécificité : contrairement à homophobie ou xénophobie, qui désignent clairement des discriminations sociales, vieillophobie garde en elle l’écho intime de la peur. C’est même ce lien qui explique la force du rejet : la société rejette les vieux parce que chacun redoute d’en devenir un. Autrement dit, la phobie intérieure nourrit la phobie sociale. C’est un mot qui relie l’intime et le politique, la psychologie et la société. Et c’est pour ça qu’il est si puissant à utiliser : il dit à la fois ce que je ressens et ce que je subis. « La peur de vieillir » et « le rejet des vieux » s’alimentant l’un l’autre et nous empêchant d’assumer notre vie de vieux.
Pourquoi vieillophobie et pas âgisme ?
Le mot âgisme est né dans les années 1960, dans la bouche d’experts. Il désigne l’ensemble des discriminations liées à l’âge, qu’elles visent les jeunes ou les vieux. Concept utile, reconnu par les institutions internationales, il a l’avantage de donner une catégorie sociologique claire. Mais il a aussi l’inconvénient de rester froid, abstrait, technocratique.
Nous, vieux et vieilles, ne voulons pas seulement d’un concept d’experts : nous voulons un mot qui dise la violence que nous vivons au quotidien.
Un mot qui dénonce le mépris, le rejet, l’invisibilisation, l’humiliation sociale que subissent celles et ceux qui vieillissent. C’est pourquoi nous parlons de vieillophobie.
La vieillophobie, ce n’est pas une idée en laboratoire, c’est une réalité vécue :
– quand la société réduit les vieux à des malades ou à des fardeaux ;
– quand on nous dénie toute place active, créative, désirante ;
– quand les politiques de la longévité sont faites sur nous mais sans nous ;
– quand la peur de vieillir nourrit un immense marché de l’anti-âge, plutôt qu’un projet collectif de dignité et de solidarité.
Dire vieillophobie, c’est politiser la question.
C’est nommer le problème pour le combattre. C’est rappeler que, dans une société de la longévité, la place des vieux est un enjeu démocratique majeur.
Nous ne voulons plus être les objets de politiques sociales, nous voulons être des sujets politiques.
Identité ou catégorie ?
Une identité, c’est subjectif, choisi ou revendiqué. Dire « Je suis vieux » comme on dit « Je suis femme », « Je suis gay », c’est se reconnaître et transformer ce vécu en force. L’identité est toujours une construction politique et culturelle.
Une catégorie, c’est objectif, assigné, statistique. L’âge biologique et social classe les individus dans la catégorie « vieux », qu’ils l’assument ou non. La société fonctionne avec des catégories : jeunes, actifs, retraités, dépendants…
La vieillesse est d’abord une catégorie sociale, déterminée par des seuils arbitraires (60 ans, 65 ans, retraite, dépendance, etc.). C’est une catégorie institutionnelle, utilisée par les politiques publiques, les assurances, la médecine.
Elle est souvent associée à une identité négative (fardeau, fragilité, inutilité). Tant qu’on reste une catégorie, on subit. On est « les vieux » des statistiques, silencieux et traités comme des objets de politique sociale. Quand on en fait une identité, on agit. On dit « Oui, nous sommes vieux, et nous parlons en notre nom ».
C’est le même mouvement qu’ont fait les femmes, les homosexuels, les personnes racisées : transformer une catégorie imposée en identité assumée et mobilisatrice.
Pourquoi en faire une identité ?
Toutes les luttes contre les discriminations passent par une prise de conscience identitaire. Les femmes ont dû se nommer comme « femmes » pour dénoncer le patriarcat ; les minorités sexuelles se sont reconnues comme « homosexuelles », « lesbiennes », « queer », etc., pour s’organiser face à l’hétéro-norme ; les personnes racisées ont dû affirmer leur identité pour combattre le racisme. Tant qu’on reste invisible, tant qu’on se fond dans un « universel » qui en réalité est celui des dominants (le masculin, le jeune, le valide), on reste impuissant.
Pas d’égalité sans identité. Et pourtant…
La société refuse aux vieux une identité collective. On nous enferme dans des catégories médicales (« dépendants », « fragiles »), économiques (« retraités »), ou compassionnelles (« papys-mamies »). Résultat : on ne se revendique pas comme « vieux » de peur d’être assimilé à une catégorie qui nous fait peur…
Si chacun fuit cette identité, personne ne peut la transformer. Or, tant que le mot « vieux » reste une insulte, les discriminations vieillophobes restent impensées et impensables. Affirmer une identité « vieille », dire « Je suis vieux, et alors ? », c’est arracher le mot à l’insulte. C’est le transformer en drapeau.
C’est ouvrir la voie à une lutte politique, culturelle, symbolique, qui refuse le mépris et exige reconnaissance.
Sans cette affirmation collective, chacun se vit comme un cas individuel, un accident de parcours, une déchéance personnelle.
Avec cette identité, on peut dire, nous sommes nombreux, nous sommes citoyens, nous avons une expérience, une parole, un rôle, Et nous refusons d’être réduits à l’inutilité.
Vieux et fiers de l’être
En conclusion, nous ne voulons plus être des ombres dans les statistiques, des « charges » dans les budgets, des « fragiles » dans les discours médicaux.
Nous sommes vieux, sans honte, sans peur, sans regret. Vieillir n’est pas un défaut, ni une maladie, c’est une condition humaine, universelle, et pourtant méprisée.
Nous, les vieux
– Refusons d’être réduits à des clichés : ni sagesse obligatoire, ni décrépitude programmée.
– Refusons la pitié comme horizon et le jeunisme comme religion.
– Refusons d’être parlés à la place de nous-mêmes.
Nous, les vieux
– Affirmons notre rôle d’acteurs dans la société : nous créons, nous aimons, nous désirons, nous décidons.
– Affirmons notre force collective : sans nous, pas de vie associative, pas de solidarité familiale, pas de mémoire vivante.
– Affirmons notre droit à exister autrement qu’en « patients », « clients » ou « aidés ».
– Affirmons la nécessité de penser les justes équilibres d’une société dans laquelle les vieux sont de plus en plus nombreux.
– Affirmons notre responsabilité dans les décisions politiques et les orientations que nous devrons prendre pour assurer une égalité de chances pour tous.
Nous sommes vieux et fiers de l’être.
Parce que vieillir, c’est traverser, expérimenter, résister, apprendre encore.
Parce qu’être vieux, c’est aussi être libre de ne plus plaire à personne sinon à soi-même.
Nous sommes vieux, et nous faisons de cette identité notre drapeau.
Car il n’y aura pas de lutte contre la vieillophobie sans une identité assumée.
Il n’y aura pas de place juste pour nous sans une parole fière et collective.
Nous ne demandons pas la permission d’exister. Nous exigeons reconnaissance, dignité, égalité. Nous, les vieux, ne sommes pas le passé.
Nous sommes le présent. Et nous faisons partie de l’avenir.
Francis Carrier